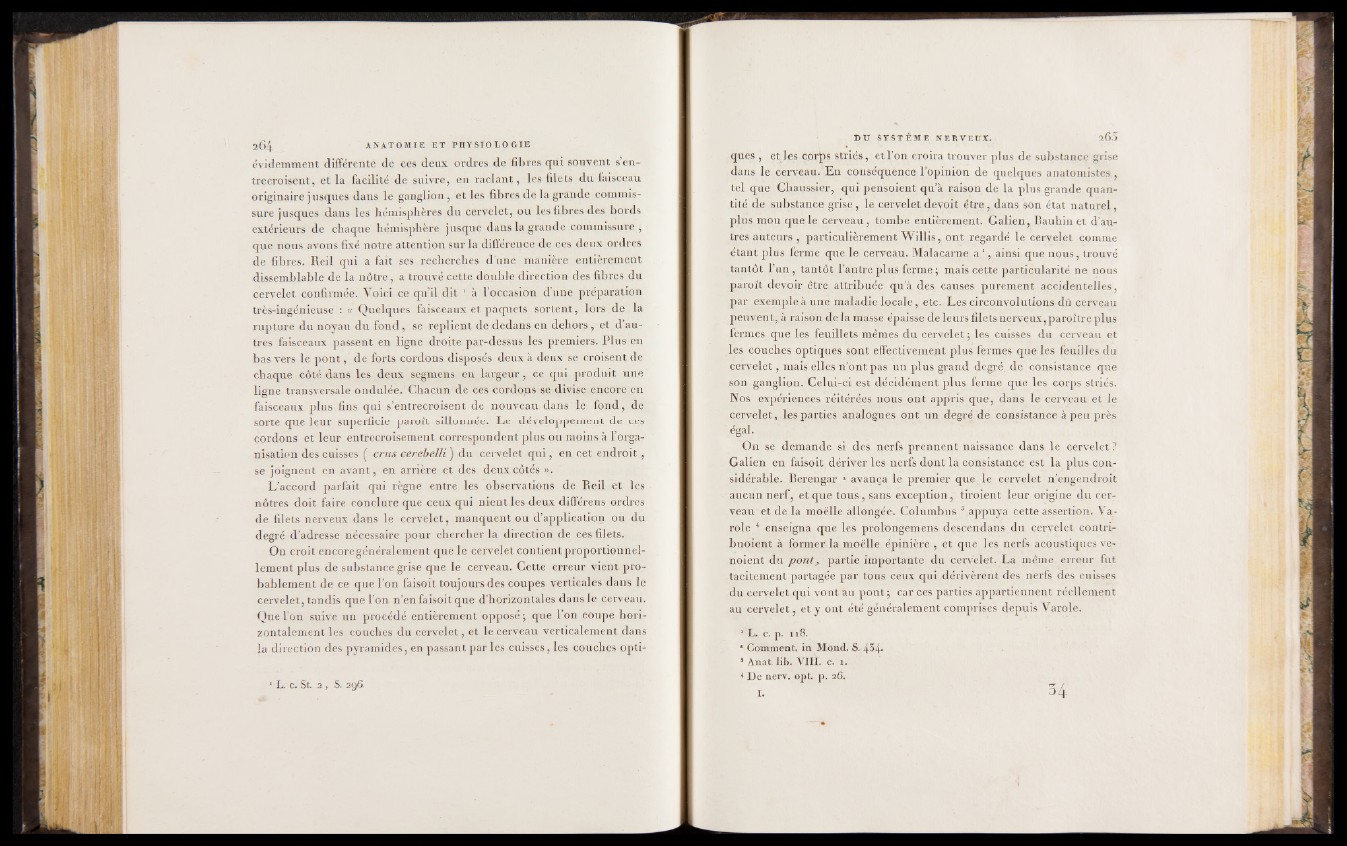
évidemment différente de ces deux ordres de fibres qui souvent s’entrecroisent,
et la facilité de suivre, en raclant, les filets du faisceau
originaire jusques dans le ganglion, et les fibres de la grande commissure
jusques dans les hémisphères du cervelet, ou les fibres des bords
extérieurs de chaque hémisphère jusque dans la grande commissure,
que nous avons fixé notre attention sur la différence de ces deux ordres
de fibres. Reil qui a fait ses recherches dune manière entièrement
dissemblable de la nôtre, a trouvé cette double direction des fibres du
cervelet confirmée. Voici ce qu’il dit ' à l’occasion d’une préparation
très-ingénieuse : « Quelques faisceaux et paquets sortent, lors de la
rupture du noyau du fond, se replient de dedans en dehors, et d’autres
faisceaux passent en ligne droite par-dessus les premiers. Plus en
bas vers le pont, de forts cordons disposés deux à deux se croisent de
chaque côté dans les deux segmens en largeur , ce qui produit une
ligne transversale ondulée. Chacun de ces cordons se divise encore en
faisceaux plus fins qui s’entrecroisent de nouveau dans le fond, de
sorte que leur superficie paroît sillonnée. Le développement de ces
cordons et leur entrecroisement correspondent plus ou moins à l’organisation
des cuisses f crus cerebelli) du cervelet qui, en cet endroit,,
se joignent en avant, en arrière et des deux côtés ». "
L ’accord parfait qui règne entre les observations de Reil et les
nôtres doit faire conclure que ceux qui nient les deux différens ordres
de filets nerveux dans le cervelet, manquent ou d’application ou du
degré d’adresse nécessaire pour chercher la direction de ces filets.
On croit encore généralement que le cervelet contient proportionnellement
plus de substance grise que le cerveau. Cette erreur vient probablement
de ce que l’on faisoit toujours des coupes verticales dans le
cervelet, tandis que l’on n’en faisoit que d’horizontales dans le cerveau.
Que l’on suive un procédé entièrement opposé; que l’on eoupe horizontalement
les couches du cervelet, et le cerveau verticalement dans
la direction des pyramides, en passant par les cuisses, les couches pptiques
, et les corps striés, et l’on croira trouver plus de substance grise
dans le cerveau. En conséquence l’opinion de quelques anatomistes ,
tel que Chaussier, qui pensoient qu’à raison de la plus grande quantité
de substance grise, le cervelet devoit être, dans son état naturel,
plus mou que le cerveau, tombe entièrement. Galien, Bauhin et d’autres
auteurs , particulièrement Willis, ont regardé le cervelet comme
étant plus ferme que le cerveau. Malacarne a 1, ainsi que nous, trouvé
tantôt l’un, tantôt l’autre plus ferme ; mais cette particularité ne nous
paroît devoir être attribuée qu’à des causes purement accidentelles,
par exemple à une maladie locale, etc. Les circonvolutions dù cerveau
peuvent, à raison delà masse épaisse de leurs filets nerveux, paroître plus
fermes que les feuillets mêmes du cervelet ; les cuisses du cerveau et
les couches optiques sont effectivement plus fermes que les feuilles du
cervelet, mais elles n’ont pas un plus grand degré, de consistance que
son ganglion. Celui-ci est décidément plus ferme que les corps striés.
Nos expériences réitérées nous ont appris que, dans le cerveau et le
cervelet, les parties analogues ont un degré de consistance à peu près
égal.
On se demande si des nerfs prennent naissance dans le cervelet ?
Galien en faisoit dériver les nerfs dont la consistance est la plus considérable.
Berengar * avança le premier que le cervelet n’engendroit
aucun nerf, et que tous, sans exception, tiroient leur origine du cerveau
et de la moelle allongée. Columbus 3 appuya cette assertion. Va-
role * enseigna que les prolongemens descendans du cervelet contri-
buoient à former la moelle épinière , et que les nerfs acoustiques ve,-
noient du pont, partie importante du cervelet. La même erreur fut
tacitement partagée par tous ceux qui dérivèrent des nel’fs des cuisses
du cervelet qui vont au pont; car ces parties appartiennent réellement
au cervelet, et y ont été généralement comprises depuis Varole.
* L. c. p. 118.
“ Comment, in Mond. S.
s Anatlib. VIIÏ. c. 1.
1 De nerv. opt. p. 36.
X.