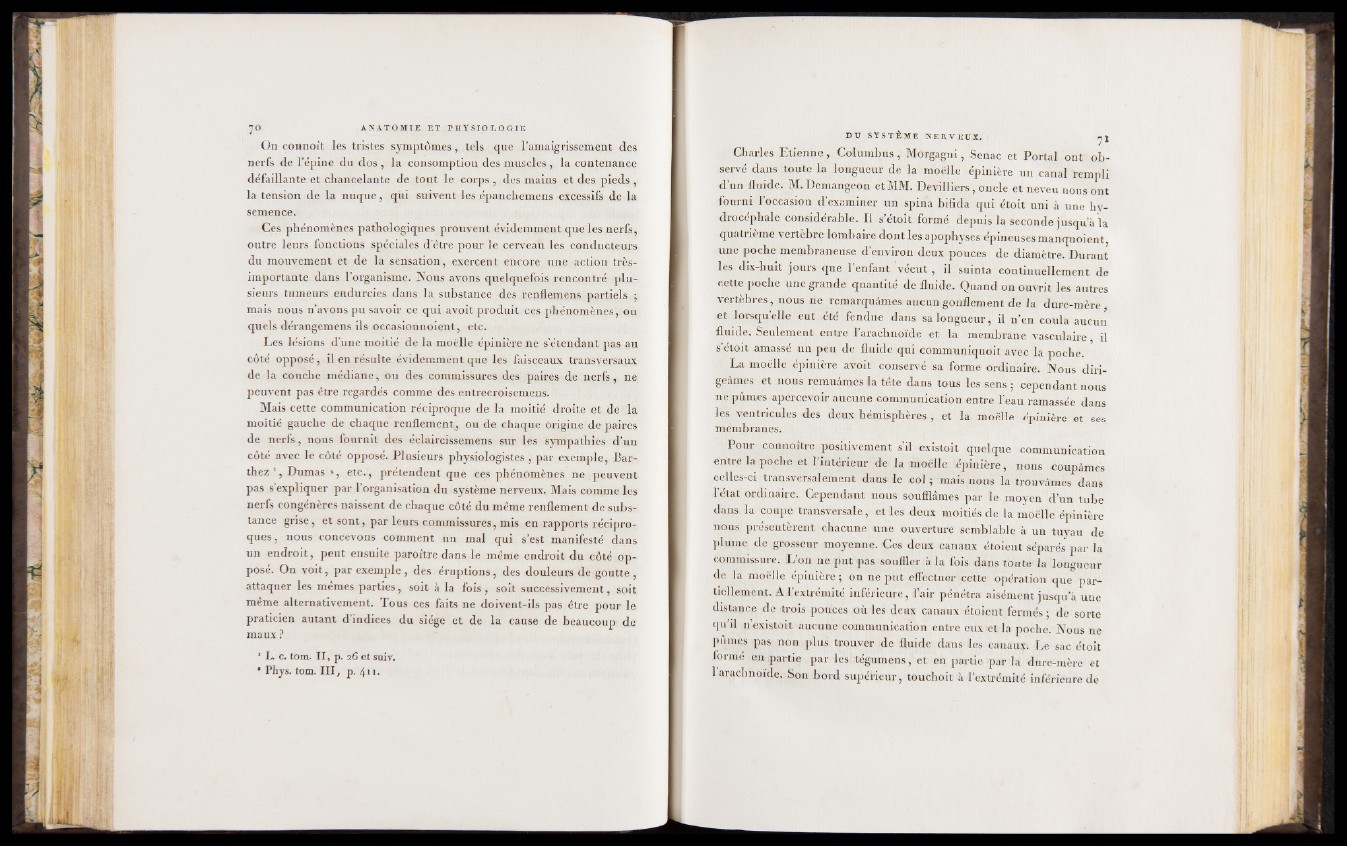
On connoit les tristes symptômes, tels que l’amaigrissement des
nerfs de l’épine du dos , la consomption des muscles , la contenance
défaillante et chancelante de tout le corps , des mains et des pieds ,
la tension de la nuque, qui suivent les épanchemens excessifs de la
semence.
Ces phénomènes pathologiques prouvent évidemment que les nerfs,
outre leurs fonctions spéciales d’être pour le cerveau les conducteurs
du mouvement et de la sensation, exercent encore une action très-
importante dans l ’organisme. Nous avons quelquefois rencontré plusieurs
tumeurs endurcies dans la substance des renflemens partiels ;
mais nous n’avons pu savoir ce qui avoit produit ces phénomènes, ou
quels dérangemens ils occasionnoient, etc.
Les lésions d’une moitié de la moelle épinière ne s’étendant pas au
côté opposé, il en résulte évidemment que les faisceaux transversaux
de la couche médiane, ou des commissures des paires de nerfs, ne
peuvent pas être regardés comme des entrecroiseinens.
Mais cette communication réciproque de la moitié droite et de la
moitié gauche de chaque renflement, ou de chaque origine de paires
de nerfs, nous fournit des éclaircissemens sur les sympathies d’un
côté avec le côté opposé. Plusieurs physiologistes , par exemple, Barthez
Dumas *, etc., prétendent que ces phénomènes ne peuvent
pas s’expliquer par l’organisation du système nerveux. Mais comme les
nerfs congénères naissent de chaque côté du même renflement de substance
grise, et sont, par leurs commissures, mis en rapports réciproques
, nous concevons comment un mal qui s’est manifesté dans
un endroit, peut ensuite paroitre dans le même endroit du côté opposé.
On voit, par exemple, des éruptions, des douleurs de goutte ,
attaquer les memes parties, soit à la fois , soit successivement, soit
même alternativement. Tous ces faits ne doivent-ils pas être pour le
praticien autant d’indices du siège et de la cause de beaucoup de
maux ?
■ L c. tom. II, p. 26 et suiv.
• Phys. tom. III, p. jj.n.
D U s y s t è m e n e r v e u x . 71
Charles Etienne, Columbus, Morgagni, Senac et Portai ont observé
dans toute la longueur de la moelle épinière un canal rempli
d’un fluide. M. Demangeon et MM. Devilliers, oncle et neveu nous ont
fourni l’occasion d’examiner un spina bifida qui étoit uni à une hv-
drocéphale considérable. Il s’étoit formé depuis la seconde jusqu’à la
quatrième vertèbre lombaire dont.les apophyses épineuses manquoient,
une poche membraneuse d’environ deux pouces de diamètre. Durant
les dix-huit jours que l’enfant vécut , il suinta continuellement de
cette poche une grande quantité de fluide. Quand on ouvrit les autres
vertèbres, nous ne remarquâmes aucun gonflement de la dure-mère
et lorsqu elle eut été fendue dans sa longueur, il n’en coula aucuu
fluide. Seulement entre l’arachnoïde et la membrane vasculaire il
s étoit amassé un peu de fluide qui communiquoit avec la poche.
La moelle épinière avoit conservé sa forme ordinaire. Nous dirigeâmes
et nous remuâmes la tête dans tous les sens ; cependant nous
ne pûmes apercevoir aucune communication entre l’eau ramassée dans
les ventricules des deux hémisphères , et la moelle épinière et ses
membranes.
Pour connoLlre positivement s’il existait quelque communication
entre la poche et 1 intérieur de la moelle épinière, nous coupâmes
celles-ci transversalement dans le col ; mais nous la trouvâmes dans
l’état ordinaire. Cependant nous soufflâmes par le moyen d’un tube
dans la coupe transversale, et les deux moitiés de la moelle épinière
nous présentèrent chacune une ouverture semblable à un tuyau de
plume de grosseur moyenne. Ce* deux canaux étaient séparés par la
commissure. L’on ne put pas souffler à la fois dans toute la longueur
de la moelle épinière ; on ne put effectuer cette opération que partiellement..
A l’extrémité inférieure, d’air pénétra aisément jusqu a une
distance de trois ponces où les deux canaux étaient fermés ; de sorte
qu’il n’existoit aucune communication entre eux et la poche. Nous ne
pûmes pas non plus trouver de fluide dans les canaux. Le sac étoit
formé en partie par les tégumens, et en partie par la dure-mère et
1 arachnoïde. Son bord supérieur, touchoit à l’extrémité inférieure de