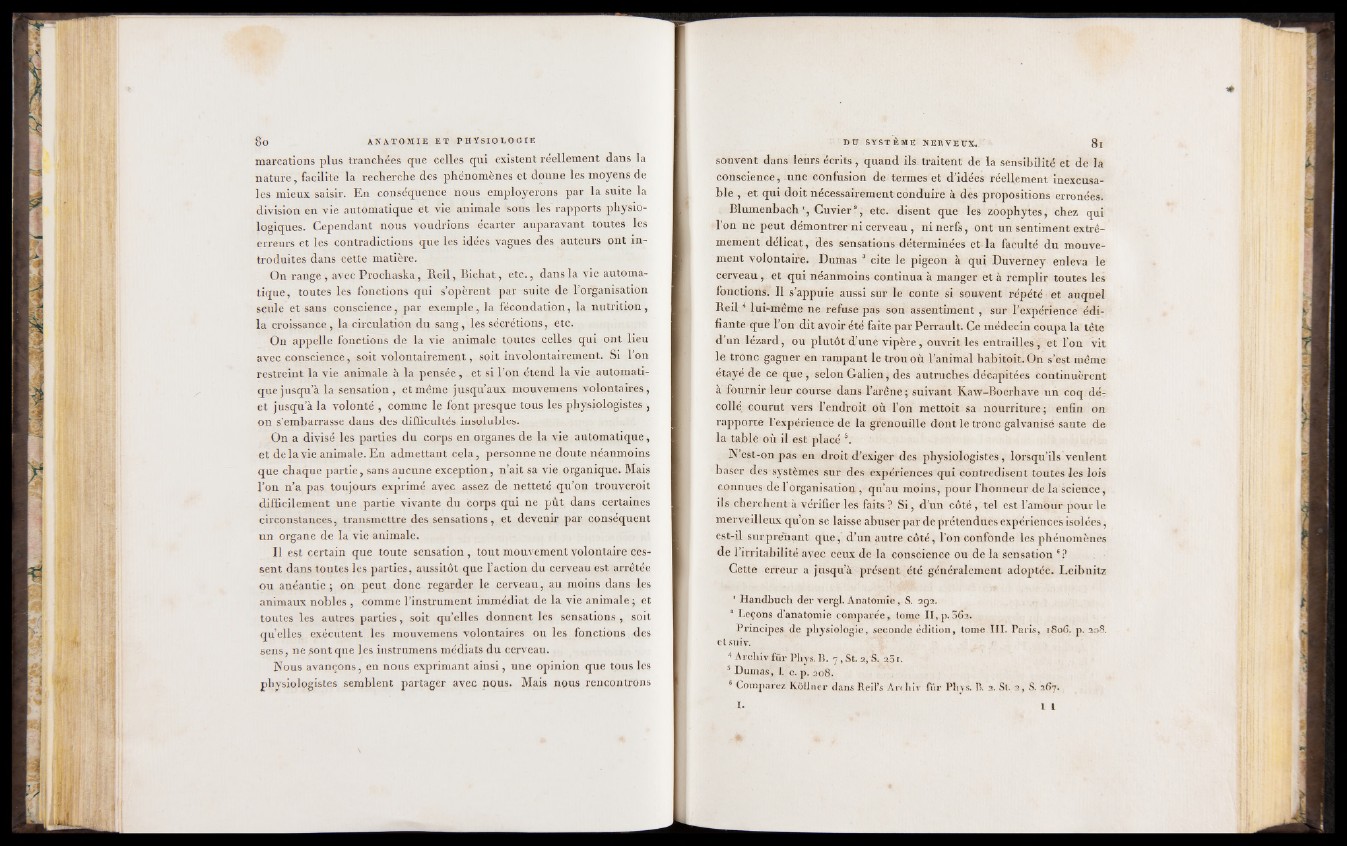
marcations plus tranchées que celles qui existent réellement dans la
nature, facilite la recherche des phénomènes et donne les moyens de
les mieux saisir. En conséquence nous employerons par la suite la
division en vie automatique et vie animale sous les' rapports physiologiques.
Cependant nous voudrions écarter auparavant toutes les
erreurs et les contradictions que les idées vagues des auteurs ont introduites
dans cette matière.
On range , avec Prochaska, Reil, Bichat, etc., dans la vie automatique,
toutes les fonctions qui s’opèrent par suite de l’organisation
seule et sans conscience, par exemple, la fécondation, la nutrition,
la croissance, la circulation du sang, les sécrétions, etc.
On appelle fonctions de la vie animale toutes celles qui ont lieu
avec conscience, soit volontairement, soit involontairement. Si l’on
restreint la vie animale à la pensée, et si l ’on étend la vie automatique
jusqu’à la sensation, et même jusqu’aux mouvemens volontaires,
et jusqu’à la volonté , comme le font presque tous les physiologistes ,
on s’embarrasse dans des difficultés insolubles.
On a divisé les parties du corps en organes de la vie automatique,
et de la vie animale. En admettant cela, personne ne doute néanmoins
que chaque partie, sans aucune exception, n’ait sa vie organique. Mais
l’on n’a pas toujours exprimé avec assez de netteté qu’on trouveroit
difficilement une partie vivante du corps qui ne pût dans certaines
circonstances, transmettre des sensations, et devenir par conséquent
un organe de la vie animale.
Il est certain que toute sensation, tout mouvement volontaire cessent
dans toutes les parties, aussitôt que l’action du cerveau est arrêtée
ou anéantie ; on peut donc regarder le cerveau, au moins dans les
animaux nobles , comme l’instrument immédiat de la vie animale; et
toutes les autres parties, soit qu’elles donnent les sensations , soit
qu elles exécutent les mouvemens volontaires ou les fonctions des
sens, ne sont que les iustrumens médiats du cerveau.
Nous avançons, en nous exprimant ainsi, une opinion que tous les
physiologistes semblent partager avec nous. Mais nous rencontrons
souvent dans leurs écrits, quand ils traitent de la sensibilité et de la
conscience,-une confusion de termes et d’idées réellement inexcusable
, et qui doit nécessairement conduire à des propositions erronées.
Blumenbach', Cuvier*, etc. disent que les zoophytes, chez qui
l’on ne peut démontrer ni cerveau , ni nerfs, ont un sentiment extrêmement
délicat, des sensations déterminées et- la faculté du mouvement
volontaire. Dumas 3 cite le pigeon à qui Duverney enleva le
cerveau, et qui néanmoins continua à manger et à remplir toutes les
fonctions. Il s’appuie aussi sur le conte si souvent répété et auquel
R e il4 lui-même ne refuse pas son assentiment, sur l’expérience édifiante
que l’on dit avoir été faite par Perrault. Ce médecin coupa la tête
d’un lézard, ou plutôt d’une vipère, ouvrit les entrailles , et l’on vit
le tronc gagner en rampant le trou où l’animal habitoit. On s’est même
etaye de ce que , selon Galien, des autruches décapitées continuèrent
à fournir leur course dans l’arëne ; suivant Kaw-Boerhave un coq décollé
courut vers l’endroit où l’on mettoit sa nourriture ; enfin on
rapporte l’expérience de la grenouille dont le tronc galvanisé saute de
la table où il est placé 5.
N’est-on pas en droit d’exiger des physiologistes, lorsqu’ils veulent
baser des systèmes sur des expériences qui contredisent toutes les lois
connues de l’organisation , qu’au moins, pour l ’honneur de la science,
ils cherchent à vérifier les faits ? S i, d’un côté , tel est l’amour pour le
merveilleux qu’on se laisse abuser par de prétendues expériences isolées,
est-il surprenant que, d’un autre côté, l’on confonde les phénomènes
de l’irritabilité avec ceux de la conscience ou de la sensation s?
Cette erreur a jusqu’à présent été généralement adoptée. Leibuitz
’ Handbuch der vergl. Anatomie, S. 292.
“ Leçons d’anatomie comparée, tome II, p. 362.
Principes de physiologie, seconde édition, tome III. Paris, 1806. p. 208.
et suiv.
4 Arcliiv fiïr Phys. B. 7 , St 2, S. 2 3 1.
s Dumas, 1. c. p. 208.
6 Comparez Kôilner dans Reil’s Arc hiv fur Phys. 6. 2. St. 2, S. 267.
I. 1 l