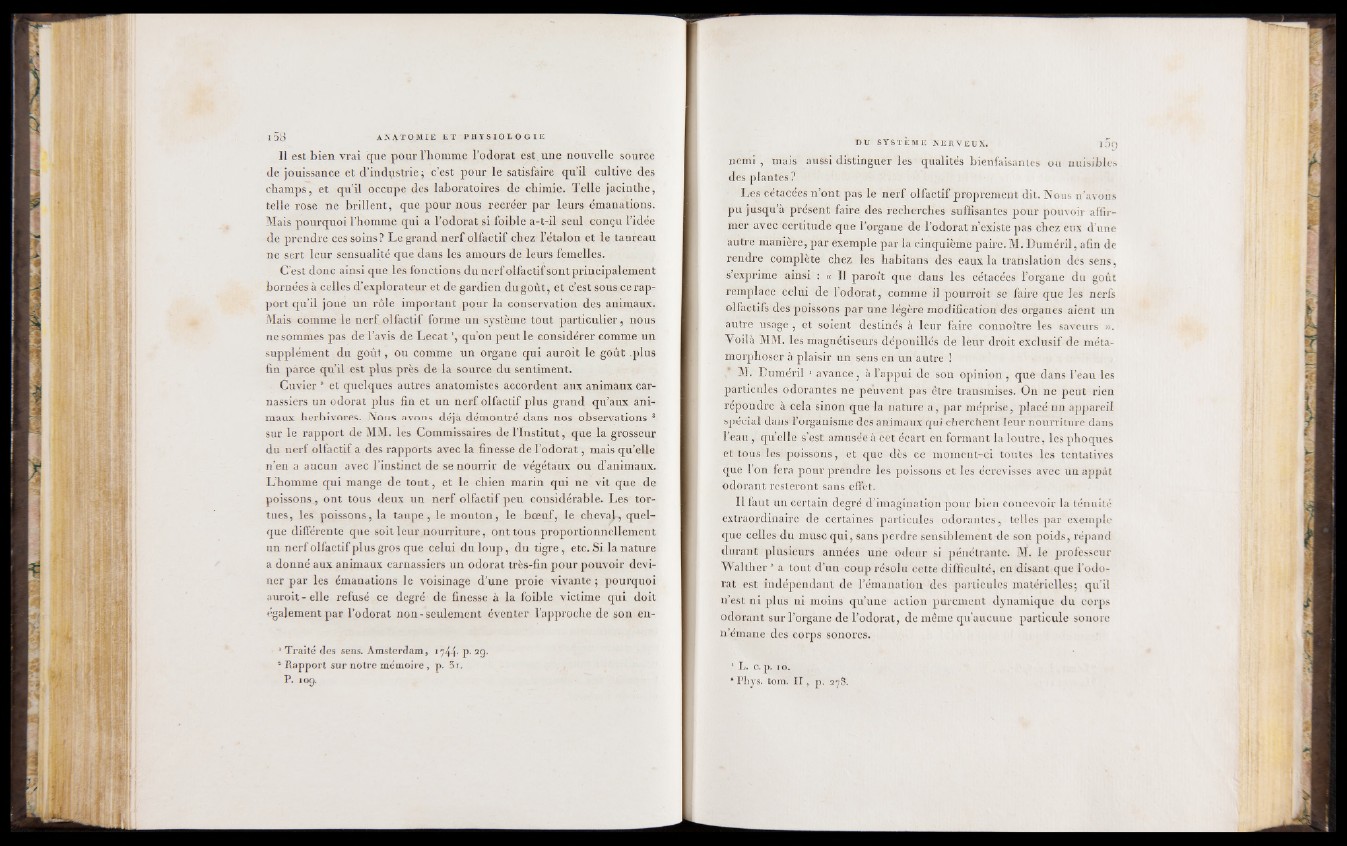
A K A T O M I E E T P H Y S I O L O G I E l58I
l est bien vrai que pour l’homme l’odorat est une nouvelle source
de jouissance et d’industrie; c’est pour le satisfaire qu’il cultive des
champs, et qu’il occupe des laboratoires de chimie. Telle jacinthe,
telle rose ne brillent, que pour nous recréer par leurs émanations.
Mais pourquoi l’homme qui a l’odorat si foible a-t-il seul conçu l’idée
de prendre ces soins? Legrand nerf olfactif chez l’étalon et le taureau
ne sert leur sensualité que dans les amours de leurs femelles.
C’est donc ainsi que les fonctions du nerf olfactif sont principalement
bornées à celles d’explorateur et de gardien du goût, et c’est sous ce rapport
qu’il joue un rôle important pour la conservation des animaux.
Mais comme le nerf olfactif forme un système tout particulier, nous
ne sommes pas de l’avis de Lecat ', qu’on peut le considérer comme un
supplément du goût, ou comme un organe qui auroit le goût plus
fin parce qu’il est plus près de la source du sentiment.
Cuvier ï et quelques autres anatomistes accordent aux animaux carnassiers
un odorat plus fin et un nerf olfactif plus grand qu’aux animaux
herbivores. Nous avons déjà démontré dans nos observations 3
sur le rapport de MM. les Commissaires de l’Institut, que la grosseur
du nerf olfactif a des rapports avec la finesse de l’odorat, mais qu’elle
n’en a aucun avec l’instinct de se nourrir de végétaux ou d’animaux.
L’homme qui mange de tout, et le chien marin qui ne vit que de
poissons, ont tous deux un nerf olfactif peu considérable. Les tortues,
les poissons, la taupe, le mouton, le boeuf, le cheval-, quelque
différente que soit leur nourriture, ont tous proportionnellement
un nerf olfactif plus gros que celui du loup, du tigre, etc. Si la nature
a donné aux animaux carnassiers un odorat très-fin pour pouvoir deviner
par les émanations le voisinage d’une proie vivante ; pourquoi
auroit-elle refusé ce degré de finesse à la foible victime qui doit
également par l’odorat non-seulement éventer l’approche de son en1
Traité des sens. Amsterdam, 1744- p. ag.
' Rapport sur notre mémoire, p. 5i.
P. îog.
nemi , mais aussi distinguer les qualités bienfaisantes ou nuisibles
des plantes?
Les cétacées n’ont pas le nerf olfactif proprement dit. Nous n’avons
pu jusqu’à présent faire des recherches suffisantes pour pouvoir affirmer
avec certitude que l’organe de l’odorat n’existe pas chez eux d’une
autre manière, par exemple par la cinquième paire. M. Duméril, afin de
rendre complète chez les habitans des eaux la translation des sens,
s’exprime ainsi : « Il paroit que dans les cétacées l’organe du goût
remplace celui de l’odorat, comme il pourvoit se faire que les nerfs
olfactifs des poissons par une légère modification des organes aient un
autre usage , et soient destinés à leur faire connoître les saveurs ».
Voilà MM. les magnétiseurs dépouillés de leur droit exclusif de métamorphoser
à plaisir un sens en un autre !
' M. Duméril 1 avance, à l’appui de son opinion , que dans l ’eau les
particules odorantes ne peuvent pas être transmises. On ne peut rien
répondre à cela sinon que la nature a, par méprise, placé un appareil
spécial dans l’organisme des animaux qui cherchent leur nourriture dans
l’eau , quelle s’est amusée à cet écart en formant la loutre, les phoques
et tous les poissons, et que dès ce moment-ci toutes les tentatives
que l’on fera pour prendre les poissons et les écrevisses avec un appât
odorant resteront sans effet.
Il faut un certain degré d’imagination pour bien concevoir la ténuité
extraordinaire de certaines particules odorantes, telles par exemple
que celles du musc qui, sans perdre sensiblement de son poids, répand
durant plusieurs années une odeur si pénétrante. M. le professeur
Walther * a tout d’un coup résolu cette difficulté, en disant que l’odorat
est indépendant de l’émanation des particules matérielles; qu’il
n’est ni plus ni moins qu’une action purement dynamique du corps
odorant sur l’organe de l’odorat, de même qu’aucune particule sonore
n’émane des corps sonores.
‘ L. c. p. io.
* Phys. tom. I I , p. 37$.