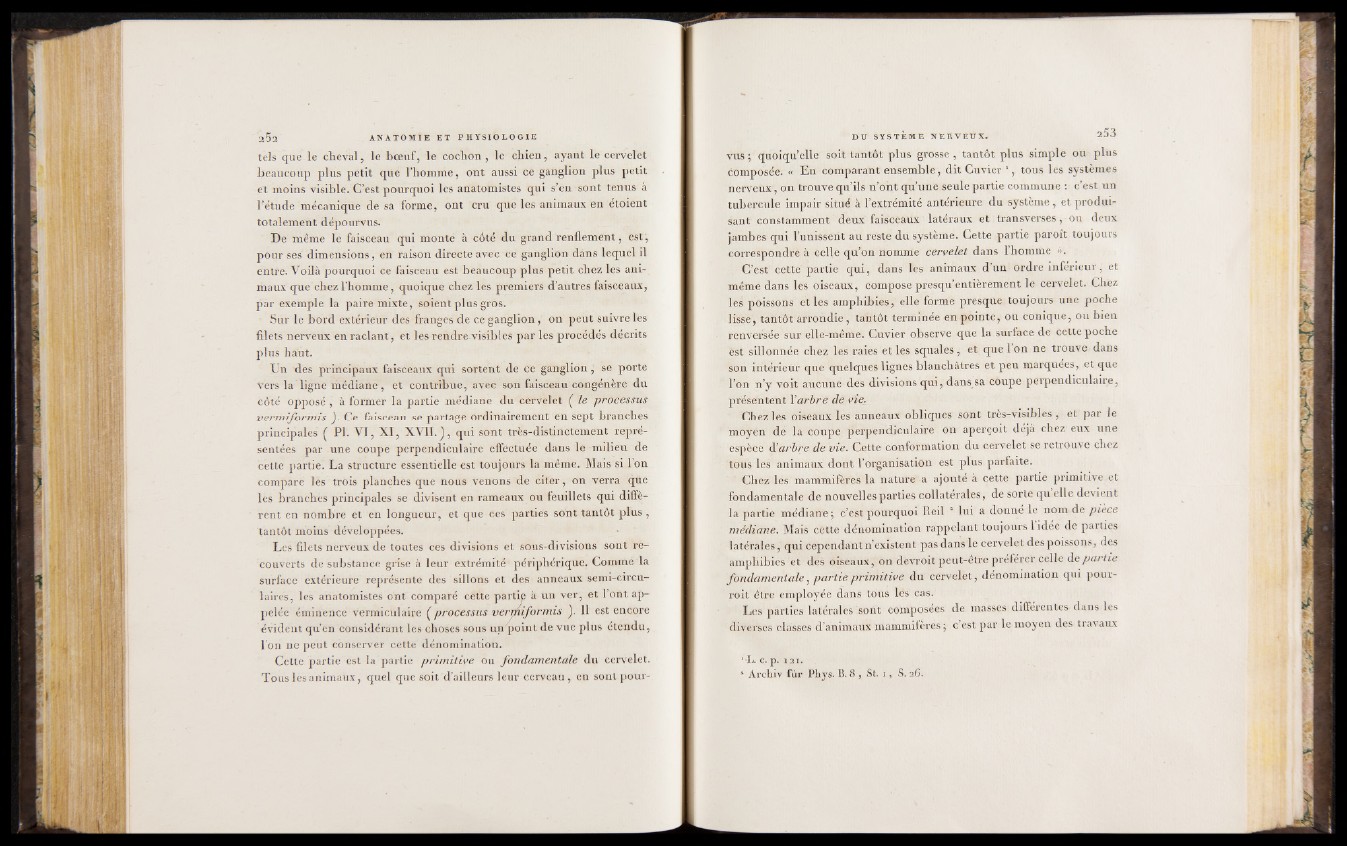
tels que le cheval, le boeuf, le cochon, le chien, ayant le cervelet
beaucoup plus petit que l’homme, ont aussi ce ganglion plus petit
et moins visible. C’est pourquoi les anatomistes qui s’ën sont tenus à
l’étude mécanique de sa forme, ont cru que les animaux en étoient
totalement dépourvus.
De même le faisceau qui monte à côté du grand renflement, est ',
pour ses dimensions, en raison directe avec ce ganglion dans lequel il
entre. Voilà pourquoi ce faisceau est beaucoup plus petit chez les animaux
que chez l’homme, quoique chez les premiers d’autres faisceaux,
par exemple la paire mixte, soient plus gros.
• Sur le bord extérieur des franges de ce ganglion, on peut suivre les
filets nerveux en raclant, et les rendre visibles par les procédés décrits
plus haut.
Un des principaux faisceaux qui sortent de ce ganglion , se porte
vers la ligne médiane, et contribue, avec son faisceau'congénère du
côté opposé, à former la partie médiane du cervelet ( le processus
vermiformis ). Ce faisceau se partage ordinairement en sept branches
principales ( PI. VI , XI, XVII.), qui sont très-distinctement représentées
par une coupe perpendiculaire effectuée dans le milieu de
cette partie. La structure essentielle est toujours la même. Mais si Ion
compare les trois planches que nous venons de citer, on verra qtie
les branches principales se divisent en rameaux ou feuillets qui diffèrent
en nombre et en longueur, et que ces parties sont tantôt plus ,
tantôt moins développées. -
Les filets nerveux de toutes ces divisions et sous-divisions sont recouverts
de substance grise à leur extrémité périphérique. Comme la
surface extérieure représente des sillons et des anneaux semi-circulaires,
les anatomistes ont comparé cette partm à un ver, et 1 ont appelée
éminence vermicnlaire ( processus vermiformis ). 11 est encore
évident qu’en considérant lés choses sous un point de vue plus étendu,
l'on ne peut conserver cette dénomination.
Cette partie est la partie p r imitive ou fondamentale du cervelet.
Tous les animaux, quel que soit d’ailleurs leur cerveau , en sont pourvus
; quoiqu’elle soit tantôt plus grosse , tantôt plus simple ou plus
composée; « En comparant ensemble, dit Cuvier ' , tous les systèmes
nerveux, on trouve qu’ils n’ont qu’une seule partie commune : c’est un
tubercule impair situé à l’extrémité antérieure du système, et produisant
constamment deux faisceaux latéraux et transverses, ou deux
jambes qui l’unissent au reste du système. Cette partie paroît toujours
correspondre à celle qu’on nomme cervelet dans l’homme ».
C’est cette partie qui, dans lës animaux d’un ordre inférieur, et
même dans les oiseaux, compose presqu’entièrement le cervelet. Chez
les poissons et les amphibies, elle forme presque toujours une poche
lisse, tantôt arrondie, tantôt terminée en pointe, ou conique, ou bien
renversée sur elle-même. Cuvier observe que la surface de cette poche
est sillonnée chez les raies et les squales, et que l’on ne trouve dans
son intérieur que quelques lignes blanchâtres et peu marquées, et que
l’on n’y voit aucune des divisions qui, dans sa coupe perpendiculaire,
présentent l’arbre de vie.
Chez les oiseàux les anneaux obliques sont tres-visibles, et par le
moyen de la coupe perpendiculaire on aperçoit déjà chez eux une
espèce (Marbre de v ie . Cette conformation du cervelet se retrouve chez
tous les animaux dont l ’organisation est plus parfaite.
Chez les mammifères la nature a ajoute à cette partie primitive et
fondamentale de nouvelles parties collaterales, de sorte qu elle devient
la partie médiane; c’ést pourquoi Reil 1 lui a donné le nom de piece
médiane. Mais cette dénomination rappelant toujours 1 idée de parties
latérales, qui cependant n’existent pas dans le cervelet des poissons, des
amphibies et des oiseaux, on devroit peut-etre preferer celle dep a r tie
fond am en tale, partie pr imitive du cervelet, dénomination qui pour-
roit être employée dans tous les' cas.
Les parties latérales sont composées de masses différentes dans les
diverses classes d’animaux mammifères; c est par le moÿen des travaux
’ -Ij. c. p. 131.
* Archiv fur Phys. B. 8 , St. i , S. 26.