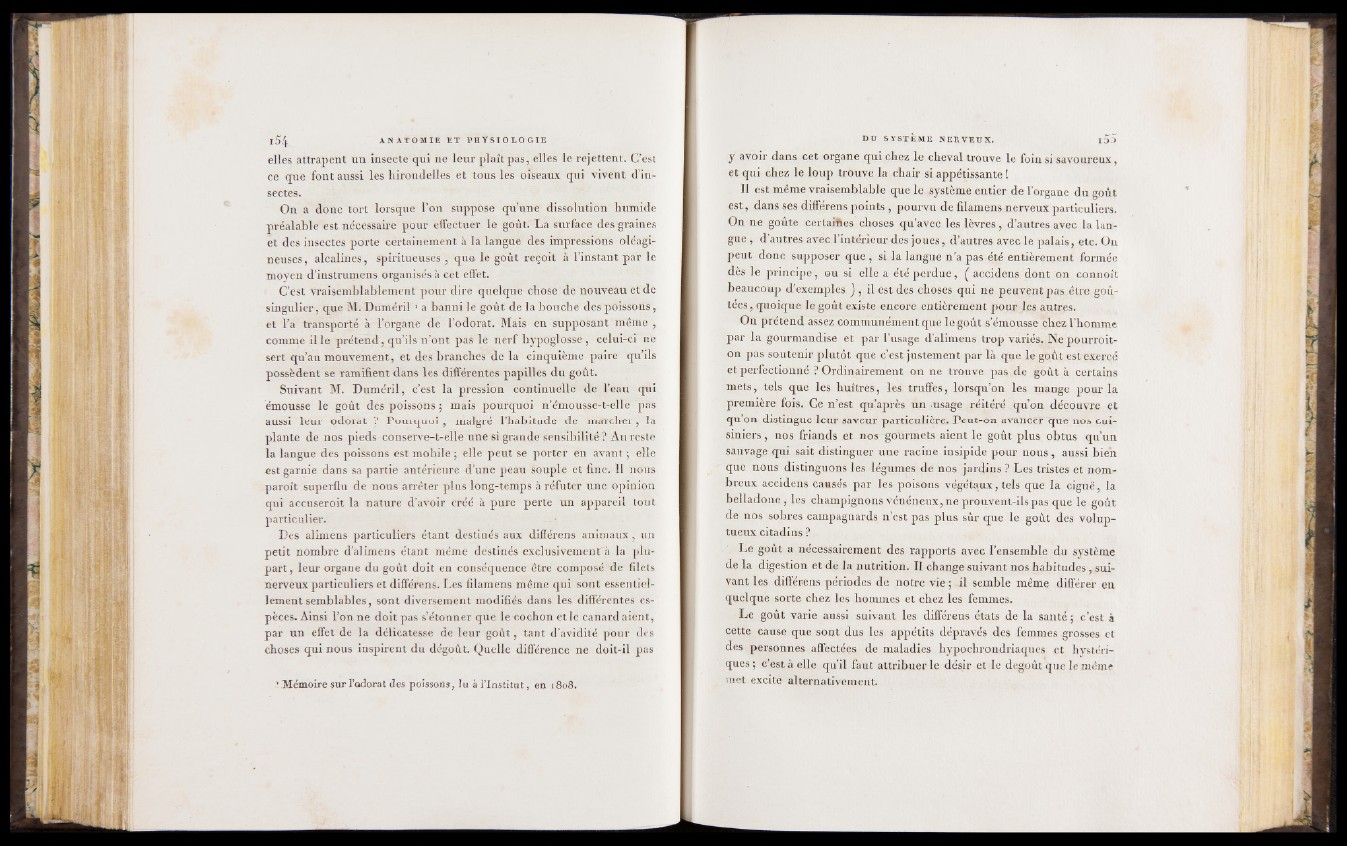
elles attrapent un insecte qui ne leur plaît pas, elles le rejettent. C’est
ce que font aussi les hirondelles et tous les oiseaux qui vivent d’insectes.
On a donc tort lorsque l’on suppose qu’une dissolution humide
préalable est nécessaire pour effectuer le goût. La surface des graines
et des insectes porte certainement à la langue des impressions oléagineuses,
alcalines, spiritueuses , qus le goût reçoit à l’instant par le
moyen d’instrumens organisés à cet effet.
C’est vraisemblablement pour dire quelque chose de nouveau et de
singulier, que M. Duméril > a banni le goût de la bouche des poissons,
et l’a transporté à l’organe de l’odorat. Mais en supposant même ,
comme il le prétend, qu’ils n’ont pas le nerf hypoglosse , celui-ci ne
sert qu’au mouvement, et des branches de la cinquième paire qu’ils
possèdent se ramifient dans les différentes papilles du goût.
Suivant M. Duméril, c’est la pression continuelle de l’eau qui
émousse le goût des poissons ; mais pourquoi n’émoussé-t-elle pas
aussi leur odorat ? Pourquoi , malgré l’habitude de marcher, la
plante de nos pieds conserve-t-elle une si grande sensibilité ? Au reste
la langue des poissons est mobile ; elle peut se porter en avant ; elle
est garnie dans sa partie antérieure d’une peau souple et fine. Il nous
paroît superflu de nous arrêter plus long-temps à réfuter une opinion
qui accuseroit la nature d’avoir créé à pure perte un appareil tout
particulier.
Des alimens particuliers étant destinés aux différens animaux, un
petit nombre d’alimens étant même destinés exclusivement'à la plupart,
leur organe du goût doit en conséquence être composé de filets
nerveux particuliers et différens. Les filamens même qui sont essentiellement
semblables, sont diversement modifiés dans les différentes espèces.
Ainsi l’on ne doit pas s’étonner que le-cochon et le canardaient,
par un effet de la délicatesse de leur goût, tant d’avidité pour des
choses qui nous inspirent du dégoût. Quelle différence ne doit-il pas
’ Mémoire sur l’odorat des poissons, lu à l’Institut, en 1808.
y avoir dans cet organe qui chez le cheval trouve le foin si savoureux,
et qui chez le loup trouve la chair si appétissante !
Il est même vraisemblable que le système entier de l’organe du goût
est, dans ses différens points , pourvu de filamens nerveux particuliers.
On ne goûte certaines choses qu’avec les lèvres , d’autres avec la langue
, d’autres avec l’intérieur des joues, d’autres avec le palais, etc. On
peut donc supposer que, si la langue n’a pas été entièrement formée
dès le principe, ou si elle a été perdue, ( accidens dont on connoît
beaucoup d’exemples ) , il est des choses qui ne peuvent pas. être goûtées,
quoique le goût existe encore entièrement pour les autres.
On prétend assez communément que le goût s’émousse chez l ’homme
par la gourmandise et par l’usage d’alimens trop variés. Ne pourroit-
on pas soutenir plutôt que c’est justement par là que le goût est exercé
et perfectionné ? Ordinairement on ne trouve pas de goût à certains
mets, tels que les huîtres, les truffes, lorsqu’on les mange pour la
première fois. Ce n’est qu’après un usage réitéré qu’on découvre et
qu’on distingue leur saveur particulière. Peut-on avancer que nos cuisiniers
, nos friands et nos gourmets aient le goût plus obtus qu’un
sauvage qui sait distinguer une racine insipide pour nous, aussi bien
que nous distinguons les légumes de nos jardins ? Les tristes et nombreux
accidens causés par les poisons végétaux, tels que la ciguë, la
belladone , les champignons vénéneux, ne prouvent-ils pas que le goût
de nos sobres campagnards n’est pas plus sûr que le goût des voluptueux
citadins ?
Le goût a nécessairement des rapports avec l’ensemble du système
de la digestion et de la nutrition. Il change suivant nos habitudes, suivant
les différens périodes de notre vie ; il semble même différer en
quelque sorte chez les hommes et chez les femmes.
Le goût varie aussi suivant les différens états de la santé ; c’est à
cette cause que sont dus les appétits dépravés des femmes grosses et
des personnes affectées de maladies liypochrondriaques et hystériques
; c’est à elle qu’il faut attribuer le désir et le dégoût que le même
met excite alternativement.