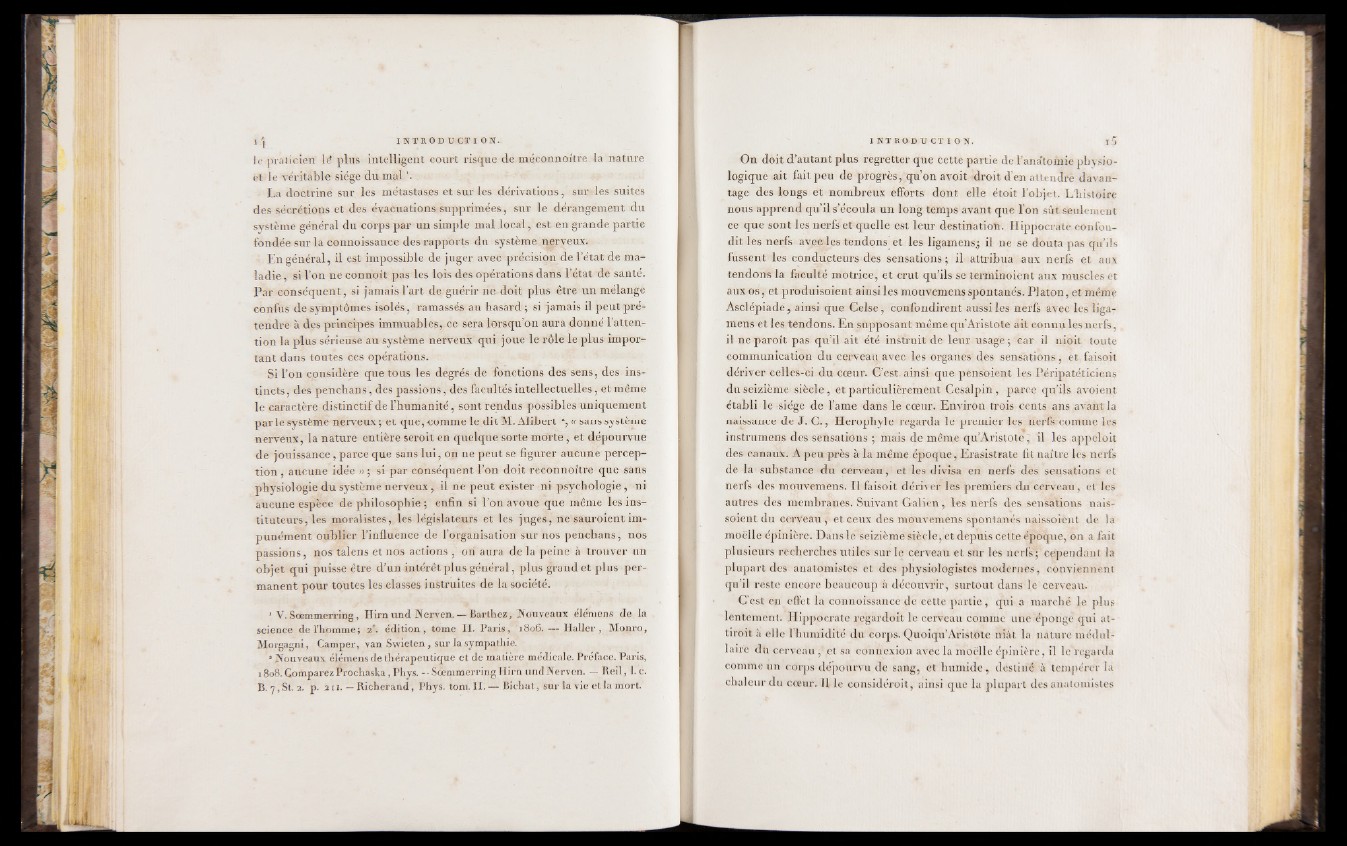
le praticien lé plus intelligent court risque de méconnoitre la nature
et le véritable siège du mal
La doctrine sur les métastases et sur les dérivations, sur les suites
des sécrétions et des évacuations supprimées, sur le dérangement du
système général du corps par un simple mal local, est en grande partie
fondée sur la connoissance des rapports du système nerveux.
En général, il est impossible de juger avec précision de l’état de maladie
, si l’on ne connoit pas les lois des opérations dans l’état de santé.
Par conséquent, si jamais l’art de guérir ne doit plus être un mélange
confus de symptômes isolés, ramassés au hasard ; si jamais il peut prétendre
à des principes immuables, ce sera lorsqu’on aura donné l’attention
la plus sérieuse au système nerveux qui joue le rôle le plus important
dans toutes ces opérations.
Si l’on considère que tous les degrés de fonctions des sens, des instincts,
des penchans, des passions, dès facultés intellectuelles, et même
le caractère distinctif de l’humanité, sont rendus possibles uniquement
parle système nerveux; et que, comme le dit M. Alibert *, « sans système
nerveux, la nature entière seroit en quelque sorte morte, et dépourvue
de jouissance, parce que sans lui, on ne peut se figurer aucune perception
, aucune idée » ; si par conséquent l’on doit reconnoitre que sans
physiologie du système nerveux, il ne peut exister ni psychologie, ni
aucune espèce de philosophie ; enfin si l ’on avoue que même les instituteurs,
les moralistes, les législateurs et les juges, ne sauroient impunément
oublier l’influence de l’organisation sur nos penchans, nos
passions, nos talens et nos actions , ori aura de la peine à trouver un
objet qui puisse être d’un intérêt plus général, plus grand et plus permanent
pour toutes les classes instruites de la société. 1
1 Y. Soemmerring, Hirn und Nerven. — Barthez, Nouveaux élémens de la
science de l’homme; 2'. édition, tome II. Paris, 1806. — Haller, Monro,
Morgagni, Camper, vau Swielen, sur la sympathie.
» Nouveaux élémens de thérapeutique et de matière médicale. Préface. Paris,
1808. Comparez Prochaska, Phys. -• Soemmerring Iïirn und Nerven. — Reil, 1. c.
B. 7, St. 2. p. 211. — Richerand, Phys. tom. II. — Bichat, sur la vie et la mort.
On doit d’autant plus regretter que cette partie de l’ana'tomie physiologique
ait fait peu de progrès, qu’on avoit droit d’en attendre davantage
des longs et nombreux efforts dont elle étoit l’objet. L ’histoire
nous apprend qu’il s’écoula un long temps avant que l’on sût seulement
ce que sont les nerfs et quelle est leur destinatioh. Hippocrate confondit
les nerfs avec les tendons et les ligamens.; il ne se douta pas qu’ils
fussent les conducteurs des sensations ; il attribua aux nerfs et aux
tendons la faculté motrice, et crut qu’ils se terminoient aux muscles et
aux os, et produisoient ainsi les mouvemensspontanés. Platon, et même
Asclépiade, ainsi que Celse, confondirent aussi les nerfs avec les ligamens
et les tendons. En supposant même qu’Aristote ait connu les nerfs,
il ne paroît pas qu’il ait été instruit de leur usage ; car il nioit toute
communication du cerveau avec les organes des sensations, et faisoit
dériver celles-ci du coeur. C’est, ainsi que pensoient les Péripatéticiens
du seizième siècle, et particulièrement Cesalpin, parce qu’ils avoieut
établi le siège de l’ame dans le coeur. Environ trois cents ans avant la
naissance de J. C., Heropliyle regarda le premier les nerfs comme les
instrumens des sensations ; mais de même qu’Aristote ^ il les appeloit
des canaux. A peu près à la même époque, Erasistrale fit naître les nerfs
de la substance du cerveau, et les divisa en nerfs des sensations et
nerfs des mouvemens. Il faisoit dériver les premiers cLu cerveau, et les
autres des membranes. Suivant Galien, les nerfs des sensations nais-
soient du cerveau, et ceux des mouvemens spontanés naissoient de. la
moelle épinière. Dans le seizième siècle, et depuis cette époque, on a fait
plusieurs recherches utiles sur le cerveau et sur les nerfs; cependant la
plupart des anatomistes et des physiologistes modernes, conviennent
qu’il reste encore beaucoup à découvrir, surtout dans le cerveau.
C’est en effet la connoissance de cette partie, qui a marché le plus
lentement. Hippocrate regardoit le cerveau comme une éponge qui at-
tiroit à elle l’humidité du corps. Quoiqu’Aristote niât la nature médullaire
du cerveau f et sa connexion avec la moelle épinière, il le regarda
comme un corps dépourvu de sang, et humide, destiné à tempérer la
chaleur du coeur. 11 le considéroit, ainsi que la plupart des anatomistes