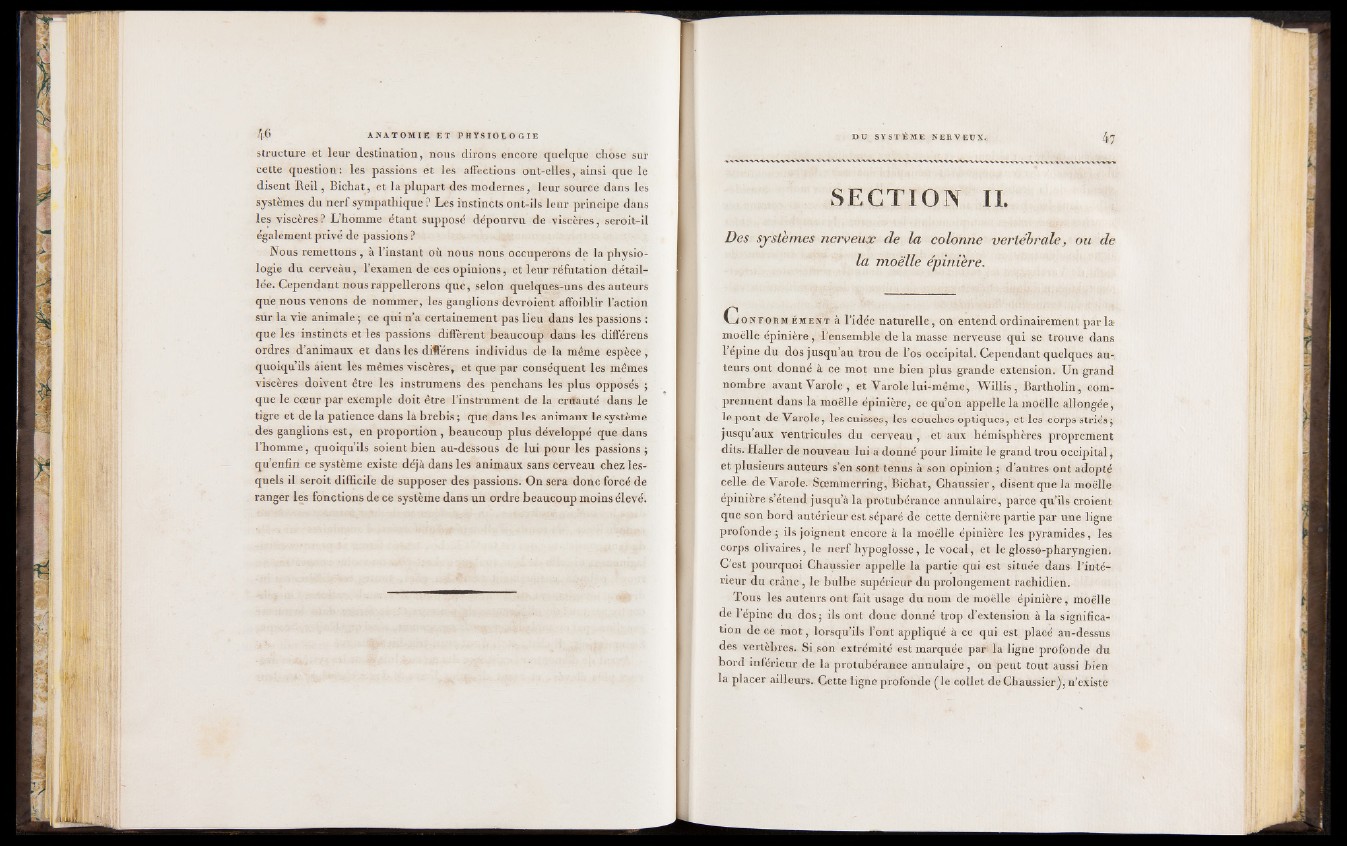
structure et leur destination, nous dirons encore quelque chose sur
cette question : les passions et les affections ont-elles, ainsi que le
disent Re il, Bichat, et la plupart des modernes, leur source dans les
systèmes du nerf sympathique ? Les instincts ont-ils leur principe dans
les viscères? L’homme étant supposé dépourvu de viscères, seroit-il
également privé de passions ?
Nous remettons , à l’instant où nous nous occuperons de la physiologie
du cerveàu, l’examen de ces opinions, et leur réfutation détaillée.
Cependant nous rappellerons que, selon quelques-uns des auteurs
que nous venons de nommer, les ganglions devroient affoiblir l’action
sur la vie animale ; ce qui n’a certainement pas lieu dans les passions :
que les instincts et les passions diffèrent beaucoup dans les différens
ordres d’animaux et dans les différens individus de la même espèce,
quoiqu’ils aient les mêmes viscères t et que par conséquent les mêmes
viscères doivent être les instrumens des penchans les plus opposés ;
que le coeur par exemple doit être l’instrument de la criïauté dans le
tigre et de la patience dans la brebis ; que dans les animaux le système
des ganglions est, en proportion , beaucoup plus développé que dans
l ’homme, quoiqu’ils soient bien au-dessous de lui pour les passions ;
qu’enfin ce système existe déjà dans les animaux sans cerveau chez lesquels
il seroit difficile de supposer des passions. On sera donc forcé de
ranger les fonctions de ce système dans un ordre beaucoup moins élevé.
S E C T IO N IL
Des systèmes nerveux de la colonne vertébrale, ou de
la moelle épinière.
C o n f o r m é m e n t à l ’idée naturelle, on entend ordinairement parla-
moelle épinière, l’ensemble de la masse nerveuse qui se trouve dans
1 epine du dos jusqu’au trou de l’os occipital. Cependant quelques auteurs
ont donné à ce mot une bien plus grande extension. Un grand
nombre avant Varole , et Yarole lui-même, Willis , Bartholin, comprennent
dans la moelle épinière, ce qu’on appelle la moëlle allongée ,
le pont de Yarole, les cuisses, les couches optiques, et les corps striés;
jusqu’aux ventricules du cerveau , et aux hémisphères proprement
dits. Haller de nouveau lui a donné pour limite le grand trou occipital,
et plusieurs auteurs s’en sont tenus à son opinion ; d’autres ont adopté
celle de Varole. Soemmerring, Bichat, Chaussier, disent que la moëlle
epmière s’étend jusqu’à la protubérance annulaire , parce qu’ils croient
que son bord antérieur est séparé de cette dernière partie par une ligne
profonde ; ils joignent encore à la moëlle épinière les pyramides, les
corps olivaires, le nerf hypoglosse, le vocal, et le glosso-pharyngien.
C’est pourquoi Chaussier appelle la partie qui est située dans l ’intérieur
du crâne , le bulbe supérieur du prolongement rachidien.
Tous les auteurs ont fait usage du nom de moëlle épinière, moëlle
de l’épine du dos; ils ont donc donné trop d’extension à la signification
de ce mot, lorsqu’ils l’ont appliqué à ce qui est placé au-dessus
des vertèbres. Si son extrémité est marquée par'- la ligne profonde du
bord inférieur de la protubérance annulaire, on peut tout aussi bien
la placer ailleurs. Cette ligne profonde (le collet de Chaussier), n’existe