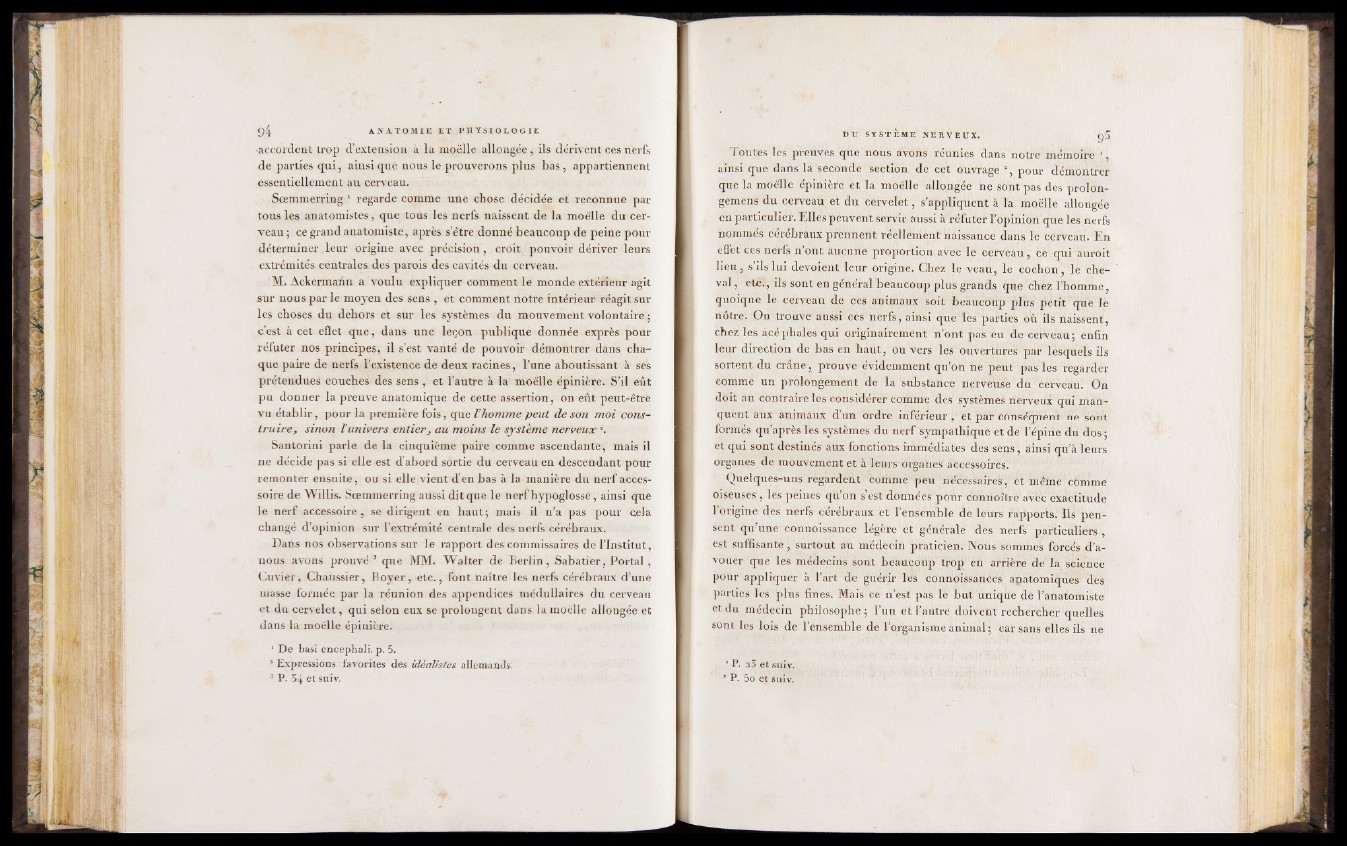
•accordent trop d’extension à la moelle allongée, ils dérivent ces nerfs
de parties qui, ainsi que nous le prouverons plus bas, appartiennent
essentiellement au cerveau.
Soemmerring * regarde comme une chose décidée et reconnue par
tous les anatomistes, que tous les nerfs naissent de la moelle du cerveau;
ce grand anatomiste, après s’être donné beaucoup de peine pour
déterminer leur origine avec précision, croit pouvoir dériver leurs
extrémités centrales des parois des cavités du cerveau.
M. Ackermann a voulu expliquer comment le monde extérieur agit
sur nous par le moyen des sens , et comment notre intérieur réagit sur
les choses du dehors et sur les systèmes du mouvement volontaire ;
c’est à cet effet que, dans une leçon publique donnée exprès pour
réfuter nos principes, il s’est vanté de pouvoir démontrer dans chaque
paire de nerfs l’existence de deux racines, l’une aboutissant à ses
prétendues couches des sens , et l’autre à la moelle épinière. S’il eût
pu donner la preuve anatomique de cette assertion, on eut peut-être
vu établir, pour la première fois, que l’homme peut de son moi construire,
sinon l’univers entier, au moins le système nerveuse *.
Santorini parle de la cinquième paire comme ascendante, mais il
ne décide pas si elle est d abord sortie du cerveau en descendant pour
remonter ensuite, ou si elle vient d’en bas à la manière du nerf accessoire
de Willis. Soemmerring aussi dit que le nerf hypoglosse, ainsi que
le nerf accessoire, se dirigent en haut; mais il n’a pas pour cela
changé d’opinion sur l’extrémité centrale des nerfs cérébraux.
Dans nos observations sur le rapport des commissaires de l’Institut,
nous avons prouvé’ que MM. Walter de Berlin, Sabatier, Portai,
Cuvier, Chaüssier, Boyer, etc., font naître les nerfs cérébraux d’une
masse formée par la réunion des appendices médullaires du cerveau
et du cervelet, qui selon eux se prolongent dans la moëlle allongée et
dans la moëlle épinière.
' De basi encephali. p. 5.
* Expressions favorites des idéalistes allemands.
’ P. 34 et suiv.
Toutes les preuves que nous avons réunies dans notre mémoire ‘ ,
ainsi que dans la seconde section de cet ouvrage *, pour démontrer
que la moelle épinière et la moëlle allongée ne sont pas des prolon-
gemens du cerveau et du cervelet, s’appliquent à la moëlle allongée
en particulier. Elles peuvent servir aussi à: réfuter l ’opinion que les nerfs
nommés cérébraux prennent réellement naissance dans le cerveau. En
effet ces nerfs n ont aucune proportion avec le cerveau, ce qui auroit
lieu, s’ils lui dévoient leur origine. Chez le veau, le cochon, le cheval
, etc., ils sont en général beaucoup plus grands que chez l’homme,
quoique le cerveau de ces animaux soit beaucoup plus petit que le
nôtre. On trouve aussi ces nerfs, ainsi que les parties où ils naissent,
chez les acéphales qui originairement n’ont pas eu de cerveau; enfin
leur direction de,bas en haut, ou vers les ouvertures par lesquels ils
sortent du crâne, prouve évidemment qu’on ne peut pas les regarder
comme un prolongement de la substance nerveuse du cerveau. On
doit au contraire les considérer comme des systèmeâ nerveux qui manquent
aux animaux d’un ordre inférieur , et par conséquent ne sont
formés qu’après les systèmes du nerf sympathique et de l’épine du dos ;
et qui sont destinés aux fonctions immédiates des sens, ainsi qu’à leurs
organes de mouvement et à leurs organes accessoires.
Quelques-uns regardent comme peu nécessaires, èt même cômme
oiseuses, les peines qu’on s’est données pour connoîtrè avec exactitude
1 origine des nerfs cérébraux et l’ensemble de leurs rapports. Ils pensent
qu’une connoissance légère et générale des nerfs particuliers ,
est suffisante, surtout au médecin praticien. Nous sommes forcés d’avouer
que les médecins sont beaucoup trop en arrière de la science
pour appliquer à l’art de guérir les connoissances anatomiques des
parties les plus fines. Mais ce n’est pas le but unique de l’anatomiste
et du médecin philosophe ; l’un et l’autre doivent rechercher quelles
sont les lois de l’ensemble de l’organisme animal ; car sans elles ils ne
1 P. s 5 et suiv.
* P. 5o et suiv.