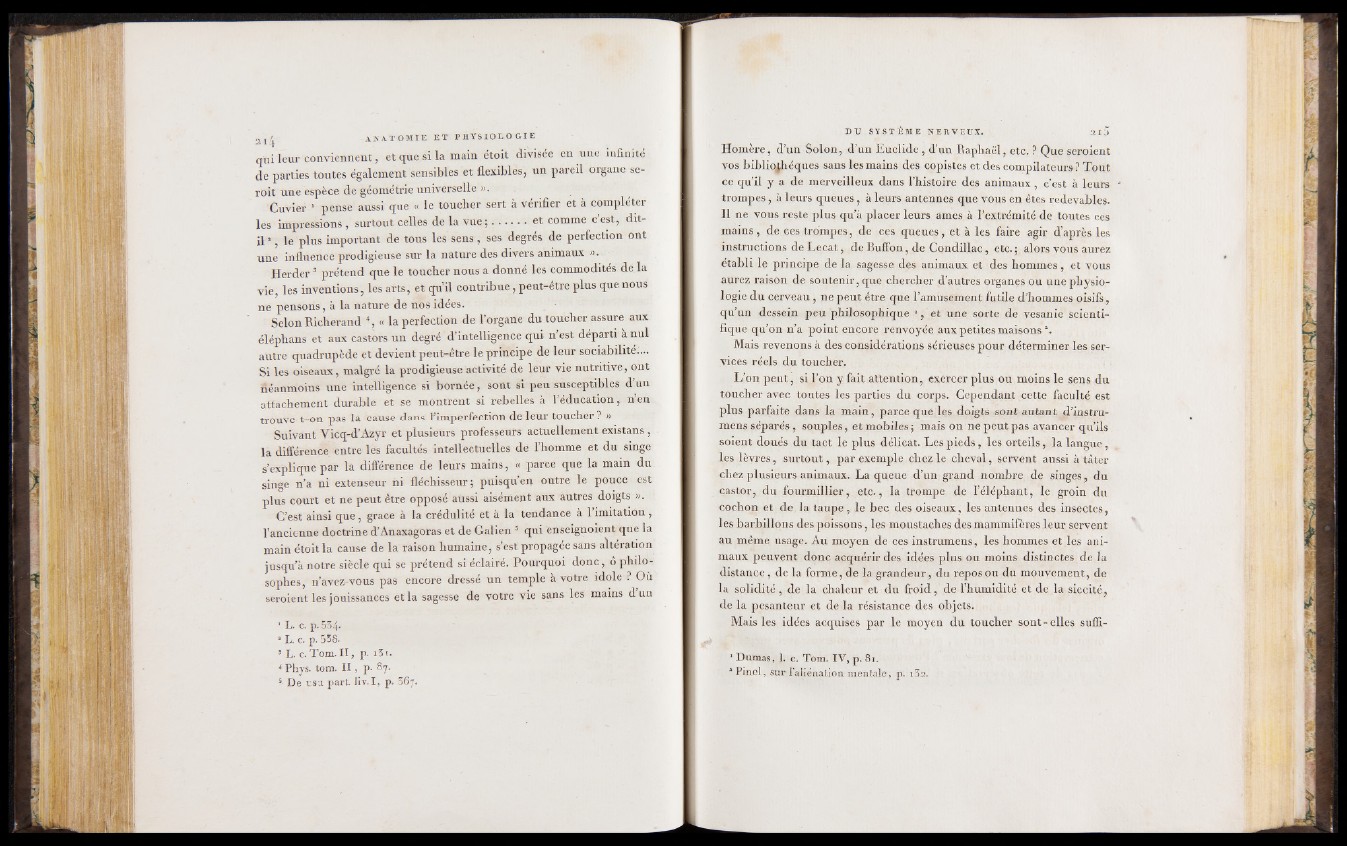
21/j^ anatomi e et phys io logi e
qui leur conviennent, et que si la main étoit divisée en une infinité
de parties toutes également sensibles et flexibles, un pareil organe seroit
une espèce de géométrie universelle ».
Cuvier * pense aussi que « le toucher sert à vérifier et à compléter
les impressions , surtout celles de la v u e ; .......... et comme c’est, ditil
*, le plus important de tous les sens, ses degrés de perfection ont
une influence prodigieuse sur la nature des divers animaux ».. ■
Herder 1 * 3 prétend que le toucher nous a donné les commodités de la
vie, les inventions, les arts, et qu’il contribue, peut-être plus que nous
ne pensons, à la nature de nos idées.
Selon Richerand 4, « la perfection de l’organe du toucher assure aux
éléphans et aux castors un degré d’intelligence qui n’est départi à nul
autre quadrupède et devient peut-être le principe de leur sociabilité....
Si les oiseaux, malgré la prodigieuse activité de leur vie nutritive, ont
Néanmoins une intelligence si bornée, sont si peu susceptibles d’un
attachement durable et se montrent si rebelles à l ’éducation, n’en
trouve-t-on pas la cause dans l’imperfection de leur toucher ? »
Suivant Vicq-d’Azyr et plusieurs professeurs actuellement existans ,
la différence entre les facultés intellectuelles de l’homme et du singe
s’explique par la différence de leurs mains, « parce que la main du
singe n’a ni extenseur ni fléchisseur; puisqu’en outre le pouce est
plus court et ne peut être opposé aussi aisément aux autres doigts ».
C’est ainsi que, grâce à la crédulité et à la tendance a 1 imitation ,
l’ancienne doctrine d’Anaxagoras et de Galien 5 qui enseignoient que la
main étoit la cause de la raison humaine, s’est propagée sans altération
jusqu’à notre siècle qui se prétend si éclairé. Pourquoi donc, o philosophes,
n’avez-vous pas encore dressé un temple à votre idole ? Où
seroient les jouissances et la sagesse de votre vie sans les mains dun
1 L. c. p. 534*
* L. c. p. 558.
| L. c. Tom. II, p. i3t.
4 Phys. tom. I I , p. 87.
5 De us 11 part liv. I, p. 367.
DU SYSTÈME NERVEUX.
Homère, d’un Solon, d’un Euclide, d’un Raphaël, etc. ? Que seroient
vos bibliothèques sans les mains des copistes et des compilateurs? Tout
ce qu’il y a de merveilleux dans l’histoire des animaux, c’est à leurs
trompes, à leurs queues, à leurs antennes que vous en êtes redevables.
11 ne vous reste plus qu’à placer leurs âmes à l’extrémité de toutes ces
mains, de ces trompes, de ces queues, et à les faire agir d’après les
instructions de Lecat, de Buffon, de Condillac, etc. ; alors vous aurez
établi le principe de la sagesse des animaux et des hommes, et vous
aurez raison de soutenir, que chercher d’autres organes ou une physiologie
du cerveau , ne peut être que l’amusement futile d'hommes oisifs,
qu’un dessein peu philosophique 1, et une sorte de vesanie scientifique
qu’on n’a point encore renvoyée aux petites maisons \
Mais revenons à des considérations sérieuses pour déterminer les services
réels du toucher.
L ’on peut, si l’on y fait attention, exercer plus ou moins le sens du
toucher avec toutes les parties du corps. Cependant cette faculté est
plus parfaite dans la main, parce que les doigts sont autant d’instru-
mens séparés, souples, et mobiles; mais on ne peut pas avancer qu’ils
soient doués du tact le plus délicat. Les pieds, les orteils, la langue,
les lèvres, surtout, par exemple chez le cheval, servent aussi à tâter
chez plusieurs animaux. La queue d’un grand nombre de singes, du
castor, du fourmillier, etc., la trompe de l’éléphant, le groin du
cochon et de la taupe, le bec des oiseaux, les antennes des insectes
les barbillons des poissons, les moustaches des mammifères leur servent
au même usage. Au moyen de ces instrumens, les hommes et les animaux
peuvent donc acquérir des idées plus ou moins distinctes de la
distance, de la forme, de la grandeur, du repos ou du mouvement, de
la solidité , de la chaleur et du froid, de l’humidité et de la siccité,
de la pesanteur et de la résistance des objets.
Mais les idées acquises par le moyen du toucher sont-elles suffi-
1 Dumas, 1. c. Tom. IV, p. 8i.
“Pinel, sur l’aliénation mentale, p. i3n.