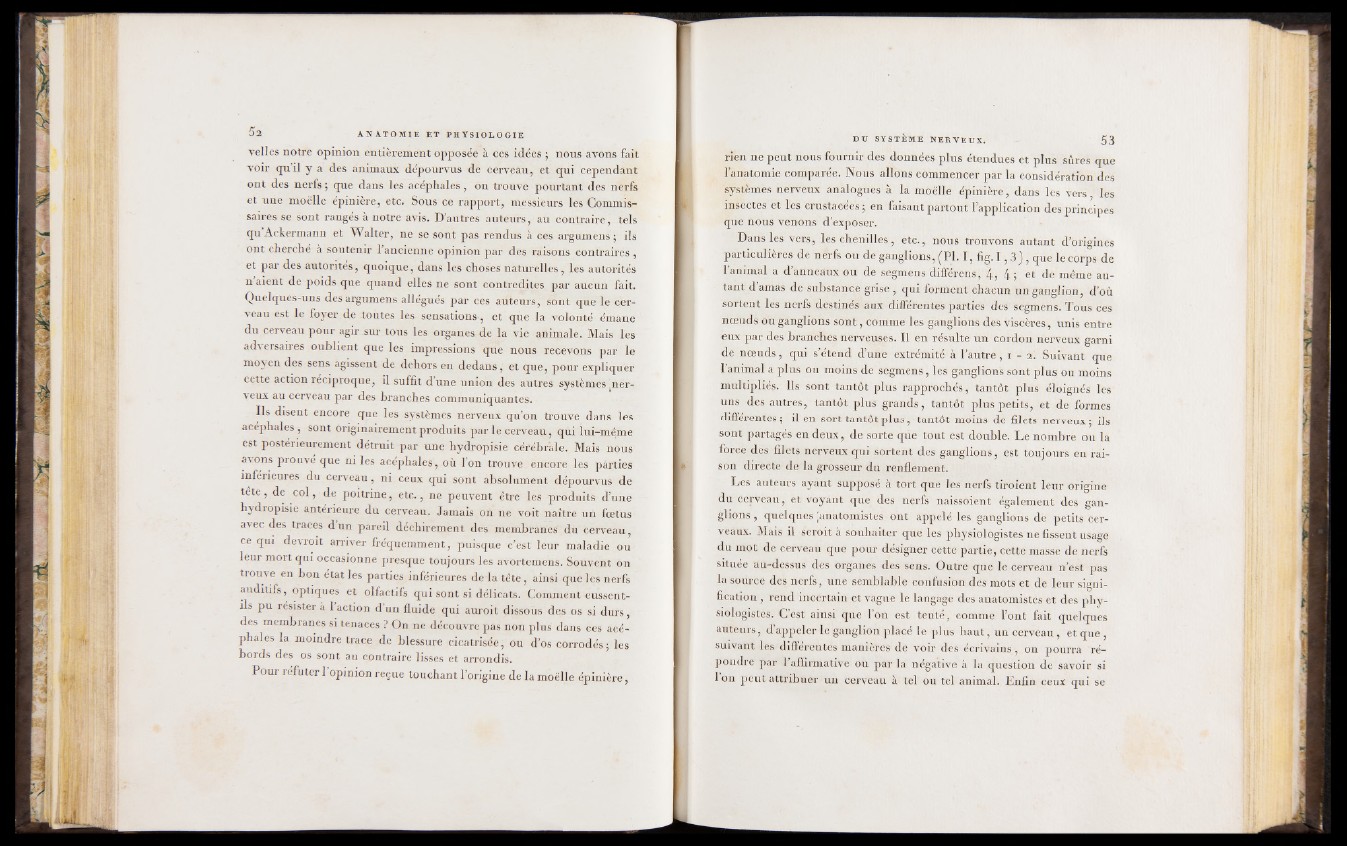
velles notre opinion entièrement opposée à ces idées ; nous ayons fait
voir qu’il y a des animaux dépourvus de cerveau, et qui cependant
ont des nerfs ; que dans les acéphales, on trouve pourtant des nerfs
et une moelle épinière, etc. Sous ce rapport, messieurs les Commissaires
se sont rangés à notre avis. D’autres auteurs, au contraire, tels
qu’Ackermann et Walter, ne se sont pas rendus à ces argumens ; ils
ont cherché à soutenir l’ancienne opinion par dès raisons contraires ,
et par des autorités, quoique, dans les choses naturelles, les autorités
n aient de poids que quand elles ne sont contredites par aucun fait.
Quelques-uns des argumens allégués par ces auteurs, sont que le cerveau
est le foyer de toutes les sensations-, et que la volonté émane
du cerveau pour agir sur tous les organes de la vie animale. Mais les
adversaires oublient que les impressions que nous recevons par le
moyen des sens agissent de dehors en dedans, et que, pour expliquer
cette action réciproque, il suffit d’une union des autres systèmes ^nerveux
au cerveau par des branches communiquantes.
Ils disent encore que les systèmes nerveux qu’on trouve dans les
acéphales, sont originairement produits par le cerveau, qui lui-mçme
est postérieurement détruit par une hydropisie cérébrale. Mais nous
avons prouve que ni les acéphales, où l’on trouve encore les parties
inférieures du cerveau , ni ceux qui sont absolument dépourvus de
tête, de co l, de poitrine, etc., ne peuvent être les produits d’une
hydropisie antérieure du cerveau. Jamais on ne voit naître un foetus
avec des traces d un pareil déchirement des membranes du cerveau,
ce qui devroit arriver fréquemment, puisque c’est leur maladie ou
leur mort qui occasionne presque toujours les avortemens. Souvent on
trouve en bon état les parties inférieures de la tête, ainsi que les nerfs
auditifs, optiques et olfactifs qui sont si délicats. Comment eussent-
ils pu résister à 1 action d’un fluide qui auroit dissous des os si durs,
des membranes si tenaces ? On ne découvre pas non plus dans ces acéphales
la moindre trace de blessure cicatrisée, ou d’os corrodés ; les
bords des os sont au contraire lisses et arrondis.
Pour réfuter 1 opinion reçue touchant l ’origine de la moelle épinière,
sUnuL
rien ne peut nous fournir des données plus étendues et plus sûres que
l’anatomie comparée. Nous allons commencer par la considération des
systèmes nerveux analogues à la moelle épinière, dans les vers, les
insectes et les crustacées ; en faisant partout l’application des principes
que nous venons d’exposer.
Dans les vers, les chenilles, etc., nous trouvons autant d’origines
particulières de nerfs ou de ganglions, (PL I , fig. 1, 3) , que le corps de
1 animal a d anneaux ou de ségmens différens, 4, 4 5 et de même autant
d’amas de substance grise , qui forment chacun un ganglion, d’où
sortent les nerfs destinés aux différentes parties des segmens. Tous ces
noeuds ou ganglions sont, comme les ganglions des viscères, unis entre
eux par des branches nerveuses. Il en résulte un cordon nerveux garni
de noeuds, qui s’étend d’une extrémité à l’autre , i - a. Suivant que
l’animal a plus ou moins de segmens, les ganglions sont plus ou moins
multipliés. Ils sont tantôt plus rapprochés, tantôt plus éloignés les
uns des autres, tantôt plus grands, tantôt plus petits, et de formes
differentes ; il en sort tantôt plus, tantôt moins de filets nerveux ; ils
sont partagés en deux, de sorte que tout est double. Le nombre ou la
force des filets nerveux qui sortent des ganglions, est toujours en raison
directe de la grosseur du renflement.
Les auteurs ayant supposé à tort que les nerfs tiroient leur origine
du cerveau, et voyant que des nerfs naissoient également des ganglions
, quelques 'anatomistes ont appelé les ganglions de petits cerveaux.
Mais il seroit à souhaiter que les physiologistes ne fissent usage
du mot de cerveau que pour désigner cette partie, cette masse de nerfs
située au-dessus des organes des sens. Outre que le cerveau n’est pas
la source des nerfs, une semblable confusion des mots et de leur signification
, rend incertain et vague le langage des anatomistes et des physiologistes.
C’est ainsi que l’on est tenté, comme l’ont fait quelques
auteurs, d’appeler le ganglion placé le plus haut, un cerveau, et que ,
suivant les différentes manières de voir des écrivains, on pourra répondre
par 1 affirmative ou par la négative à la question de savoir si
1 on peut attribuer un cerveau à tel ou tel animal. Enfin ceux qui se