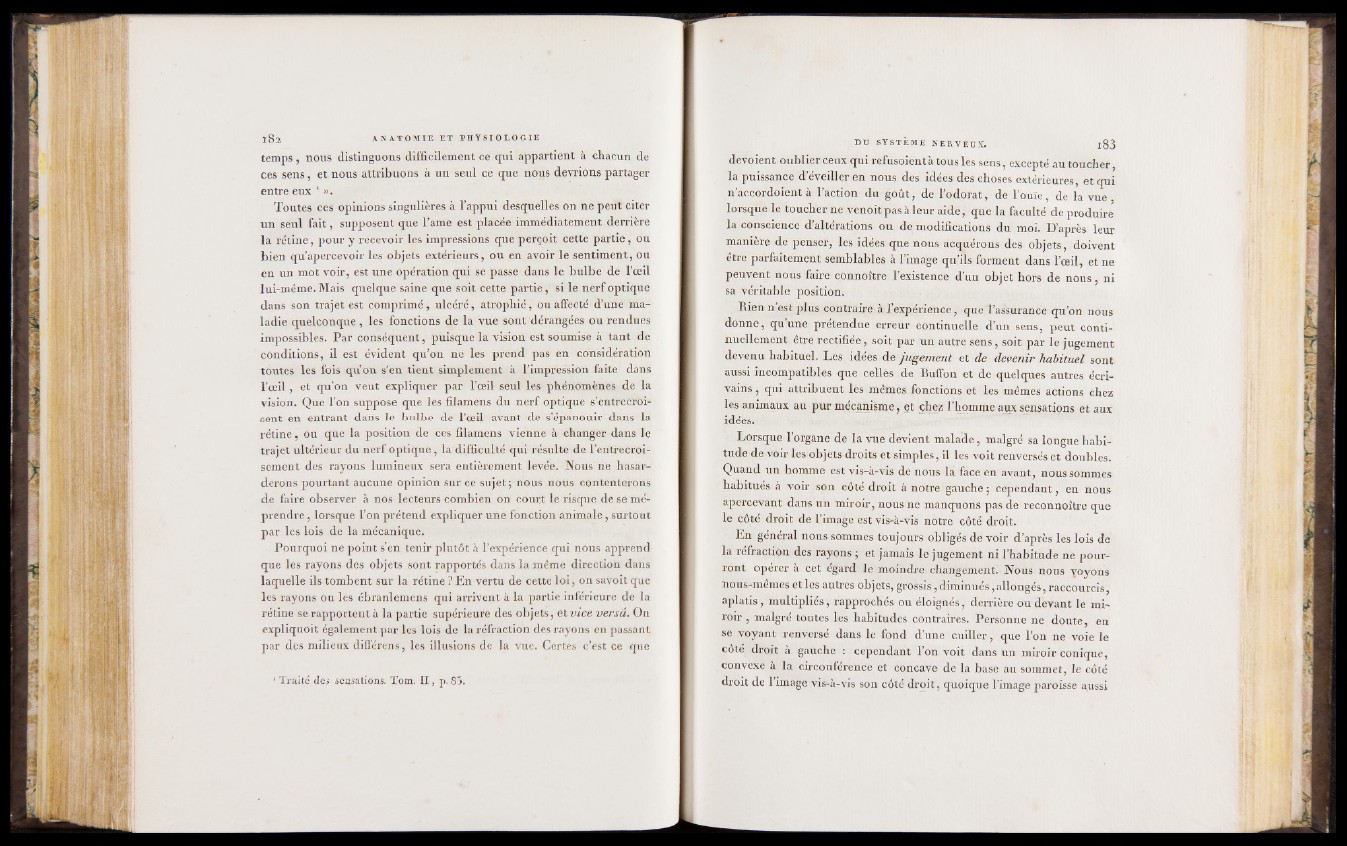
temps, nous distinguons difficilement ce qui appartient à chacun de
ces sens, et nous attribuons à un seul ce que nous devrions partager
entre eux 1 ».
Toutes ces opinions singulières à l’appui desquelles on ne peut citer
un seul fait, supposent que l’ame est placée immédiatement derrière
la rétine, pour y recevoir les impressions que perçoit cette partie, ou
bien qu’apercevoir les objets extérieurs, ou eu avoir le sentiment, ou
en un mot voir, est une opération qui se passe dans le bulbe de l’oeil
lui-méme. Mais quelque saine que soit cette partie, si le nerf optique
dans son trajet est comprimé, ulcéré, atrophié, ou affecté d’une maladie
quelconque, les fonctions de la vue sont dérangées ou rendues
impossibles. Par conséquent, puisque la vision est soumise à tant de
conditions, il est évident qu’on ne les prend pas en considération
toutes les fois qu’on s’en tient simplement à l’impression faite dans
l’ceil , et qu’on veut expliquer par l’oeil seul les phénomènes de la
vision. Que l’on suppose que les filamens du nerf optique s’entrecroisent
en entrant dans le bulbe de l’oeil avant de s’épanouir dans la
rétine, ou que la position de ces filamens vienne à changer dans le
trajet ultérieur du nerf optique, la difficulté qui résulte de l’entrecroisement
des rayons lumineux sera entièrement levée. Nous ne hasarderons
pourtant aucune opinion sur ce sujet; nous nous contenterons
de faire observer à nos lecteurs combien on court le risque de se méprendre
, lorsque l’on prétend expliquer une fonction animale, surtout
par les lois de la mécanique.
Pourquoi ne point s’en tenir plutôt à l’expérience qui nous apprend
que les rayons des objets sont rapportés dans la même direction dans
laquelle ils tombent sur la rétine ? En vertu de cette lo i, on savoit que
les rayons ou les ébranlemens qui arrivent à la partie inférieure de la
rétine se rapportent à la partie supérieure des objets, et vice versa. On
expliquoit également par les lois de la réfraction des rayons en passant
par des milieux différens, les illusions de la vue. Certes c’est ce que
Traité des sensations. Tom. II, p. 83.
dévoient oublier ceux qui refusoient a tous les sens, excepté au toucher
la puissance d’éveiller en nous des idées des choses extérieures, et qui
n’accordoient à l’action du goût, de l’odorat, de l’ouïe, de la vue
lorsque le toucher ne venoit pas à leur aide, que la faculté de produire
la conscience d’altérations ou de modifications du moi. D’après leur
manière de penser, les idées que nous acquérons des objets, doivent
etre parfaitement semblables à l’image qu’ils forment dans l’oeil, et ne
peuvent nous faire connoître l’existence d’un objet hors de nous, ni
sa véritable position.
Rien n est plus contraire à l’expérience, que d’assurance qu’on nous
donne, quune prétendue erreur continuelle d’un sens, peut continuellement
être rectifiée, soit par un autre sens, soit par le jugement
devenu habituel. Les idées de jugement et de devenir habituel sont
aussi incompatibles que celles de Buffon et de quelques autres écrivains
, qui attribuent les mêmes fonctions et les mêmes actions chez
les animaux au pur mécanismeI çt chez l’homme aux sensations et aux
idées.
Lorsque l’organe de la vue devient malade, malgré sa longue habitude
de voir les objets droits et simples, il les voit renversés et doubles.
Quand un homme est vis-à-vis de nous la face en avant, nous sommes
habitués à voir son côté droit à notre gauche; cependant, en nous
apercevant dans un miroir, nous ne manquons pas de reconnoitre que
le côté droit de l’image est vis-à-vis notre côté droit.
En general nous sommes toujours obligés de voir d’après les lois de
la réfraction des rayons ; et jamais le jugement ni l’habitude ne pourront
operer à cet égard le moindre changement. Nous nous yoyons
nous-mêmes et les autres objets, grossis, diminués,allongés, raccourcis
aplatis, multipliés, rapprochés ou éloignés, derrière ou devant le miroir
, malgré toutes les habitudes contraires. Personne ne doute, en
se voyant renversé dans le fond d’une cuiller, que l’on ne voie le
côté droit à gauche : cependant l’on voit dans un miroir conique,
convexe a la circonférence et concave de la base au sommet, le côté
droit de 1 image vis-à-vis son côté droit, quoique l’image paroisse aussi