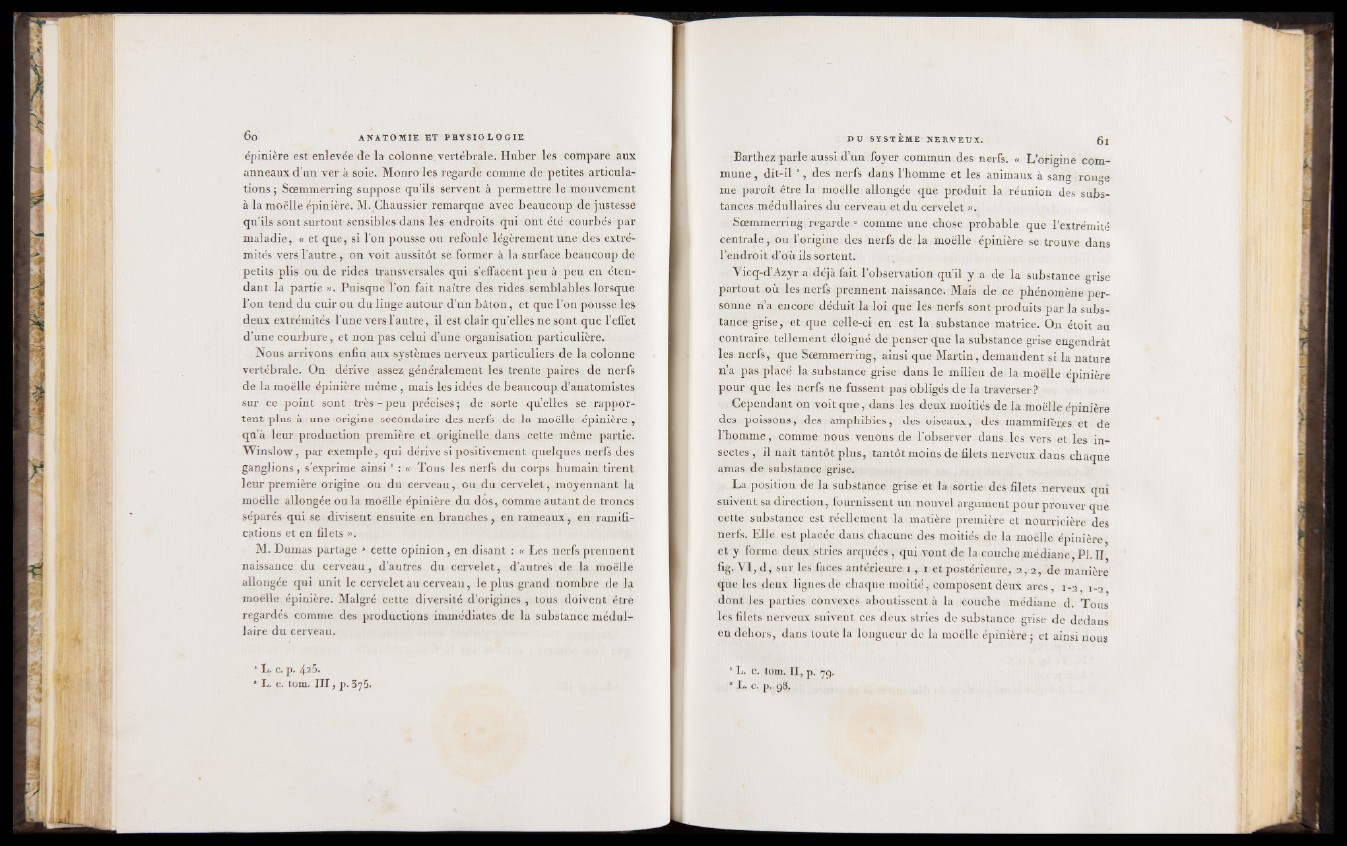
épinière est enlevée de la colonne, vertébrale. Huber les compare aux
anneaux d’un ver à soie. Monro les regarde comme de petites articulations
; Scemmerring suppose qu’ils servent à permettre le mouvement
à la moelle épinière. M. Chaussier remarque avec beaucoup de justesse
qu’ils sont surtout sensibles dans les endroits qui ont été courbés par
maladie, « et que, si l’on pousse ou refoule légèrement une des extrémités
vers l’autre , on voit aussitôt se former à la surface beaucoup de
petits plis ou de rides transversales qui s’elfacent peu à peu en étendant
la partie ». Puisque l’on fait naître des rides semblables lorsque
l’on tend du cuir ou du linge autour d’un bâton, et que l’on pousse les
deux extrémités l’une vers l’autre, il est clair qu’elles ne sont que l’elfet
d’une courbure, et non pas celui d’une organisation particulière.
Nous arrivons enfin aux systèmes nerveux particuliers de la colonne
vertébrale. On dérive assez généralement les trente paires . de nerfs
de la moelle épinière même , mais les idées de beaucoup d’anatomistes
sur ce point sont très-peu précises; de sorte quelles se rapportent
plus à une origine secondaire des nerfs de la moelle épinière ,
qu’à leur production première et originelle dans cette même partie.
Winslow, par exemple, qui dérive si positivement quelques nerfs des
ganglions, s’exprime ainsi ' : k T o u s les nerfs du corps humain tirent
leur première origine ou du cerveau, ou du cervelet, moyennant la
moelle allongée ou la moëlle épinière du dos, comme autant de troncs
séparés qui se divisent ensuite en branches, en rameaux, en ramifications
et en filets ».
M. Dumas partage » cette opinion, en disant : « Les nerfs prennent
naissance du cerveau, d’autres du cervelet, d’autres de la moëlle
allongée qui unit le cervelet au cerveau, le plus grand nombre de la
moëlle épinière. Malgré cette diversité d’origines , tous doivent être
regardés comme des productions immédiates de la substance médullaire
du cerveau.
* L. c. p. 425-
* L. c. tom. III, p. 3^5.
Barthez parle aussi d’un foyer commun des nerfs. « L ’origine commune
, dit-il *, des nerfs dans l’homme et les animaux à sang rouge
me paroît être la moëlle allongée que produit la réunion des substances
médullaires du cerveau et du cervelet ».
Scemmerring regarde * comme une chose probable que l’extrémité
centrale, ou l’origine des nerfs de la moëlle épinière se trouve dans
l’endroit d’où ils sortent.
Vicq-d’Azyr a déjà fait l’observation qu’il ÿ a de la substance grise
partout où les nerfs prennent naissance. Mais de ce phénomène personne
n’a encore déduit la loi que les nerfs sont produits par la substance
grise, et que celle-ci en est la substance matrice. On étoit au
contraire tellement éloigné de penser que la substance grise engendrât
les nerfs, que Scemmerring, ainsi que Martin, demandent si la nature
n’a pas placé la substance grise dans le milieu de la moëlle épinière
pour que les nerfs ne fussent pas obligés de la traverser?
Cependant on voit que, dans les deux moitiés de la moëlle épinière
des poissons, des amphibies, des oiseaux, des mammifères et de
l’homme, comme nous venons de l’observer dans les vers et les insectes
, il naît tantôt plus, tantôt moins de filets nerveux dans chaque
amas de substance grise.
La position de la substance grise et la sortie des filets nerveux qui
suivent sa direction, fournissent un nouvel argument pour prouver que
cette substance est réellement la matière première et nourricière des
nerfs. Elle est placée dans chacune des moitiés de la moëlle épinière
et y forme deux stries arquées, qui vont de la couche médiane PL II
fig. VI, dj sur les faces antérieure; i , i et postérieure, 2 ,2 , de manière
que les deux lignes de chaque moitié, composent deux arcs 1-2 1-2
dont les parties convexes aboutissent à la couche médiane d. Tous
les filets nerveux suivent ces deux stries de substance grise de dedans
en dehors, dans toute la longueur de la moëlle épinière ; et ainsi nous
‘ L. c. tom. II, p. yg.
• L. c. p. 98.