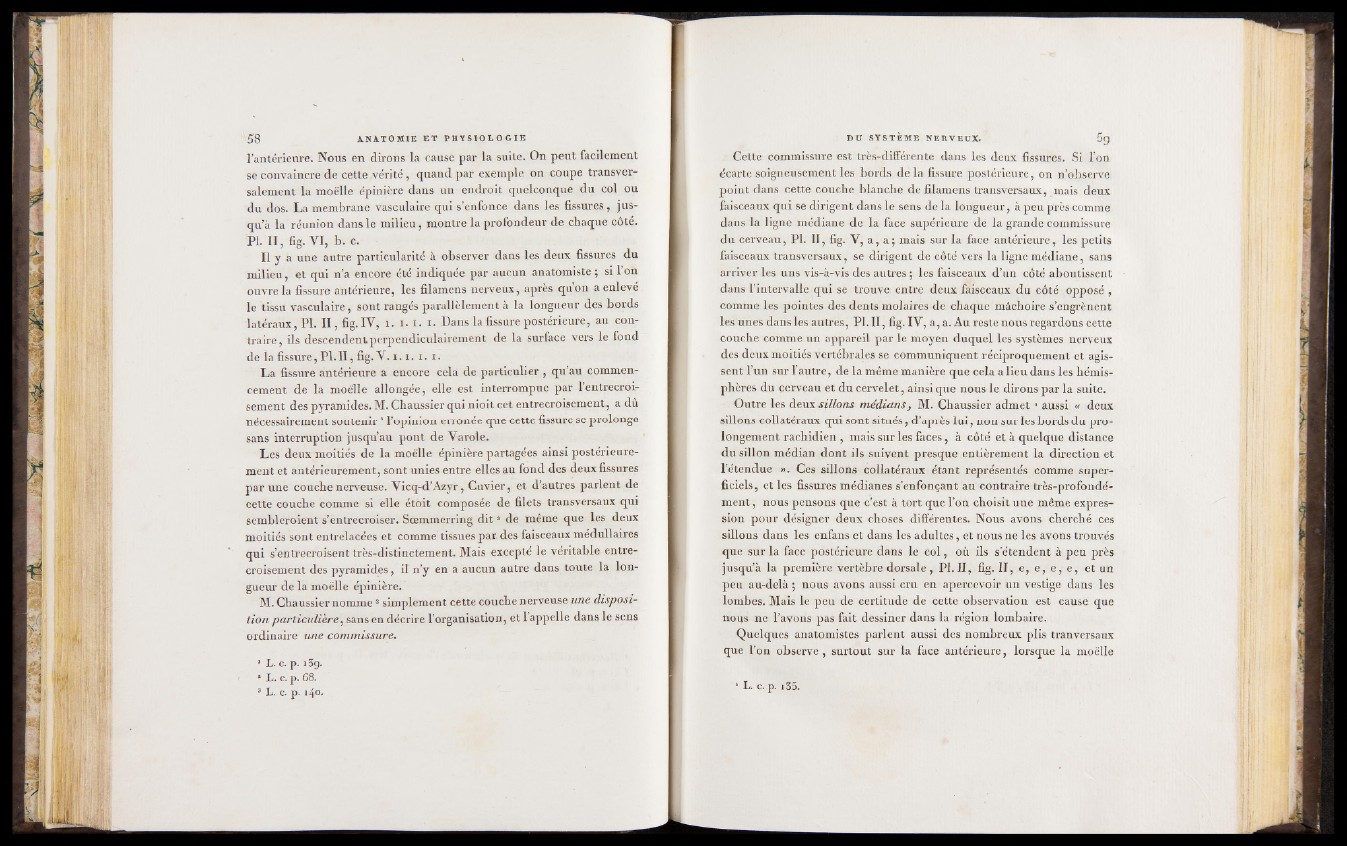
l’antérieure. Nous en dirons la cause par la suite. On peut facilement
se convaincre de cette vérité , quand par exemple on coupe transversalement
la moëlle épinière dans un endroit quelconque du col ou
du dos. La membrane vasculaire qui s’enfonce dans les fissures , jusqu’à
la réunion dans le milieu, montre la profondeur de chaque côté.
PI. II , fig.YI, b. c.
Il y a une autre particularité à observer dans les deux fissures du
milieu, et qui n’a encore été indiquée par aucun anatomiste ; si l’on
ouvre la fissure antérieure, les filamens nerveux, après quon a enleve
le tissu vasculaire, sont rangés parallèlement à la longueur des bords
latéraux, PI. I I , fig. IV, 1. i. i. i. Dans la fissure postérieure, au contraire,
ils descendent perpendiculairement de la surface vers le fond
de la fissure, PI. I I , fig. V. i . i . i . i .
La fissure antérieure a encore cela de particulier , qu’au commencement
de la moelle allongée, elle est interrompue par l’entrecroisement
des pyramides. M. Chaussier qui nioit cet entrecroisement, a dû
nécessairement soutenir * l’opinion erronée que cette fissure se prolonge
sans interruption jusqu’au pont de Varole.
Les deux moitiés de la moelle épinière partagées ainsi postérieurement
et antérieurement, sont unies entre elles au fond des deux fissures
par une couche nerveuse. Vicq-d’Azyr, Cuvier, et d’autres parlent de
cette couche comme si elle étoit composée de filets transversaux qui
sembleroient s’entrecroiser. Scemmerring dit * de même que les deux
moitiés sont entrelacées et comme tissues par. des faisceaux médullaires
qui s’entrecroisent très-distinctement. Mais excepté le véritable entrecroisement
des pyramides, il n’y en a aucun autre dans toute la longueur
de la moëlle épinière.
M. Chaussier nomme 3 simplement cette couche nerveuse une disposition
particulière, sans en décrire l’organisation, et l ’appelle dans le sens
ordinaire une commissure.
* L. c. p. 13g.
* L. c. p. 68.
3 L. c. p. î^o.
Cette commissure est très-différente dans les deux fissures. Si l’on
écarte soigneusement les bords dé la fissure postérieure, on n’observe
point dans cette couche blanche de filamens transversaux, mais deux
faisceaux qui se dirigent dans le sens de la longueur, à peu près comme
dans la ligne médiane de la face supérieure de la grande commissure
du cerveau, PL II, fig. V, a, a; mais sur la face antérieure, les petits
faisceaux transversaux, se dirigent de côté vers la ligne médiane, sans
arriver les uns vis-à-vis des autres ; les faisceaux d’un côté aboutissent
dans l’intervalle qui se trouve entre deux faisceaux du côté opposé ,
comme les pointes des dents molaires de chaque mâchoire s’engrènent
les unes dans les autres, PL II, fig. IV, a, a. Au reste nous regardons cette
couche comme un appareil par le moyen duquel les systèmes nerveux
des deux moitiés vertébrales se communiquent réciproquement et agissent
l’un sur l’autre, de la même manière que cela a lieu dans les hémisphères
du cerveau et du cervelet, ainsique nous le dirons par la suite.
Outre les deux sillons médians, M. Chaussier admet 1 aussi « deux
sillons collatéraux qui sont situés, d’après lui, non sur les bords du prolongement
rachidien , mais sur les faces, à côté et à quelque distance
du sillon médian dont ils suivent presque entièrement la direction et
l’étendue ». Ces sillons collatéraux étant représentés comme superficiels,
et les fissures médianes s’enfonçant au contraire très-profondément
, nous pensons que c’est à tort que l’on choisit une même expression
pour désigner deux choses différentes. Nous avons cherché ces
sillons dans les enfans et dans les adultes, et nous ne les avons trouvés
que sur la face postérieure dans le co l, où ils s’étendent à peu près
jusqu’à la première vertèbre dorsale, PI.II, fig. II, e, e, e, e, et un
peu au-delà ; nous avons aussi cru en apercevoir un vestige dans les
lombes. Mais le peu de certitude de cette observation est cause que
nous ne l’avons pas fait dessiner dans la région lombaire.
Quelques anatomistes parlent aussi des nombreux plis tranversaux
que l’on observe, surtout sur la face antérieure, lorsque la moëlle
‘ L. c. p. i35.