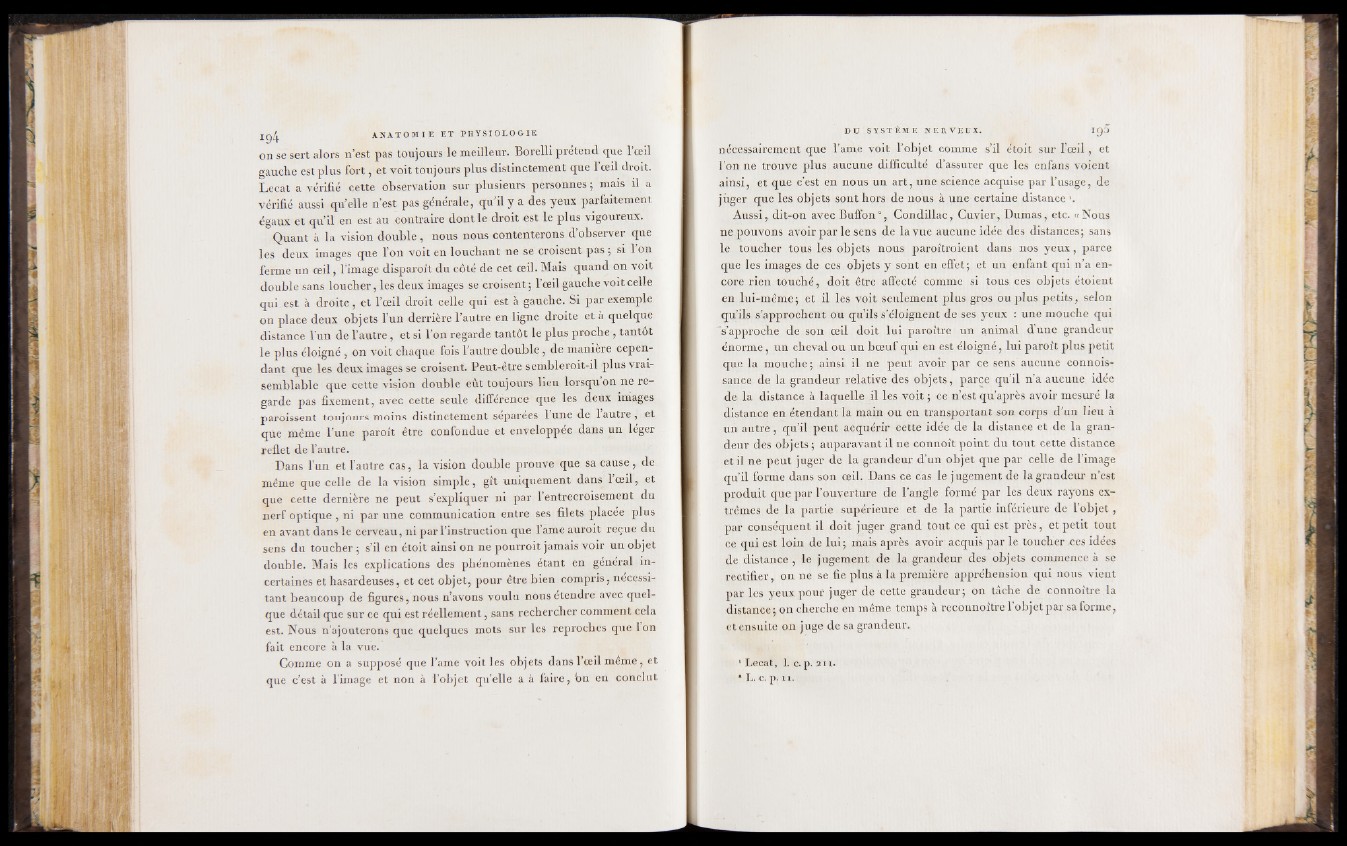
on se sert alors n’est pas toujours le meilleur. Borelli prétend que l’oeil
gauche est plus fort , et voit toujours plus distinctement que 1 oeil droit.
Lecat a vérifié cette observation sur plusieurs personnes ; mais il a
vérifié aussi quelle n’est pas générale, qu’il y a des yeux parfaitement
égaux et qu’il en est au contraire dont le droit est le plus vigoureux.
Quant à la vision double, nous nous contenterons d’observer que
les deux images que l’on voit en louchant ne se croisent pas ; si l’on
ferme un oeil, l’image disparoît du côté de cet oeil. Mais quand on voit
double sans loucher, les deux images se croisent ; l ’oeil gauche voit celle
qui est à droite, et l’oeil droit celle qui est à gauche. Si par exemple
on place deux objets l’un derrière l ’autre en ligne droite et à quelque
distance l ’un de l’autre, et si l’on regarde tantôt le plus proche , tantôt
le plus éloigné , on voit chaque fois l’autre double, de manière cependant
que les deux images se croisent. Peut-être sembleroit-il plus vraisemblable
que cette vision double eût toujours lieu lorsqu on ne regarde
pas fixement, avec cette seule différence que les deux images
paroissent toujours moins distinctement separees lune de 1 autre,net
que même l’une paroît être confondue et enveloppée dans un léger
reflet de l’autre.
Dans l’un et l’autre cas, la vision double prouve que sa cause,. de
même que celle de la vision simple, gît uniquement dans 1 oe il, et
que cette dernière ne peut s’expliquer ni par l’entrecroisement du
nerf optique , ni par une communication entre ses filets placée plus
en avant dans le cerveau, ni par l’instruction que l’ame auroit reçue du
sens du toucher ; s’il en étoit ainsi on ne pourroit jamais voir un objet
double. Mais les explications des phénomènes étant en général incertaines
et hasardeuses, et cet objet, pour être bien compris, nécessitant
beaucoup de figures, nous n’avons voulu nous étendre avec quelque
détail que sur ce qui est réellement, sans rechercher comment cela
est. Nous n’ajouterons que quelques mots sur les reproches que 1 on
fait encore à la vue.
Comme on a supposé que l’ame voit les objets dans l’oeil même, et
que c’est à l’image et non à l’objet qu’elle a à faire, bn en conclut
nécessairement que l’ame voit l ’objet comme s’il étoit sur l’oe il, et
l’on ne trouve plus aucune difficulté d’assurer que les enfans voient
ainsi, et que c’est en nous un art, une science acquise par l’usage, de
juger que les objets sont hors de nous à une certaine distance '.
Aussi, dit-on avec Buffon“, Condillac, Cuvier, Dumas, etc. «Nous
ne pouvons avoir par le sens de la vue aucune idée des distances; sans
le toucher tous les objets nous paroîtroient dans nos yeux, parce
que les images de ces objets y sont en effet; et un enfant qui n’a encore
rien touché, doit être affecté comme si tous ces objets étoient
en lui-même; et il les voit seulement plus gros ou plus petits, selon
qu’ils s’approchent ou qu’ils s’éloignent de ses yeux : une mouche qui
's’approche de son oeil doit lui paroître un animal d’une grandeur
énorme, un cheval ou un boeuf qui en est éloigné, lui paroît plus petit
que la mouche ; ainsi il ne peut avoir par ce sens aucune connois-
sance de la grandeur relative des objets, parce qu’il n’a aucune idée
de la distance à laquelle il les voit ; ce n’est qu’après avoir mesuré la
distance en étendant la main ou en transportant son corps d’un lieu à
un autre, qu’il peut acquérir cette idée de la distance et de la grandeur
des objets; auparavant il ne connoît point du tout cette distance
et il ne peut juger de la grandeur d’un objet que par celle de l’image
qu’il forme dans son oeil. Dans ce cas le jugement de la grandeur n’est
produit que par l’ouverture de l’angle formé par les deux rayons extrêmes
de la partie supérieure et de la partie inférieure de l’objet,
par conséquent il doit juger grand tout ce qui est près, et petit tout
ce qui est loin de lui; mais après avoir acquis par le toucher ces idées
de distance , le jugement de la grandeur des objets commence à se
rectifier, on ne se fie plus à la première appréhension qui nous vient
par les yeux pour juger de cette grandeur; on tâche de connoitre la
distance; on cherche en même temps à reconnoître l ’objet par sa forme,
et ensuite on juge de sa grandeur.
1 Lecat, I, c. p. 211.
* L. c. p. n.