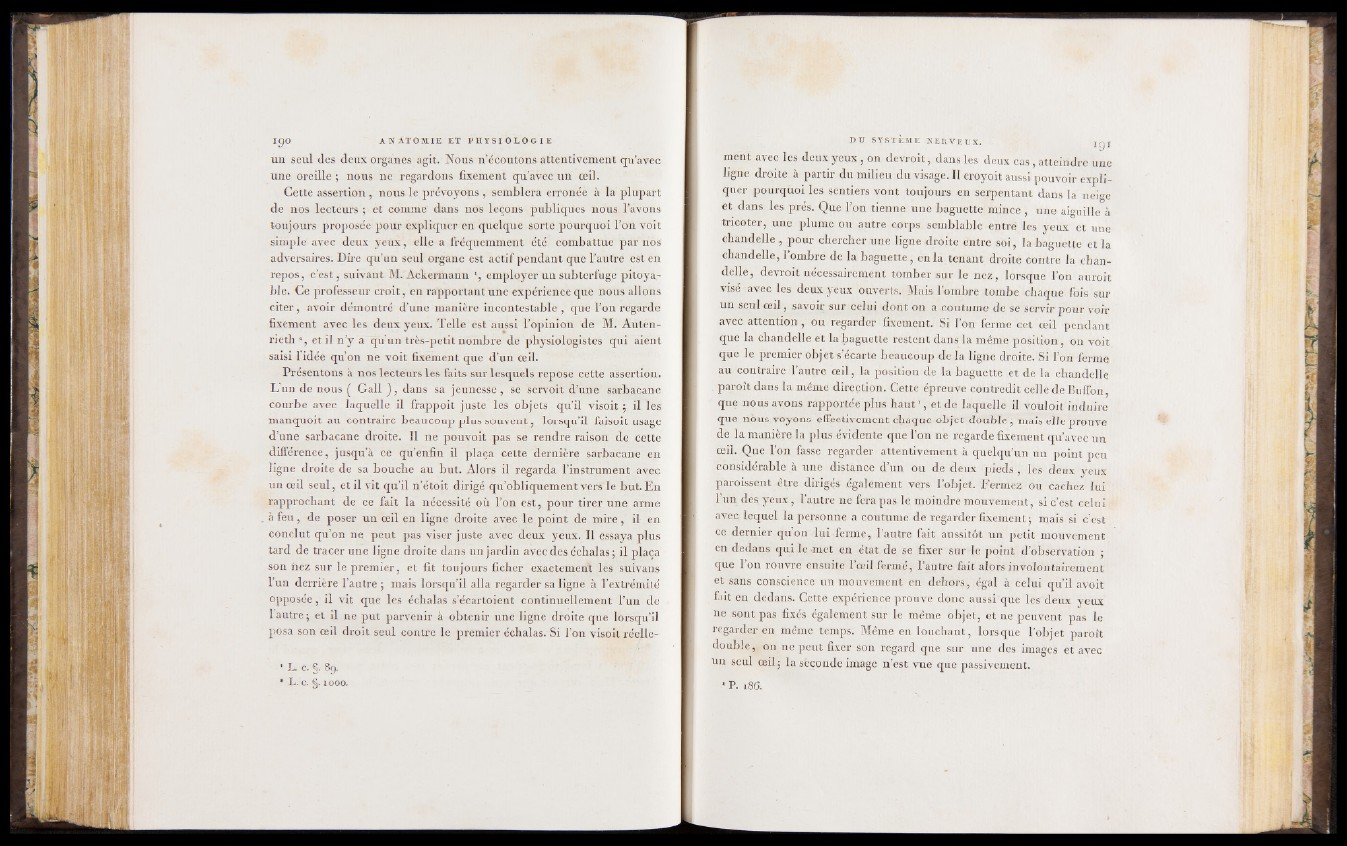
un seul des deux organes agit. Nous n’écoutons attentivement qu’avec
une oreille ; nous ne regardons fixement qu’avec un oeil.
Cette assertion, nous le prévoyons , semblera erronée à la plupart
de nos lecteurs ; et comme dans nos leçons publiques nous lavons
toujours proposée pour expliquer en quelque sorte pourquoi l’on voit
simple avec deux yeux, elle a fréquemment été combattue par nos
adversaires. Dire qu’un seul organe est actif pendant que l’autre est en
repos, c’est, suivant H. Ackermann ‘, employer un subterfuge pitoyable.
Ce professeur croit, en rapportant une expérience que nous allons
citer, avoir démontré d’une manière incontestable , que l’on regarde
fixement avec les deux yeux. Telle ést aussi l’opinion de M. Autèn-
rieth *, et il n’y a qu’un très-petit nombre de physiologistes qui aient
saisi l’idée qu’on ne voit fixement que d’un oeil.
Présentons à nos lecteurs les faits sur lesquels repose cette assertion.
L’un de nous ( Gall ) , dans sa jeunesse, sé servoit d’une sarbacane
courbe avec laquelle il frappoit juste les objets qu’il visoit ; il les
manquoit au contraire beaucoup plus souvent, lorsqu’il faisoit usage
d’une sarbacane droite. Il ne pouvoit pas se rendre raison de cette
différence, jusqu’à ce qu’enfin il plaça cette dernière sarbacane en
ligne droite de sa bouche au but. Alors il regarda l’instrument avec
un oeil seul, et il vit qu’il n’étoit dirigé qu’obliquement vers le but. En
rapprochant de ce fait la nécessité où l’on est, pour tirer une arme
à feu, de poser un oeil en ligne droite avec le point de mire, il en
conclut qu’on ne peut pas viser juste avec deux yeux. Il essaya plus
tard de tracer une ligne droite dans un jardin avec des échalas ; il plaça
son nez sur le premier, et fit toujours ficher exactement les suivans
l’un derrière l’autre ; mais lorsqu’il alla regarder sa ligne à l ’extrémité
opposée, il vit que les échalas s’écartoient continuellement l’un de
l’autre; et il ne put parvenir à obtenir une ligne droite que lorsqu’il
posa son oeil droit seul contre le premier échalas. Si l’on visoit rée.lle-
• L. c. §. 89.
* L. c. §. ioo a
ment avec les deux yeux, on devroit, dans les deux cas, atteindre une
ligne droite à partir du milieu duvisage.il croyoit aussi pouvoir expliquer
pourquoi les sentiers vont toujours en serpentant dans la neige
et dans les. prés. Que l’on tienne une baguette mince, une aiguille à
tricoter, une plume ou autre corps semblable entré les yeux et une
chandelle , pour chercher une ligne droite entre soi, la baguette et la
chandelle, l’ombre de la baguette, en la tenant droite contre la chandelle,
devroit nécessairement tomber sur le nez, lorsque l’on auroit
visé avec les deux yeux ouverts. Mais l’ombre tombe chaque fois sur
un seul oeil, savoir sur celui dont on a coutume de se servir pour voir
avec attention , ou regarder fixement. Si l’on ferme cet oeil pendant
que la chandelle et la baguette restent dans la même position, on voit
que le premier objet s’écarte beaucoup de la ligne droite. Si l’on ferme
au contraire l’autre oeil, la position de la baguette et de la chandelle
paroit dans la même direction. Cette épreuve contredit celle de Buffon
que nous avons rapportée plus haut *, et de laquelle il vouloit induire
que nous voyons effectivement chaque objet double; mais elle prouve
de la manière la plus évidente que l’on ne regarde fixement qu’avec un
oeil. Que l’on fasse regarder attentivement à quelqu’un un point peu
considérable à une distance d’un ou de deux pieds , les deux yeux
paroissent être dirigés également vers l ’objet. Fermez ou cachez lui
l’un des. yeux, l’autre ne fera pas le moindre mouvement, si c’est celui
avec lequel la personne a coutume de regarder fixement; mais si c’est
ce dernier qu’on lui ferme, l ’autre fait aussitôt un petit mouvement
en dedans qui le .met en état de se fixer sur le point d’observation ;
que l’on rouvre ensuite l ’oeil fermé, l ’autre fait alors involontairement
et sans conscience un mouvement en dehors , égal à celui qu’il avoit
fait en dedans. Cette expérience prouve donc aussi que les deux yeux
ne sont pas fixés également sur le même objet, et ne peuvent pas le
regarder en même temps. Même en louchant, lorsque l ’objet paroit
double, on ne peut fixer son regard que sur une des images et avec
un seul oeil ; la sêconde image n’est vue que passivement.
t P. 186.