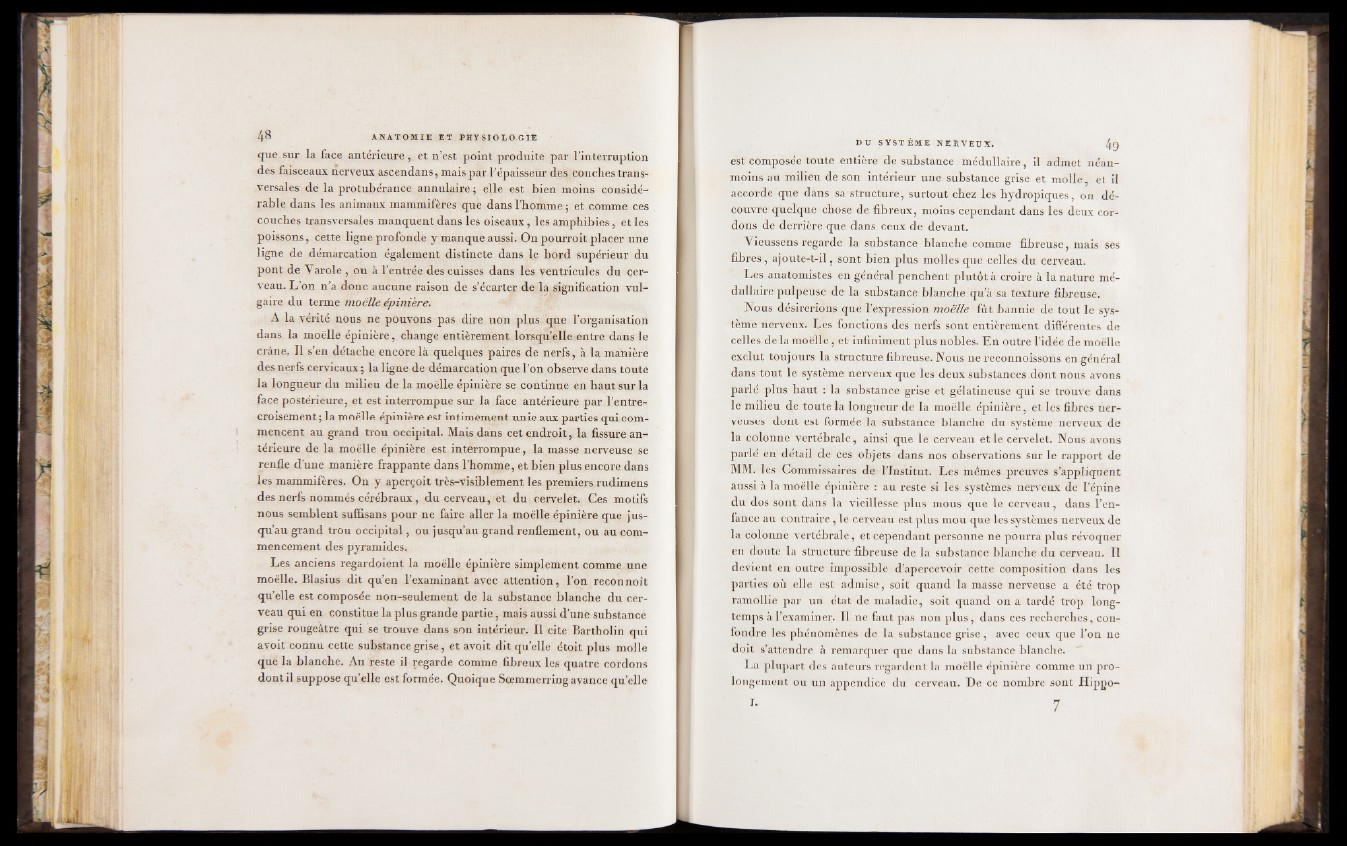
que sur la face antérieure, et n’est point produite par l’interruption
des faisceaux nerveux ascendans, mais par l’épaisseur des couches transversales
de la protubérance annulaire 5 elle est bien moins considérable
dans les animaux mammifères que dans l’homme ; et comme ces
couches transversales manquent dans les oiseaux, les amphibies, et les
poissons, cette ligne profonde y manque aussi. On pourroit placer une
ligne de démarcation également distincte dans le bord supérieur du
pont de Varole , ou à l’entrée des cuisses dans les ventricules du cerveau.
L ’on n’a donc aucune raison de s’écarter de la signification vulgaire
du terme moëlle épinière.
A la vérité nous ne pouvons pas dire non plus que l’organisation
dans la moëlle épinière, change entièrement lorsqu’elle entre dans le
crâne. Il s’en détache encore là quelques paires de nerfs, à la manière
des nerfs cervicaux ; la ligne de démarcation que l’on observe dans toute
la longueur du milieu de la moëlle épinière se continue en haut sur la
face postérieure, et est interrompue sur la face antérieure par l’entrecroisement
; la moëlle épinière est intimement unie aux parties qui commencent
au grand trou occipital. Mais dans cet endroit, la fissure antérieure
de la moëlle épinière est interrompue, la masse nerveuse se
renfle d’une manière frappante dans l’homme, et bien plus encore dans
les mammifères. On y aperçoit très-visiblement les premiers rudimens
des nerfs nommés cérébraux, du cerveau, et du cervelet. Ces motifs
nous semblent suffisans pour ne faire aller la moelle épinière que jusqu’au
grand trou occipital, ou jusqu’au grand renflement, ou au commencement
des pyramides.
Les anciens regardoient la moëlle épinière simplement comme une
moëlle. Blasius dit qu’en l’examinant avec attention, l’on reconnoît
qu’elle est composée non-seulement de la substance blanche du cerveau
qui en constitue la plus grande partie, mais aussi d’uné substance
grise rougeâtre qui se trouve dans son intérieur. Il cite Bartholin qui
avoit connu cette substance grise, et a voit dit quelle étoit plus molle
que la blanche. Au reste il regarde comme fibreux les quatre cordons
dont il suppose qu’elle est formée. Quoique Scemmerring avance qu’elle
est composée toute entière de substance médullaire, il admet néanmoins
au milieu de son intérieur une substance grise et molle et il
accorde que dans sa structure, surtout chez les hydropiques, on découvre
quelque chose de fibreux, moins cependant dans les deux cordons
de derrière que dans ceux de devant.
Vieussens regarde la substance blanche comme fibreuse, mais ses
fibres, ajoute-t-il, sont bien plus molles que celles du cerveau.
Les anatomistes en général penchent plutôt à croire à la nature médullaire
pulpeuse de la substance blanche qu’à sa texture fibreuse.
Nous désirerions que l’expression moëlle fût bannie de tout le système
nerveux. Les fonctions des nerfs sont entièrement différentes de
celles de la moëlle, et infiniment plus nobles. En outre l’idée de moëlle
exclut toujours la structure fibreuse. Nous ne reconnoissons en général
dans tout le système nerveux que les deux substances dont nous avons
parlé plus haut : la substance grise et gélatineuse qui se trouve dans
lé milieu de toute la longueur de la moëlle épinière, et les fibres nerveuses
dont est formée la substance blanche du système nerveux de
la colonne vertébrale, ainsi que le cerveau et le cervelet. Nous avons
parlé en détail de ces objets dans nos observations sur le rapport de
MM. les Commissaires de l ’Institut. Les mêmes preuves s’appliquent
aussi à la moëlle épinière : au reste si les systèmes nerveux de l’épine
du dos sont dans la vieillesse plus mous que le cerveau, dans l’enfance
au contraire, le cerveau est plus mou que les systèmes nerveux de
la colonne vertébrale, et cependant personne ne pourra plus révoquer
en doute la structure fibreuse de la substance blanche du cerveau. Il
devient en outre impossible d’apercevoir cette composition dans les
parties où elle est admise, soit quand la masse nerveuse a été trop
ramollie par un état de maladie, soit quand on a tardé trop longtemps
à l’examiner. Il ne faut pas non plus, dans ces recherches, confondre
les phénomènes de la substance grise, avec ceux que l ’on ne
doit s’attendre à remarquer que dans la substance blanche.
La plupart des auteurs regardent la moëlle épinière comme un prolongement
ou un appendice du cerveau. De ce nombre sont Hipgo-
1. 7