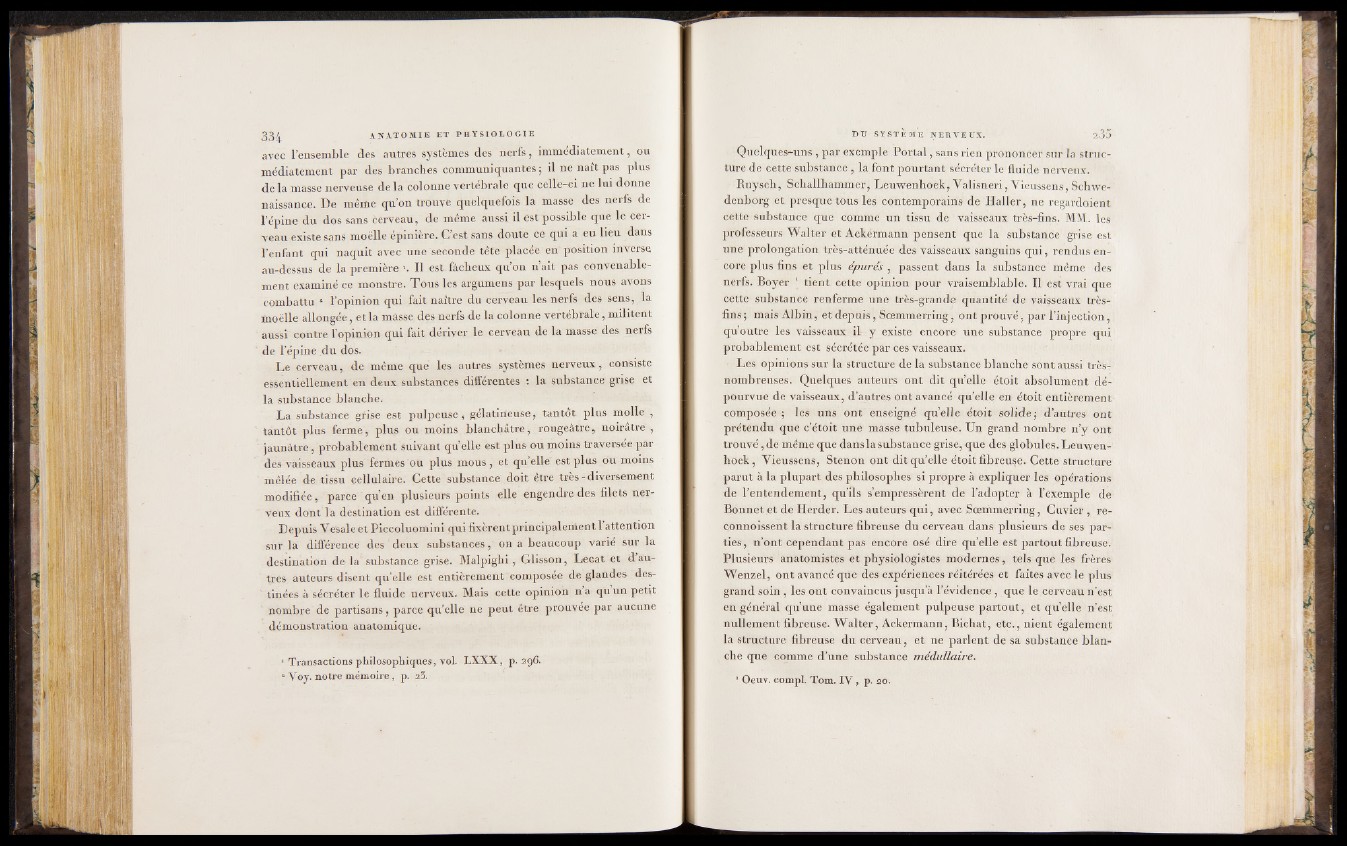
avec l ’ensemble des autres systèmes des nerfs, immédiatement, ou
médiatement par des branches communiquantes ; il ne naît pas plus
de la masse nerveuse de la colonne vertébrale que celle-ci ne lui donne
naissance. De même qu’on trouve quelquefois la masse des nerfs de
l’épine du dos sans cerveau, de même aussi il est possible que le cerveau
existe sans moelle épinière. C’est sans doute ce qui a eu lieu dans
l’enfant qui naquit avec une seconde tête placée en position inverse
au-dessus de la première '. Il est fâcheux qu’on n’ait pas convenablement
examiné ce monstre. Tous les argumens par lesquels nous avons
combattu * l’opinion qui fait naître du cerveau les nerfs des sens, la
moelle allongée, et la masse des nerfs de la colonne vertébrale, militent
aussi contre l’opinion qui fait dériver le cerveau de la masse des nerfs
de l’épine du dos.
Le cerveau, de même que les autres systèmes nerveux, consiste
essentiellement en deux substances différentes : la substance grise et
la substance blanche.
La substance grise est pulpeuse, gélatineuse, tantôt plus molle ,
tantôt plus ferme, plus ou moins blanchâtre, rougeâtre, noirâtre ,
jaunâtre, probablement suivant quelle est plus ou moins traversée par
dés vaisseaux plus fermes ou plus mous , et qu’elle" est plus ou moins
mêlée de tissu cellulaire. Cette substance doit être très - diversement
modifiée, parce qu’en plusieurs points elle engendre des filets nerveux
dont la destination est différente.
Depuis Yesaleet Piecoluomini qui fixèrent principalement! attention
sur la différence des deux substances,' on a beaucoup varie sur la
destination de- la’ substance grise. Malpighi, Glisson, LeGat et d autres
auteurs disent qu’elle est entièrement composée de glandes destinées
à sécréter le fluide nerveux. Mais cette opinion n a qu un petit
nombre de partisans, parce qu’elle ne peut être prouvée par aucune
démonstration anatomique.
» Transactions philosophiques, vol. LXXX, p. 296.
» Voy. notre mémoire, p. 23.
Quelques-uns , par exemple Portai, sans rien prononcer sur la structure
de cette substance , la font pourtant sécréter le fluide nerveux.
Buysch, Schallhammer, Leuwenhoek, Valisneri, Vieussens, Schwe-
denborg et presque tous les contemporains de Haller, ne regardoient
cette substance que comme un tissu de vaisseaux très-fins. MM. les
professeurs Walter et Ackérmann pensent que la substance grise est
une prolongation très-atténuée des vaisseaux sanguins qui, rendus encore
plus fins et plus épurés , passent dans la substance même des
nerfs. Boyer 1 tient cette opinion pour vraisemblable. Il est vrai que
cette substance renferme une très-grande quantité de vaisseaux très-
fins-; mais Albin, et depuis, Soemmerring, ont prouvé, par l’inj ection,
qu’outre les vaisseaux il y existe encore une substance propre qui
probablement est sécrétée par ces vaisseaux.
Les opinions sur la structure de la substance blanche sont aussi irèis-
nombreuses. Quelques auteurs ont dit quelle étoit absolument dépourvue
de vaisseaux, d’autres ont avancé qu’elle en étoit entièrement
composée ; les uns ont enseigné quelle étoit solide; d’autres ont
prétendu que c’étoit une masse tubuleuse. Un grand nombre n’y ont
trouvé, de même que dans la substance grise, que des globules. Leuwenhoek,
Yieussens, Stenon ont dit qu’elle étoit fibreuse. Cette structure
parut à la plupart des philosophes si propre à expliquer les opérations
de l’entendement, qu’ils s’empressèrent de l’adopter à l’exemple de
Bonnet et de Herder. Les auteurs qui, avec Soemmerring, Cuvier, re-
çonnoissent la structure fibreuse du cerveau dans plusieurs de ses- parties,
n’ont cependant pas encore osé dire qu’elle est partout fibreuse.
Plusieurs anatomistes et physiologistes modernes, tels que les frères
Wenzel, ont avancé que des expériences réitérées et faites avec le plus
grand soin , les ont convaincus jusqu a l’évidence , que le cerveau n’est
en général qu’une masse également pulpeuse partout, et quelle n’est
nullement fibreuse. Walter, Ackérmann, Bichat, etc., nient également
la structure fibreuse du cerveau, et ne parlent de sa substance blanche
que comme d’une substance médullaire.
* Oeuv. compl. Tom. XV, p. 20.