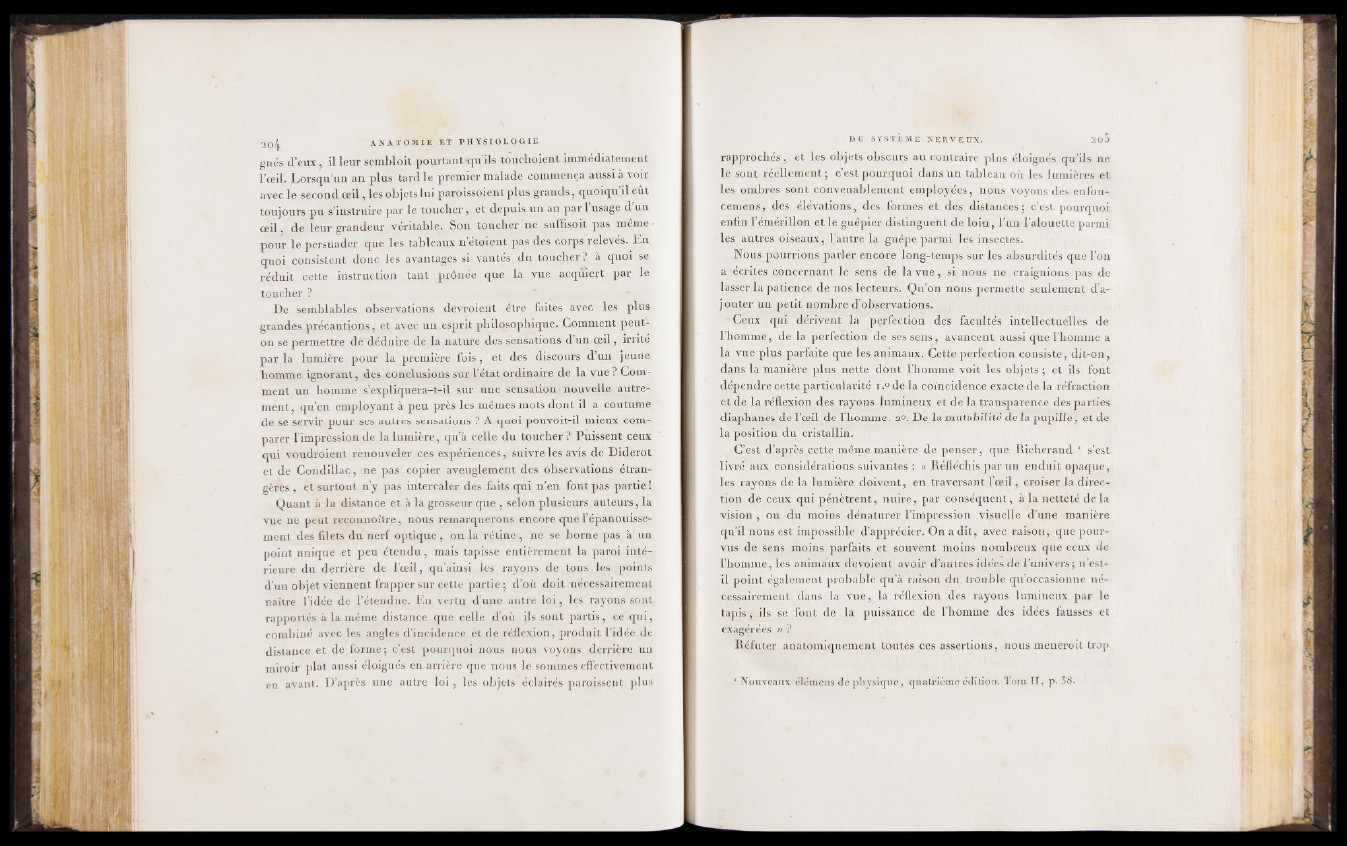
gnés d’eux, il leur sembloit pourtant*qu’ils touclioient immédiatement
l’oeil. Lorsqu'un an plus tard le premier malade commença aussi à voir
avec le second oeil, les objets lui paroissoient plus grands, quoiqu’il eût
toujours pu s’instruire par le toucher, et depuis un an par 1 usage d un
oeil, de leur grandeur véritable. Son toucher ne sufiîsoit pas même-
pour le persuader que les tableaux n etoient pas des corps relevés. En
quoi consistent donc les avantages si vantés du toucher ? à quoi se
réduit cette instruction tant prônée que la vue acquiert par le
toucher ?
De semblables observations devroient être faites avec les plus
grandes précautions, et avec un esprit philosophique. Comment peut-
on se permettre de déduire de la nature des sensations d’un oeil, irrité
parla lumière pour la première fois, et des discours dun jeune
homme ignorant, des conclusions sur l’état ordinaire de la vue ? Comment
un homme s’expliquera-t-il sur une sensation nouvelle autrement,
qu’en employant à peu près les mêmes mots dont il a coutume
de se servir pour ses autres sensations ? A quoi pouvoit-il mieux comparer
l’impression de la lumière, qu’à celle du toucher ? Puissent ceux
qui voudroient renouveler ces expériences, suivre les avis de Diderot
et de Condillac, ne pas copier aveuglement des observations étran-
gèrès , et surtout n’y pas intercaler des faits qui n’en font pas partie !
Quant à la distance et à la grosseur que , selon plusieurs auteurs, la
vue ne peut reconnoître, nous remarquerons encore que l’épanouissement
des filets du nerf optique , ou la rétine , ne se borne pas à un
point unique et peu étendu, mais tapisse entièrement la paroi intérieure
du derrière de l’oeil, qu’ainsi les rayons de tous les points
d’un objet viennent frapper sur cette partie; d’où doit nécessairement
naître l’idée de l’étendue. En vertu d’une autre lo i, les rayons sont
rapportés à la même distance que celle d’où ils sont partis, ce qui,
combiné avec les angles d’incidence et de réflexion, produit l’idée de
distance et de forme ; c’est pourquoi nous nous voyons derrière un
miroir plat aussi éloignés en arrière que nous le sommes effectivement
en avant. D’après une autre lo i , les objets éclairés paraissent plus
rapprochés, et les objets obscurs au contraire plus éloignés qu’ils ne
le sont réellement; c’est pourquoi dans un tableau où les lumières et
les ombres sont convenablement employées, nous voyons des enfon-
cemens, des élévations, des formes et des distances; c’est pourquoi
enfin l’émérillon et le guêpier distingueùt de loin, l ’un l’alouette parmi
les autres oiseaux, l’autre la guêpe parmi les insectes.
Nous pourrions parler encore long-temps sur les absurdités que l’on
a écrites concernant le sens de la vue, si nous ne. craignions pas de
lasser la patience de nos lecteurs. Qu’on nous permette seulement d’ajouter
un petit nombre d’observations.
' Ceux . qui dérivent la perfection des facultés intellectuelles de
l ’homme, de la perfection de ses sens, avancent aussi que l’homme a
la vue plus parfaite que les animaux. Cette perfection consiste, dit-on,
dans la manière plus nette dont l’homme voit les objets ; et ils font
dépendre cette particularité i.°de la coïncidence exacte de la réfraction
et de la réflexion des rayons lumineux et de la transparence des parties
diaphanes de l’oeil de l’homme. 2°. De la mutabilité delà pupillef et de
la position du cristallin.
C’est d’après cette même manière de penser, que Richerand 1 s’est
livré aux considérations suivantés : « Réfléchis par un enduit opaque,
les rayons de la lumière doivent, en traversant l’oeil, croiser la direction
de ceux qui pénètrent, nuire, par conséquent, à la netteté de la
vision , ou du moins dénaturer l’impression visuelle d’une manière
qu’il nous est impossible d’apprécier. On a dit, avec raison, que pourvus
de sens moins parfaits et souvent moins nombreux que ceux de
l’homme, les animaux dévoient avoir d’autres idées de l ’univers; n’est-
il point également probable qu’à raison du trouble qu’occasionne nécessairement
dans la vue, la réflexion des rayons lumineux par le
tapis, ils se font de la puissance de l’homme des idées fausses et
exagérées » ?
Réfuter anatomiquement toutes ces assertions, nous mènerait trop
* Nouveaux élémens de physique, quatrième' édition. Tom.Il, p. 58.