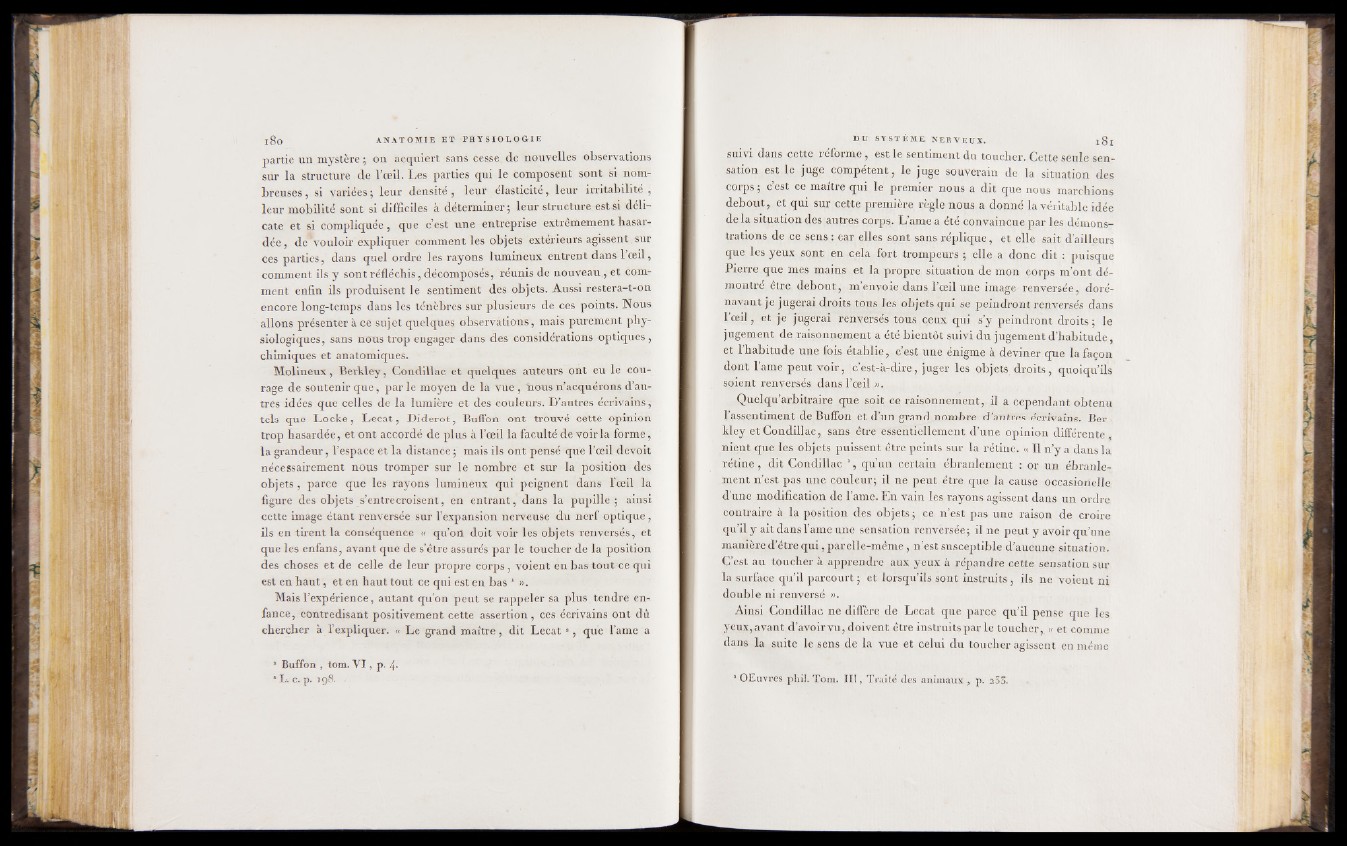
partie un mystère; on acquiert sans cesse de nouvelles observations
sur la structure de l’oeil. Les parties qui le composent sont si nombreuses
, si variées ; leur densité , leur élasticité, leur irritabilité ,
leur mobilité sont si difficiles à déterminer; leur structure est si délicate
et si compliquée, que c’est une entreprise extrêmement hasardée,
de Vouloir expliquer comment les objets extérieurs agissent sur
ces parties, dans quel ordre les rayons lumineux entrent dans l’oeil,
comment ils y sont réfléchis, décomposés, réunis de nouveau., et comment
enfin ils produisent le sentiment des objets. Aussi restera-t-on
encore long-temps dans les ténèbres sur plusieurs de ces points. Nous
allons présenter à ce sujet quelques observations, mais purement physiologiques,
sans nous trop engager dans des considérations optiques,
chimiques et anatomiques.
Molineux, Berkley, Condillae et quelques auteurs ont eu le courage
de soutenir que, par le moyen de la vue , Bous n’acquérons d’autres
idées que celles de la lumière et des couleurs. D’autres écrivains;
tels que Locke, Lecat, Diderot, Buffon ont trouvé cette opinion
trop hasardée, et ont accordé de plus à l’oeil la faculté de voirla forme,
la grandeur, l’espace et la distance ; mais ils ont pensé que l’oeil devoit
nécessairement nous tromper sur le nombre et sur la position des
objets , parce que les rayons luminéux qui peignent dans l’oeil la
figure des objets s’entrecroisent, en entrant, dans la pupille ; ainsi
cette image étant renversée sur l’expansion nerveuse du nerf optique,
ils en tirent la conséquence « qu’on doit voir les objets renversés, et
que les enfans, avant que de s’être assurés par le toucher de la position
des choses et de celle de leur propre corps, voient en bas tout ce qui
est en haut, et en haut tout ce qui est en bas '
Mais l’expérience, autant qu’on peut se rappeler sa plus tendre enfance,
contredisant positivement cette assertion, ces écrivains ont dû
chercher à l’expliquer. « Le grand maître, dit Lecat a, que lame a *
* Buffon , tom. V I , p. 4-
• L. c. p. 198. .
D U S Y S T ÈME NER VEU X . i 8 l
suivi dans cette réforme, est le sentiment du toucher. Cette seule sensation
est, le juge compétent, le juge souverain de la situation des
corps ; c’est ce maître qui le premier nous a dit que nous marchions
debout, et qui sur cette première règle nous a donné la véritable idée
de la situation des autres corps. L ’ame a été convaincue par les démonstrations
de ce sens : car elles sont sans réplique, et elle sait d’ailleurs
que les yeux sont en cela fort trompeurs ; elle a donc dit : puisque
Pierre que mes mains et la propre situation de mon corps m’ont démontré
être debout, m’envoie dans l’oeil une image renversée, dorénavant
je jugerai droits tous les objets qui se peindront renversés dans
l'oeil, et je jugerai renversés tous ceux qui s’y peindront droits; le
jugement de raisonnement a été bientôt suivi du jugement d’habitude,
et l’habitude une fois établie, c’est une énigme à deviner que la façon
dont l’ame peut voir, ’c’est-à-dire, juger les objets droits, quoiqu’ils
soient renversés dans l’oeil ».
Quel qu’arbitraire que soit ce raisonnement, il a cependant obtenu
l’assentiment de Buffon et d’un grand nombre d’autres écrivains. Berkley
et Condillae, sans être essentiellement d’une opinion différente
nient que les objets puissent être peints sur la rétine. « 11 n’y a dans la
rétine, dit Condillae ‘ , qu’un certain ébranlement : or un ébranlement
n’est pas une couleur; il ne peut être que la cause occasionelle
d’une modification de l’ame. En vain les, rayons agissent dans un ordre
contraire à la position des objets; ce n’est pas une raison de croire
qu’il y ait dansl’ame une sensation renversée; il ne peut y avoir qu’une
manière d’être qui, parelle-même, n’est susceptible d’aucune situation.
C’est au toucher à apprendre aux yeux à répandre cette sensation sur
la surface qu’il parcourt; et lorsqu’ils sont instruits, ils ne voient ni
double ni renversé ».
Ainsi Condillae ne diffère de Lecat que parce qu’il pense que les
yeux, avant d’avoir vu, doivent être instruits par le toucher,. « et comme
dans la suite le sens de la vue et celui du toucher agissent en même
* OEuvres phil. Tom. III, Traité des animaux , p. 233.