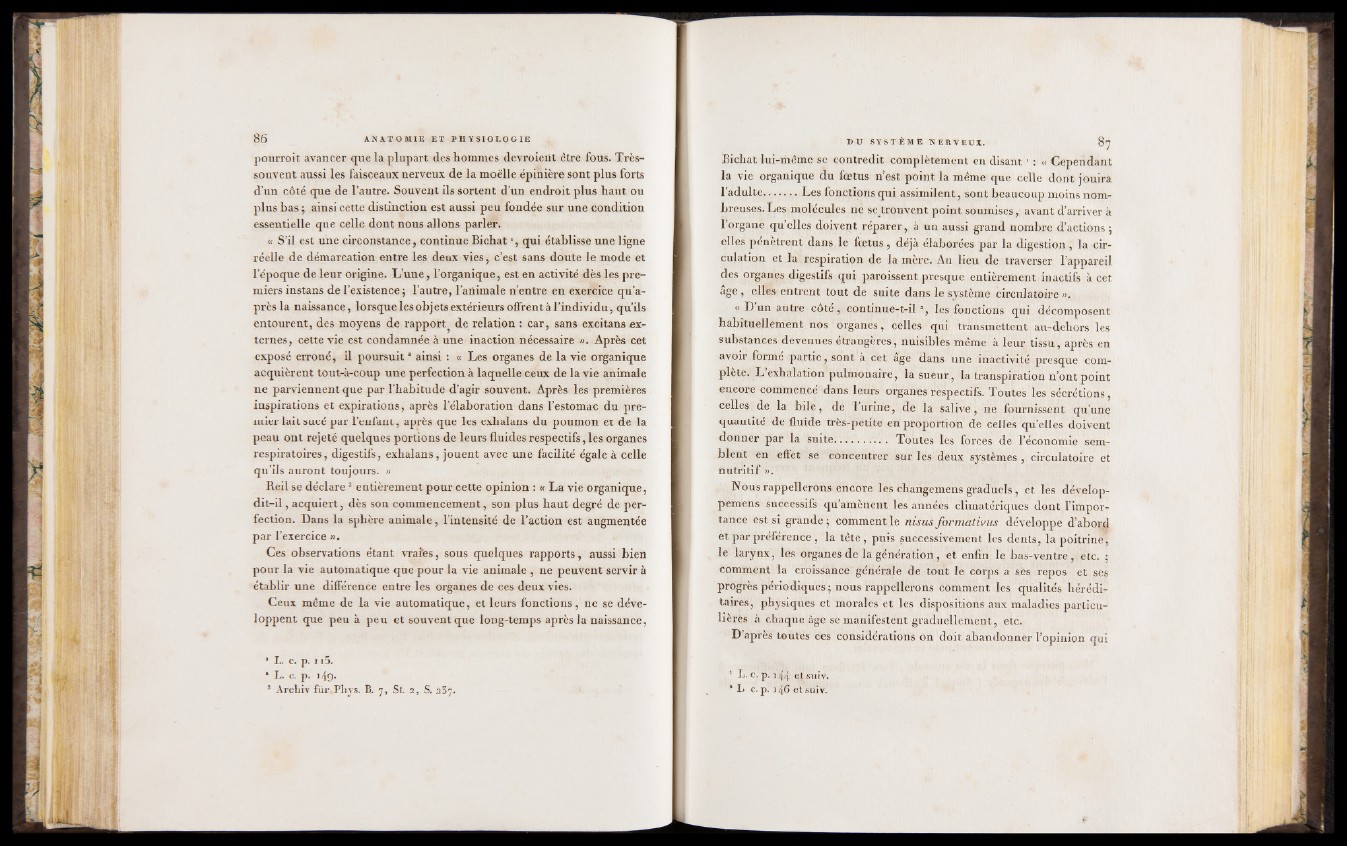
pourroit avancer que la plupart des hommes devroieiit être fous. Très-
souvent aussi les faisceaux nerveux de la moelle épinière sont plus forts
d’un côté que de l ’autre. Souvent ils sortent d’un endroit plus haut ou
plus bas ; ainsi cette distinction est aussi peu fondée sur une condition
essentielle que celle dont nous allons parler.
« S’il est une circonstance, continue Bichat *, qui établisse une ligne
réelle de démarcation entre les deux vies, c’est sans doute le mode et
l ’époque de leur origine. L ’une, l’organique, est en activité dès les premiers
instans de l’existence j l ’autre, l’animale n’entre en exercice qu’a-
prèsla naissance, lorsquelesobjetsextérieursoffrentàl’individu, qu’ils
entourent, des moyens de rapport^ de relation : car, sans excitans externes,
cette vie est condamnée à une inaction nécessaire j>. Après cet
exposé erroné, il poursuit * ainsi : « Les organes de la vie organique
acquièrent tout-à-coup une perfection à laquelle ceux de la vie animale
ne parviennent que par l’habitude d’agir souvent. Après les premières
inspirations et expirations, après l’élaboration dans l’estomac du premier
lait sucé par l ’enfant, après que les exhalans du poumon et de la
peau Ont rejeté quelques portions de leurs fluides respectifs, les organes
respiratoires, digestifs, exhalans, jouent avec une facilité égale à celle
qu’ils auront toujours. »
Reil se déclare3 entièrement pour cette opinion : « La vie organique,
dit-il, acquiert, dès son commencement, son plus haut degré de perfection.
Dans la sphère animale, l’intensité de l ’action est augmentée
par l’exercice ».
Ces observations étant vraies, sous quelques rapports, aussi bien
pour la vie automatique que pour la vie animale , ne peuvent servir à
établir une différence entre les organes de ces deux vies.
Ceux même de la vie automatique, et leurs fonctions, ne se développent
que peu à peu et souvent que long-temps après la naissance,
' L. c. p. 115.
* L. c. p. 149.
3 Archiv für.Pliys. B, 7, St. 2, S. 237.
Bichat lui-même se contredit complètement en disant1 : « Cependant
la vie organique du foetus n’est point la même que celle dont jouira
l’adulte— ... Les fonctions qui assimilent, sont beaucoup moins nombreuses.
Les molécules ne se.trouvent point soumises, avant d’arriver à
1 organe qu elles doivent réparer, à un aussi grand nombre d’actions ;
elles pénètrent dans le foetus, déjà élaborées par la digestion , la circulation
et la respiration de la mère. Au lieu de traverser l’appareil
des organes digestifs qui paroissent presque entièrement inactifs à cet
âge , elles entrent tout de suite dans le système circulatoire ».
« D un autre coté, continue-t-il’ , les fonctions qui décomposent
habituellement nos organes, celles qui transmettent au-dehors les
substances devenues étrangères, nuisibles même à leur tissu, après en
avoir formé partie, sont à cet âge dans une inactivité presque complète.
L exhalation pulmonaire, la sueur, la transpiration n’ont point
encore commencé dans leurs organes respectifs. Toutes les sécrétions,
celles de la bile, de l’urine, de la salive, ne fournissent qu’une
quantité de fluide très-petite en proportion de celles quelles doivent
donner par la suite................ Toutes les forces de l’économie semblent
en effet se concentrer sur les deux systèmes , circulatoire et
nutritif ».
Nous rappellerons encore les changemens graduels, et les dévelop-
pemens successifs qu’amènent les années climatériques dont l’importance
est si grande 5 comment le nisus formativus développe d’abord
et par préférence , la tête, puis successivement les dents, la poitrine,
le larynx, les organes de la génération, et enfin le bas-ventre, etc. ;
comment la croissance générale de tout le corps a ses repos et ses
progrès périodiques ; nous rappellerons comment les qualités héréditaires,
physiques et morales et les dispositions aux maladies particulières
à chaque âge se manifestent graduellement, etc.
D’après toutes ces considérations on doit abandonner l’opinion qui
■ 1 L- c. p. 144 et suiv.
* I* c.p. 146 et suiv.