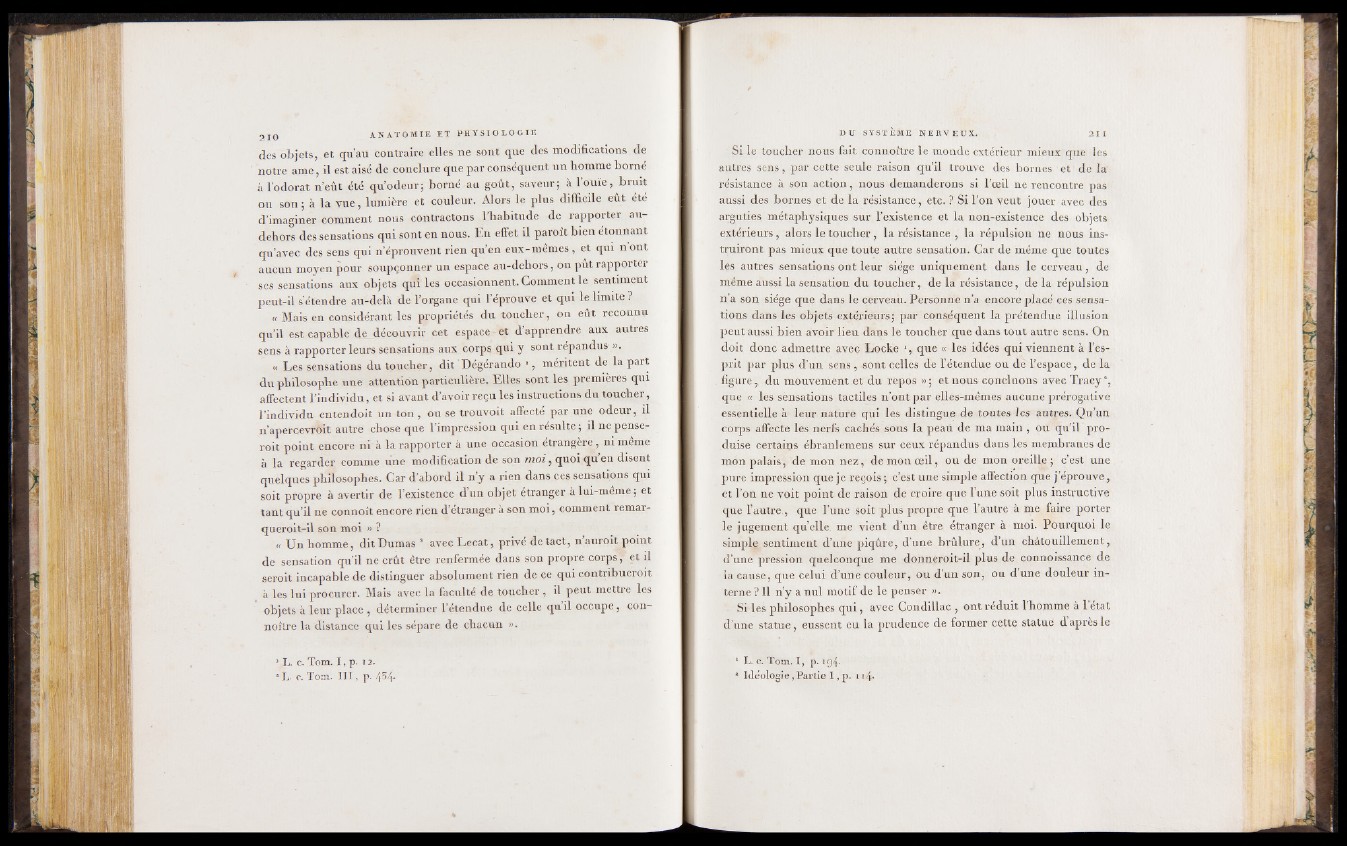
a i 0 A N A T OM I E ET P H Y S I O L O G I E
des objets, et qu’au contraire elles ne sont que des modifications de
notre ame, il est aisé de conclure que par conséquent un homme borné
à l’odorat n’eût été qu’odeur; borné au goût, saveur; à l’ouïe, bruit
ou son; à la vue, lumière et couleur. Alors le plus difficile eût été
d’imaginer comment nous contractons 1 habitude de rapporter au-
dehors des sensations qui sont en nous. En effet il paroît bien étonnant
qu’avec des sens qui n’éprouvent rien qu’en eux-memes, et qui nont
aucun moyen pour soupçonner un espace au-dehors, on put rapporter
ses sensations aux objets qui les occasionnent. Comment le sentiment
peut-il s’étendre au-delà de l’organe qui l’éprouve et qui le limite ?
« Mais en considérant les propriétés du toucher , on eût reconnu
qu’il est capable de découvrir cet espace et d’apprendre aux autres
sens à rapporter leurs sensations aux corps qui y sont répandus ».
« Les sensations du toucher, dit Dégérando 1, méritent de la part
du philosophe une attention particulière. Elles sont les premières qui
affectent l’individu, et si avant d’avoir reçu les instructions du toucher ,
l’individu entendoit un ton, ou se trouvoit affecté par une odeur, il
n’apercevroit autre chose que l’impression qui en resuite ; il ne pense-
roit point encore ni à la rapporter à une occasion étrangère, ni même
à la regarder comme une modification de son moi, quoi qu en disent
quelques philosophes. Car d’abord il n y a rien dans ces sensations qui
soit propre à avertir de l’existence d’un objet étranger à lui-meme ; et
tant qu’il ne connoît encore rien d’étranger à son moi, comment remar-
queroit-il son moi »? ...
« Un homme, dit Dumas a avec Lecat, privé de tact, n auroit point
de sensation qu’il ne crût être renfermée dans son propre corps, et il
seroit incapable de distinguer absolument rien de ce qui contribueroit
à les lui procurer. Mais avec la faculté de toucher , il peut mettre les
objets à leur place , déterminer l’étendue de celle qu’il occupe, con-
noîlre la distance qui les sépare de chacun ». *
* L. c. Tom. I , p. 12.
5 I,. e. Tom. I I I , p. 454-
Si le toucher nous fait connoître le monde extérieur mieux que les
autres sens, par cette seule raison qu’il trouve des bornes et de la
résistance à son action, nous demanderons si l’oeil ne rencontre pas
aussi des bornes et de la résistance, etc. ? Si l’on veut jouer avec des
arguties métaphysiques sur l’existence et la non-existence des objets
extérieurs , alors le toucher, la résistance , la répulsion ne nous instruiront
pas mieux que toute autre sensation. Car de même que toutes
les autres sensations ont leur siège uniquement dans le cerveau, de
même aussi la sensation du toucher, de la résistance, de la répulsion
n’a son siège que dans le cerveau. Personne n’a encore placé ces sensations
dans les objets extérieurs; par conséquent la prétendue illusion
peut aussi bien avoir lieu dans le toucher que dans tout autre sens. On
doit donc admettre avec Locke 1, que « les idées qui viennent à l’esprit
par plus d’un sens, sont celles de l’étendue ou dé l’espace, de la
figure, du mouvement et du repos » ; et nous concluons avec Tracy “,
que « les sensations tactiles n’ont par elles-mêmes aucune prérogative
essentielle à leur nature qui les distingue de toutes les autres. Qu’un
corps affecte les nerfs cachés sous la peaü de ma main , ou qu’il produise
certains ébranlemens sur ceux répandus dans les membranes de
mon palais, de mon nez, de mon oeil, ou de mon oreille; c’est une
pure impression que je reçois ; c’est une simple affection que j'éprouve,
et l’on ne voit point de raison de croire que l’une soit plus instructive
que l’autre, que l’une soit plus propre que l’autre à me faire porter
le jugement qu’elle, me vient d’un être étranger à moi. Pourquoi le
simple sentiment d’une piqûre, d’une brûlure, d’un chatouillement,
d’une pression quelconque me donneroit-il plus de connoissance de
la cause, que celui d’une couleur, ou d’un son, ou d’une douleur interne
? Il n’y a nul motif de le penser ».
Si les philosophes qui, avec Condillac , ont réduit l’homme à 1 état
d’une statue, eussent eu la prudence de former cette statue d après le
* L. c. Tom. I, p. ig/f
* Idéologie, Partie I ,p . 114.