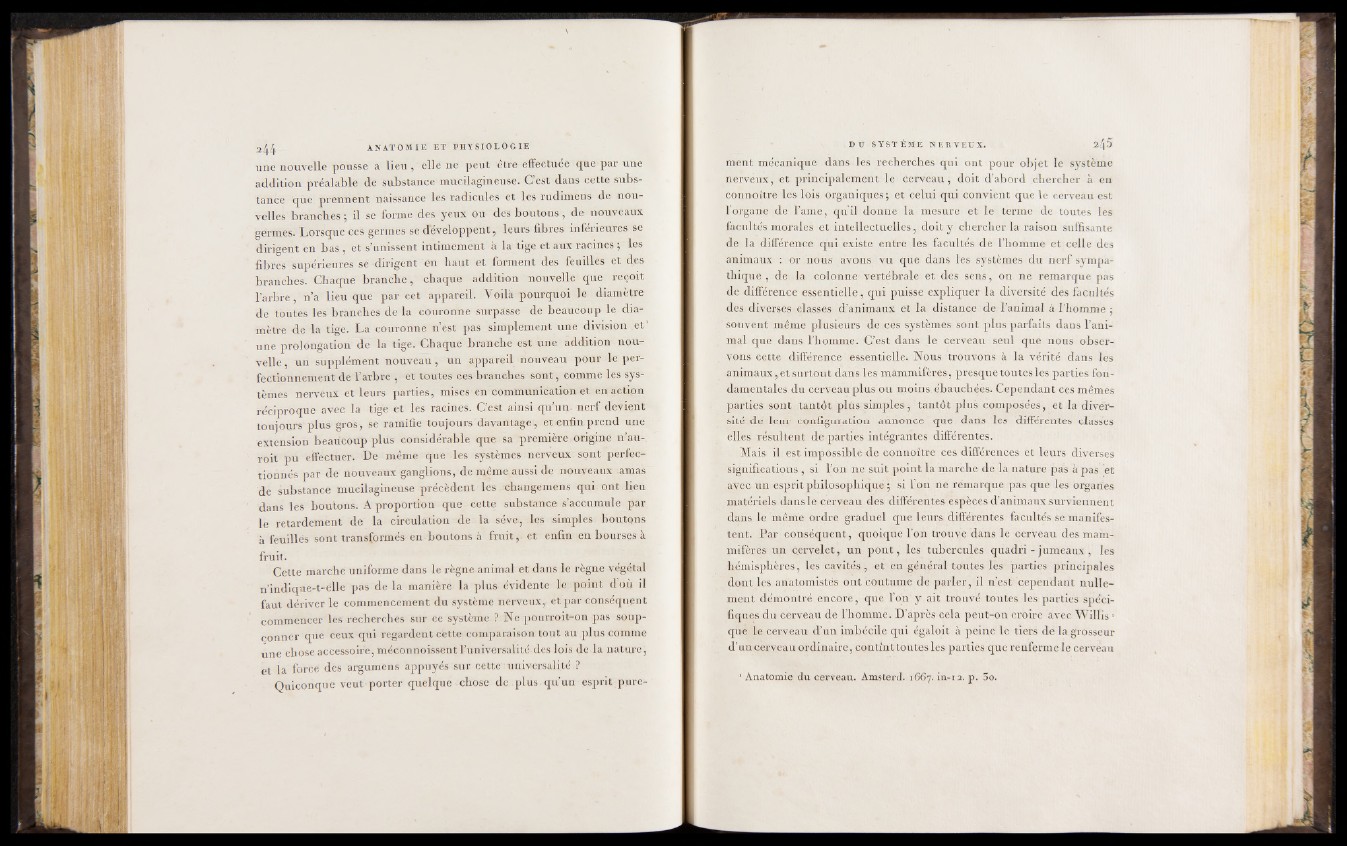
une nouvelle pousse a lieu , ' elle ne peut être effectuée que par une
addition préalable de substance mucilagineuse. C’est dans cette substance
que prennent naissance les radicules et les rudimens de nouvelles
branches ; il se forme des yeux ou des boutons, de nouveaux
germes. Lorsque ces germes se développent, leurs fibres inférieures se
dirigent en bas , et s’unissent intimement à la tige et aux racines ; les
fibres supérieures se dirigent en haut et forment des feuilles et des
branches. Chaque branche, chaque addition nouvelle que reçoit
l’arbre, n’a lieu que par cet appareil. Yoilà pourquoi le diamètre
de toutes les branches de la couronne surpaisse de beaucoup le diamètre
de la tige. La couronne n’est pas simplement une division et'
une prolongation de la tige. Chaque branche est une addition nouvelle
, un supplément nouveau, un appareil nouveau pour le perfectionnement
de l’arbre , et toutes ces branches sont, comme les systèmes
nerveux et leurs parties, mises en communication et en action
réciproque avec la tige et les racines. C’est ainsi qu’un nerf devient
toujours plus gros, se ramifie toujours davantage, etenfin prend une
extension beaucoup plus considérable que sa première origine n’au-
roit pu effectuer. De même que les systèmes nerveux sont perfectionnés
par de nouveaux ganglions, de même aussi de nouveaux amas
de substance mucilagineuse précèdent les ■ changemens qui ont ljeu
dans les boutons. A proportion que cette substance s’accumule par
le retardement de la circulation de la sève, les simples boutons
à feuilles sont transformés en boutons à fruit, et enfin en bourses à
fruit.
Cette marche uniforme dans le règne animal et dans le règne végétal
n’indique-t-élle pas de la manière la plus évidente le point doù il
faut dériver le commencement du système nerveux,, et par conséquent
commencer les recherches sur ce système ? Ne pourroit-on pas soupçonner
que ceux qui regardent cette comparaison tout au plus comme
une chose accessoire, méconnoissent l’universalité des lois de la nature,
et la force des argumens appuyés sur cette universalité ?
Quiconque veut porter quelque chose de plus, qu’un esprit purement
mécanique dans les recherches qui ont pour objet le système
nerveux, et principalement le cerveau, doit d’abord chercher à en
connoître les lois organiques ; et celui qui convient que le cerveau est
lorgane de l’ame, qu’il donne la mesure et le terme de toutes les
facultés morales et intellectuelles, doit y chercher la raison suffisante
de la différence qui existe entre les facultés de l ’homme et celle des
animaux : or nous avons vu que dans les systèmes du nerf sympathique
, de la colonne-vertébrale et des sens, on ne remarque pas
de différence essentielle, qui puisse expliquer la diversité des facultés
des diverses classes d’animaux et la distance de l’animal à l ’homme ;
souvent même plusieurs de ces systèmes sont plus parfaits dans l’animal
que dans l’homme. C’est dans le cerveau seul que nous observons
cette différence essentielle. Nous trouvons à la vérité dans les
animaux, et surtout dans les mammifères, presque toutes les parties fondamentales
du cerveau plus ou moins ébauchées. Cependant ces mêmes
parties sont tantôt plus simples , tantôt plus composées, et la diversité
de leur configuration annonce que dans les différentes classes
elles résultent de parties intégrantes différentes.
Mais il est impossible de connoître ces différences et leurs diverses
significations , si l’on ne suit point la marche de la nature pas à pas et
avec un esprit philosophique ; si l’on ne remarque pas que les organes
matériels dans le cerveau des différentes espèces d’animaux surviennent
dans le même ordre graduel que leurs différentes facultés se manifestent.
Par conséquent, quoique l’on trouve dans le cerveau des mammifères
un cervelet, un pont, les tubercules quadri - jumeaux , les
hémisphères, les cavités, et en général toutes les parties principales
dont les anatomistes ont coutume de parler, il n’est cependant nullement
démontré encore, que l’on y ait trouvé toutes les parties spécifiques
du cerveau de l’homme. D’après cela peut-on croire avec Wilbs *
que le cerveau d’un imbécile qui égaloit à peine le tiers de la grosseur
d’un cerveau ordinaire, contint toutes les parties que renferme le cerveau
1 Anatomie du cerveau. Amsterd. 1G67. in-12. p. 5o.