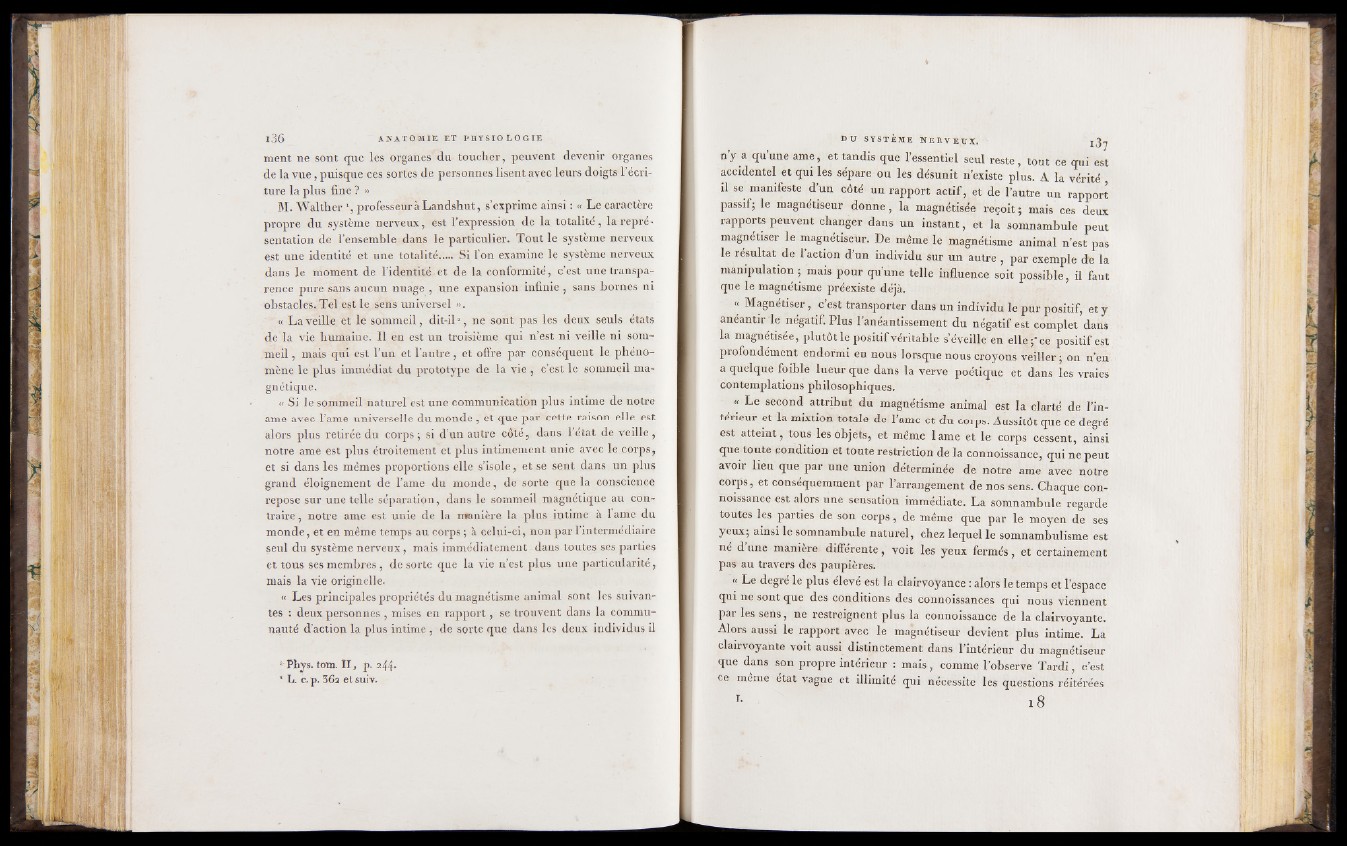
ment ne sont que les organes' du toucher, peuvent devenir organes
de la vue, puisque ces sortes de personnes lisent avec leurs doigts l’écriture
la plus fine ? »
M. Walther professeur à Landshut, s’exprime ainsi : « Le caractère
propre du système nerveux, est l’expression de la totalité, la représentation
de l’ensemble dans le particulier. Tout le système nerveux
est une identité et une totalité.... Si l’on examine le système nerveux
dans le moment de l’identité. et de la conformité, c’est une transparence
pure sans aucun nuage , une expansion infinie , sans bornes ni
obstacles. Tel est le sens universel ».
« La veille et le sommeil, dit-il“, ne sont pas les deux seuls états
de la vie humaine. Il en est un troisième qui n’est ni veille ni sommeil
, mais qui est l’un et l'autre , et offre par conséquent le. phénomène
le plus immédiat du prototype de la vie , c’est le sommeil magnétique.
K Si le sommeil naturel est une communication plus intime de notre
ame avec lame universelle du monde , et que par cette raison elle est
alors plus retirée du corps ; si d’un autre côté, dans l’état de veille ,
notre ame est plus étroitement et plus intimement unie avec le corps,
et si dans les mêmes proportions elle s’isole, et se sent dans un plus
grand éloignement de l’ame du monde, de sorte que la conscience
repose sur une telle séparation, dans le sommeil magnétique au contraire,
notre ame est unie de la manière la plus intime à l ame du
monde, et en même temps an corps ; à celui-ci, non par l’intermédiaire
seul du système nerveux, mais immédiatement dans toutes ses parties
et tous ses membres , de sorte que la vie n’est plus une particularité,
mais la vie originelle.
« Les principales propriétés du magnétisme animal sont les suivantes
: deux personnes , mises en rapport, se trouvent dans la communauté
d’action la plus intime, de sorte que dans les deux individus il
' Phys. tom. II, p. 244.
’ L. c.p. 362 et suiv.
n y a qu une ame, et tandis que l’essentiel seul reste, tout ce qui est
accidentel et qui les sépare ou les désunit n’existe plus. A la vérité
il se manifeste d’un côté un rapport actif, et de l’autre un rapport
passif; le magnétiseur donne, la magnétisée reçoit ; mais ces deux
rapports peuvent changer dans un instant, et la somnambule peut
magnétiser le magnétiseur. De même le magnétisme animal n’est pas
le résultat de l’action d’un individu sur un autre , par exemple d'e la
manipulation ; mais pour qu’une telle influence soit possible, il faut
que le magnétisme préexiste déjà.
« Magnétiser, c est transporter dans un individu le pur positif, et y
anéantir le négatif. Plus 1 anéantissement du négatif est complet dans
la magnétisée, plutôt le positif véritable s’éveille en elle;’ ce positif est
profondément endormi en nous lorsque nous croyons veiller ; on n’en
a quelque foible lueur que dans la verve poétique et dans les vraies
contemplations philosophiques.
« Le second attribut du magnétisme animal est la clarté de l’intérieur
et la mixtion totale de l’ame et du corps. Aussitôt que ce degré
est atteint, tous les objets, et meme lame et le corps cessent, ainsi
que toute condition et toute restriction delà connoissance, qui ne peut
avoir lieu que par une union déterminée de notre ame avec notre
corps , et conséquemment par l’arrangement de nos sens. Chaque connoissance
est alors une sensation immédiate. La somnambule regarde
toutes les parties de son corps, de même que par le moyen de ses
yeux; ainsi le somnambule naturel, chez lequel le somnambulisme est
né d une manière différente, voit les yeux fermés, et certainement
pas au travers des paupières.
" Le degré le plus élevé est la clairvoyance : alors le temps et l’espace
qui ne sont que des conditions des connoissances qui nous viennent
par les sens, ne restreignent plus la connoissance de la clairvoyante.
Alors aussi le rapport avec le magnétiseur devient plus intime. La
clairvoyante voit aussi distinctement dans l’intérieur du magnétiseur
que dans son propre intérieur : mais, comme l’observe Tardi, c’est
ce même état vague et illimité qui nécessite les questions réitérées
I. 18