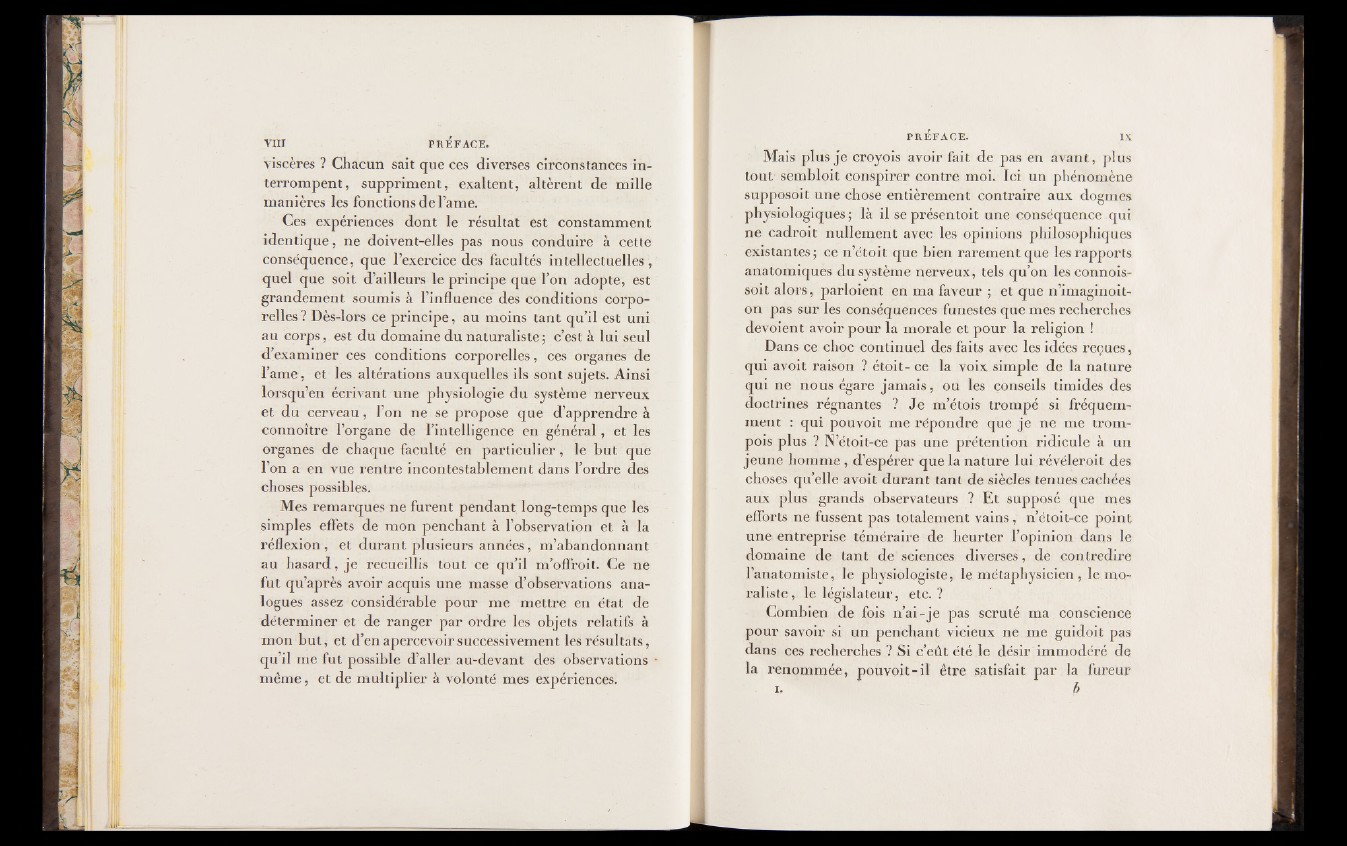
viscères ? Chacun sait que ces diverses circonstances interrompent,
suppriment, exaltent, altèrent de mille
manières les fonctions de l’ame.
Ces expériences dont le résultat est constamment
identique, ne doivent-elles pas nous conduire à cette
conséquence, que l’exercice des facultés intellectuelles,
quel que soit d’ailleurs le principe que l’on adopte, est
grandement soumis à l’influence des conditions corporelles
? Dès-lors ce principe, au moins tant qu’il est uni
au corps, est du domaine du naturaliste; c’est à lui seul
d’examiner ces conditions corporelles, ces organes de
l’ame, et les altérations auxquelles ils sont sujets. Ainsi
lorsqu’en écrivant une physiologie du système nerveux
et du cerveau, l’on ne se propose que d’apprendre à
connoître l’organe de l’intelligence en général, et les
organes de chaque faculté en particulier, le but que
l’on a en vue rentre incontestablement dans l’ordre des
choses possibles.
Mes remarques ne furent pendant long-temps que les
simples effets de mon penchant à l’observation et à la
réflexion , et durant plusieurs années, m’abandonnant
au hasard, je recueillis tout ce qu’il m’offroit. Ce ne
fut qu’après avoir acquis une masse d’observations analogues
assez considérable pour me mettre en état de
déterminer et de ranger par ordre les objets relatifs à
mon but* et d’en apercevoir successivement les résultats,
qu’il me fut possible d’aller au-devant des observations
même, et de multiplier à volonté mes expériences.
Mais plus je croyois avoir fait de pas en avant, plus
tout sembloit conspirer contre moi. Ici un phénomène
supposoit une chose entièrement contraire aux dogmes
physiologiques; là il seprésentoit une conséquence qui
ne cadroit nullement avec les opinions philosophiques
existantes ; ce n’étoit que bien rarement que les rapports
anatomiques du système nerveux, tels qu’on les connois-
soit alors, parloient en ma faveur ; et que n’imaginait-
on pas sur les conséquences funestes que mes recherches
dévoient avoir pour la morale et pour la religion !
Dans ce choc continuel des faits avec les idées reçues,
qui avoit raison ? étoit- ce la voix simple de la nature
qui ne nous égare jamais, ou les conseils timides des
doctrines régnantes ? Je m’étois trompé si fréquemment
: qui pouvoit me répondre que je ne me trom-
pois plus ? IN’étoit-ce pas une prétention ridicule à un
jeune homme , d’espérer que la nature lui révélerait des
choses qu’elle avoit durant tant de siècles tenues cachées
aux plus grands observateurs ? Et supposé que mes
efforts ne fussent pas totalement vains, n’étoit-ce point
une entreprise téméraire de heurter l’opinion dans le
domaine de tant de sciences diverses, de contredire
l’anatomiste, le physiologiste, le métaphysicien, le moraliste,
le législateur, etc. ?
Combien de fois n’ai-je pas scruté ma conscience
pour savoir si un penchant vicieux ne me guidoit pas
dans ces recherches ? Si c’eût été le désir immodéré de
la renommée, pouvoit-il être satisfait par la fureur
j, b