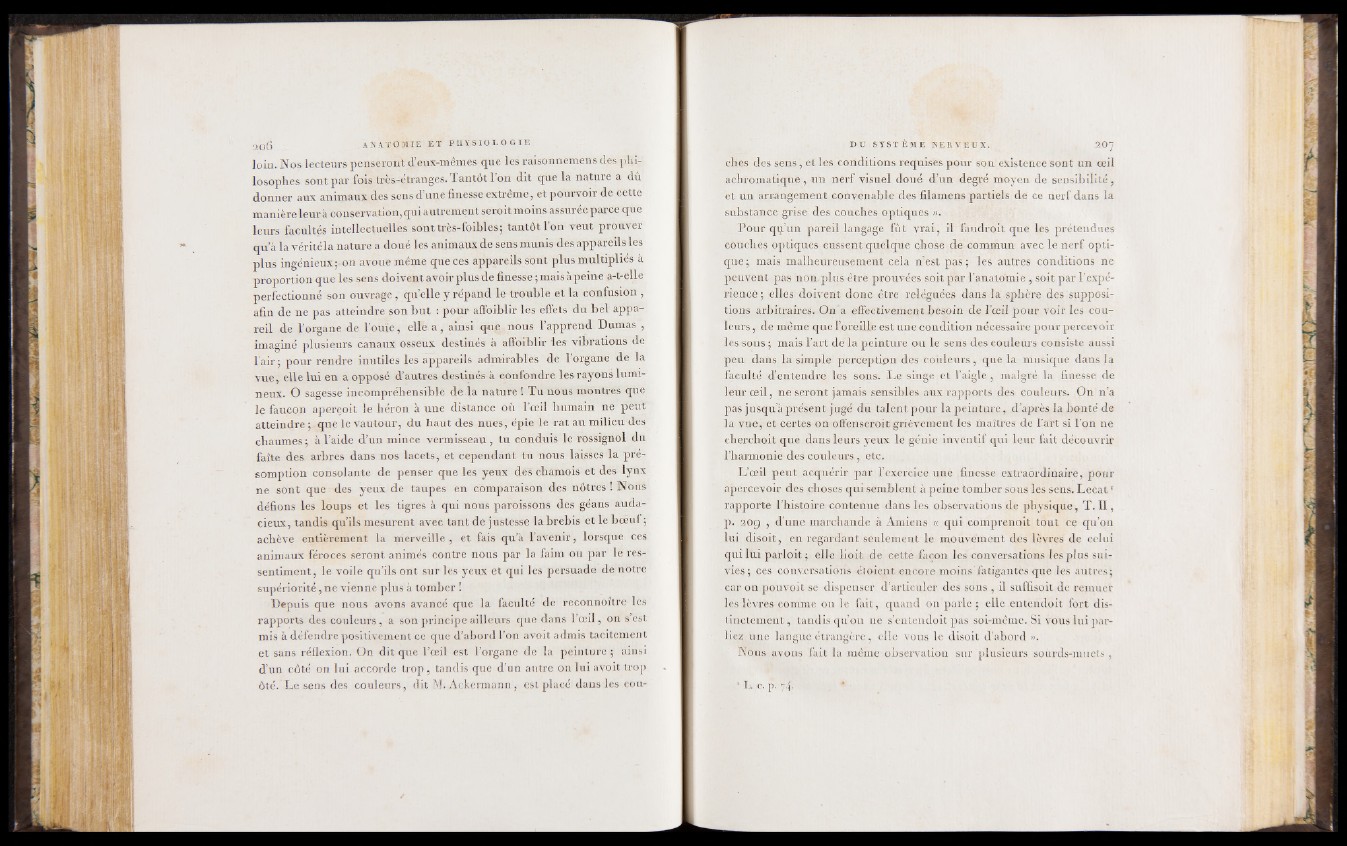
loin. Nos lecteurs penseront d’eux-mêmes que les raisonnemens des philosophes
sont par fois très->étranges. Tantôt 1 on dit que la nature a du
donner aux animaux des sens d’une finesse extrême, et pourvoir de cette
manière leur à conservation, qui autrement seroit moins assuréeparce que
leurs facultés intellectuelles sonttres-foibles; tantôt Ion veut prouver
qu’à la vérité la nature a doué les animaux de sens munis des appareils les
plus ingénieux; on avoue même que ces appareils sont plus multipliés à
proportion que les sens doivent avoir plus de finesse; mais à peine a-t-elle
perfectionné son ouvrage, quelle y répand le trouble et la confusion ,
afin de ne pas atteindre son but : pour affoiblir les effets du bel appareil
de l’organe de l’ouïe, elle a , ainsi que nous l’apprend Dumas ,
imaginé plusieurs canaux osseux destinés à affoiblir les vibrations de
l'air ; pour rendre inutiles les appareils admirables de l’organe de la
vue, elle lui en a opposé d’autres destinés à confondre les rayons lumineux.
O sagesse incompréhensible de la nature ! Tu nous montres que
le faucon aperçoit le héron à une distance où l’oeil humain ne peut
atteindre ;.que le vautour, du haut des nues, épie le rat au milieu des
chaumes; à l ’aide d’un mince vermisseau, tu eonduis le rossignol du
faîte des arbres dans nos lacets, et cependant tu nous laisses la présomption
consolante de penser que les yeux des chamois et des lynx
ne sont que des yeux de taupes en comparaison des nôtres ! Nous
défions les loups et les tigres à qui nous paraissons des géans audacieux,
tandis qu’ils mesurent avec tant de justesse la brebis et le boeuf ;
achève entièrement la merveille, et fais qu’à l’avenir, lorsque ces
animaux féroces seront animés contre nous par la faim ou par le ressentiment,
le voile qu’ils ont sur les yeux et qui les persuade de notre
supériorité, ne vienne plus à tomber !
Depuis que nous avons avancé que la faculté de reconnoître les
rapports des couleurs, a son principe ailleurs que dans l’oeil, on s’est
mis à défendre positivement ce que d’abord l’on avoit admis tacitement
et sans réflexion. On dit que l’çeil est l’organe de la peinture ; ainsi
d’un côté on lui accorde trop, tandis que d’un antre on lui avoit trop
ôté. Le sens des couleurs, dit M. Ackermann, est placé dans les couches
des sens, et les conditions requises pour son existence sont un oeil
achromatique, un nerf visuel doué d’un degré moyen de sensibilité,
et un arrangement convenable des filamens partiels de ce nerf dans la
substance grise des couches optiques ». .
Pour qq’un pareil langage fût vrai, il faudrait que les prétendues
couches optiques eussent quelque chose de commun avec le nerf optique;
mais malheureusement cela n’est pas ; les autres conditions ne
peuvent pas non, plus être prouvées soit par l’anatomie , soit par l’expérience
; elles doivent donc être reléguées dans la sphère des suppositions
arbitraires. On a effectivement besoin de l ’oeil pour voir les couleurs
, de même que l’oreille est une condition nécessaire pour percevoir
les sons ; mais l’art de la peinture ou le sens des couleurs consiste aussi
peu dans la simple perceptipn des couleurs, que la musique dans la
faculté d’entendre les sons. Le singe et l’aigle , malgré la finesse de
leur oeil, ne seront jamais sensibles aux rapports des couleurs. On n’a
pas jusqu a présent jugé du talent pour la peinture, d’après la bonté de
la vue, et certes on offenserait grièvement les maîtres de l’art si l ’on ne
cherchoit que dans leurs yeux le génie inventif qui leur fait découvrir
l’harmonie des couleurs, etc.
L’oeil peut acquérir par l’exercice une finesse extraordinaire, pour
apercevoir des choses qui semblent à peine tomber sous les sens. Lecat1
rapporte l’histoire contenue dans les observations de physique, T. I I ,
p. 209 , d’une marchande à Amiens « qui comprenoit tout ce qu’on
lui disoit, en regardant seulement le mouvement des lèvres de celui
qui lui parloit ; elle boit de cette façon les conversations les plus suivies;
ces conversations étoient encore moins 'fatigantes que les autres;
car on pouvoit se dispenser d’articuler des sons , il suffisoit de remuer
les lèvres comme 011 le fait, quand on parle ; elle entendoit fort distinctement
, tandis qu’on ne s’entendoit pas soi-même. Si vous lui parliez
une langue étrangère, elle vous le disoit d’abord ».
Nous avons fait la même observation sur plusieurs sourds-muets ,
L . c. p. 74.