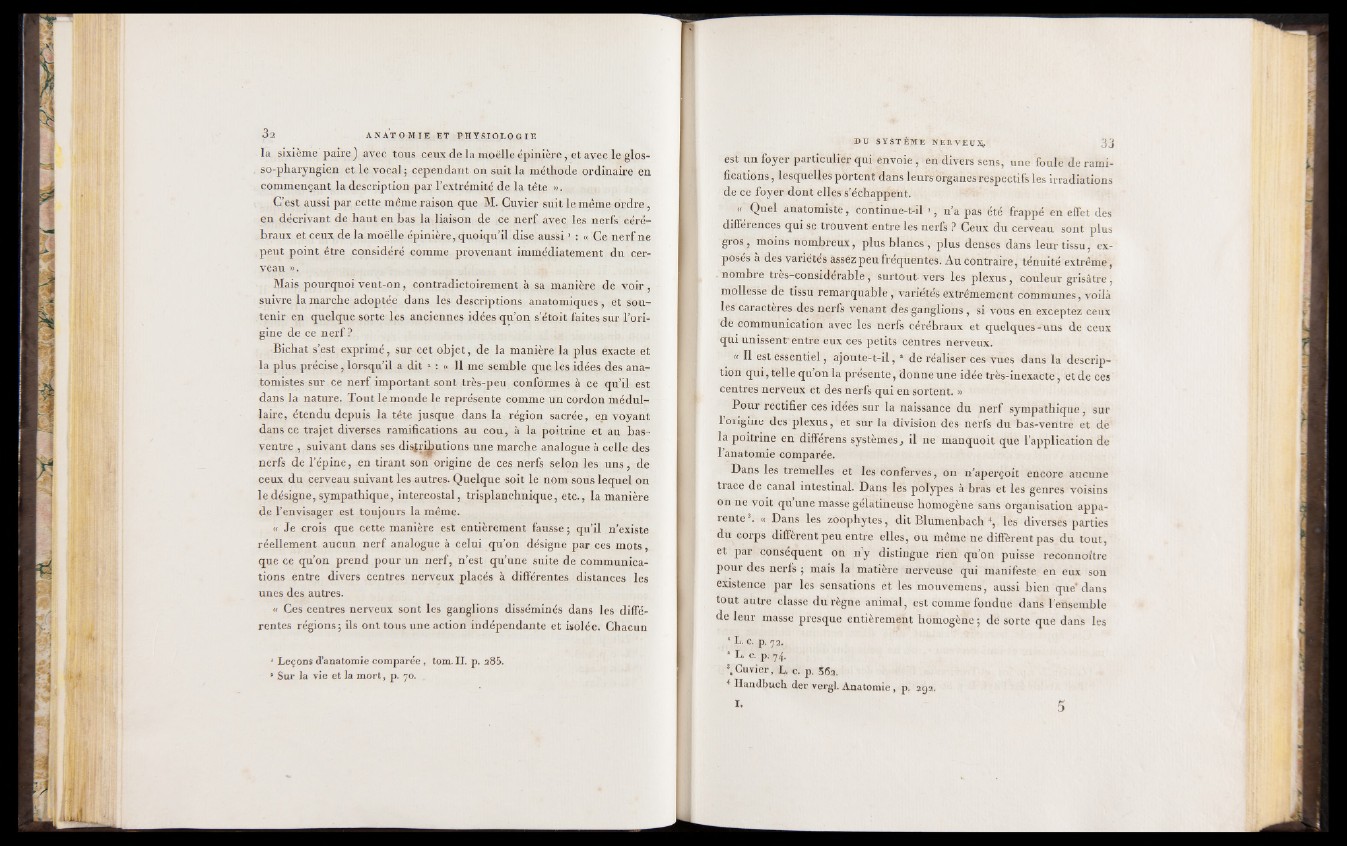
la sixième paire ) avec tous ceux de la moelle épinière, et avec le glos-
so-pharyngien et le vocal ; cependant on suit la méthode ordinaire en
commençant la description par l’extrémité de la tête ».
t C’est aussi par cette même raison que M. Cuvier suit le même ordre,
en décrivant de haut en bas la liaison de ce nerf avec les nerfs cérébraux
et ceux de la moëlle épinière, quoiqu’il dise aussi ■ : Ce nerf ne
peut point être considéré comme provenant immédiatement du cer-
yeau »,
Mais pourquoi veut-on, contradictoirement à sa manière de voir ,
suivre la marche adoptée dans les descriptions anatomiques, et soutenir
en quelque sorte les anciennes idées qu’on s’étoit faites sur l’origine
de ce nerf?
Bichat s’est exprimé, sur cet objet, de la manière la plus exacte et
la plus précise, lorsqu’il a dit 1 : « 11 me semble que les idées des anatomistes
sur ce nerf important sont très-peu conformes à ce qu’il est
dans la nature. Tout le monde le représente comme un cordon médullaire,
étendu depuis la tête jusque dans la région sacrée, en voyant
dans ce trajet diverses ramifications au cou, à la poitrine et au bas -
ventre , suivant dans ses distributions une marche analogue à celle des
nerfs de l’épine, en tirant son origine de ces nerfs selon les uns, de
ceux du cerveau suivant les autres. Quelque soit le nom sous lequel on
le désigne, sympathique, intercostal, trisplanchnique, etc., la manière
de l’envisager est toujours la même.
« Je crois que cette manière est entièrement fausse ; qu’il n’existe
réellement aucun nerf analogue à celui qu’on désigne par ces mots
que ce qu’on prend pour un nerf, n’est qu’une suite de communications
entre divers centres nerveux placés à différentes distances les
unes des autres.
« Ces centres nerveux sont les ganglions disséminés dans les différentes
régions; ils ont tous une action indépendante et isolée. Chacun
* Leçons d’anatomie comparée , tom. II. p. a85.
* Sur la vie et la mort, p. 70. .
est un foyer particulier qui envoie , en divers sens, une foule de ramifications,
lesquelles portent dans leurs organes respectifs les irradiations
de ce foyer dont elles s’échappent.
« Quel anatomiste, continue-t-il 1, n’a pas été frappé en effet des
différences qui se trouvent entre les nerfs ? Ceux du cerveau sont plus
gros , moins nombreux, plus blancs , plus denses dans leur tissu, exposés
a des variétés assez peu frequentes. Au contraire, ténuité extrême,
. nombre tres-considerable, surtout vers les plexus, couleur grisâtre ,
mollesse de tissu remarquable, variétés extrêmement communes, voilà
les caractères des nerfs venant des ganglions , si vous en exceptez ceux
de communication avec les nerfs cérébraux et quelques-uns de ceux
qui unissent-entre eux ces petits centres nerveux.
« Il est essentiel, ajoute-t-il, *- de réaliser ces vues dans la description
qui, telle qu’on la présente, donne une idée très-inexacte, et de ces
centres nerveux et des nerfs qui en sortent. »
Pour rectifier ces idées sur la naissance du nerf sympathique, sur
l’origine des plexus, et sur la division des nerfs du bas-ventre et de
la poitrine en différens systèmes, il ne manquoit que l’application de
l ’anatomie comparée.
Dans les tremelles et les conferves, on n’aperçoit encore aucune
trace de canal intestinal. Dans les polypes à bras et les genres voisins
on ne voit qu’une masse gélatineuse homogène sans organisation apparente3.
« Dans les zoophytes, dit Blumenbach 4, les diverses parties
du corps diffèrent peu entre elles, ou même ne diffèrent pas du tout,
et par conséquent on n’y distingue rien qu’on puisse reconnoi'tre
pour des nerfs ; mais la matière nerveuse qui manifeste en eux son
existence par les sensations et les mouvemens, aussi bien que* dans
tout autre classe du règne animal, est comme fondue dans l’ensemble
de leur masse presque entièrement homogène ; de sorte que dans les
* L. c. p. 72.
* L c. p. 74.
3,Cuvier, L, c. p. 5(5a.
4 Ilandbuch der vergl. Anatomie, p. 292.
I.