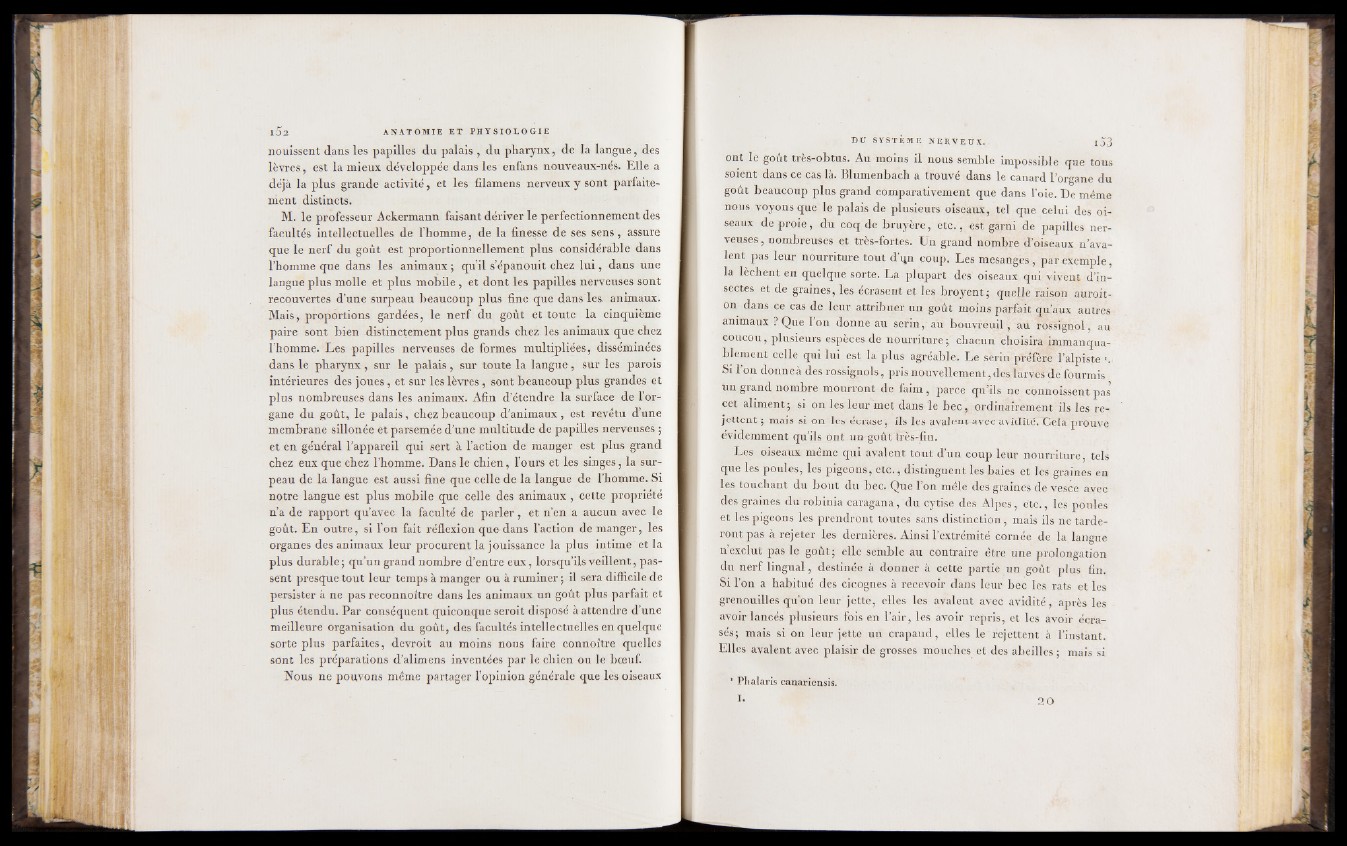
nouissent dans les papilles du palais , du pharynx, de la langue, des
lèvres, est la mieux développée dans les enfans nouveaux-nés. Elle a
déjà la plus grande activité, et les filamens nerveux y sont parfaitement
distincts.
M. le professeur Ackermann faisant dériver le perfectionnement des
facultés intellectuelles de l’homme, de la finesse de ses sens, assure
que le nerf du goût est proportionnellement plus considérable dans
l’homme que dans les animaux ; qu’il s’épanouit chez lu i , dans une
langue plus molle et plus mobile , et dont les papilles nerveuses sont
recouvertes d’une surpeau beaucoup plus fine que dans les. animaux.
Mais, proportions gardées, le nerf du goût et toute la cinquième
paire sont bien distinctement plus grands chez les animaux que chez
l ’homme. Les papilles nerveuses de formes multipliées, disséminées
dans le pharynx, sur le palais, sur toute la langue, sur les parois
intérieures des joues, et sur les lèvres , sont beaucoup plus grandes et
plus nombreuses dans les animaux. Afin d’étendre la surface de l’organe
du goût, le palais, chez beaucoup d’animaux, est revêtu d’une
membrane sillonée et parsemée d’une multitude de papilles nerveuses ;
et en général l’appareil qui sert à l’action de manger est plus grand
chez eux que chez l’homme. Dans le chien, l’ours et les singes, la surpeau
de la langue est aussi fine que celle de la langue de l’homme. Si
notre langue est plus mobile que celle des animaux , cette propriété
n’a de rapport qu’avec la faculté de parler, et n’en a aucun avec le
goût. En outre, si l’on fait réflexion que dans l’action de manger, les
organes des animaux leur procurent la jouissance la plus intime et la
plus durable ; qu’un grand nombre d’entre eux, lorsqu’ils veillent, passent
presque tout leur temps à manger ou à ruminer ; il sera difficile de
persister à ne pas reconnoître dans les animaux un goût plus parfait et
plus étendu. Par conséquent quiconque seroit disposé à attendre d’une
meilleure organisation du goût, des facultés intellectuelles en quelque
sorte plus parfaites, devroit au moins nous faire connoître quelles
sont les préparations d’alimens inventées par le chien ou le boeuf.
Nous ne pouvons même partager l’opinion générale que les oiseaux
ont le goût tres-obtus. Au moins il nous semble impossible que tous
soient dans ce cas là. Blumenbach a trouvé dans le canard l’organe du
goût beaucoup plus grand comparativement que dans l’oie. De même
nous voyons que le palais de plusieurs oiseaux, tel que celui des oiseaux
de proie, du coq de bruyère, etc. , est garni de papilles nerveuses
, nombreuses et très-fortes. Un grand nombre d’oiseaux n’avalent
pas leur nourriture tout d’qn coup. Les mésanges, par exemple,
la lechent en quelque sorte. La plupart des oiseaux qui vivent d’insectes
et de graines, les écrasent et les broyent; quelle raison auroit-
on dans ce cas de leur attribuer un goût moins parfait qu’aux autres
animaux ? Que l’on donne au'serin, au bouvreuil, au rossignol, au
coucou, plusieurs espèces de nourriture; chacun choisira immanquablement
celle qui lui est la plus agréable. Le serin préfère l’alpiste '.
Si l’on donne à des rossignols, pris nouvellement, des larves de fourmis
un grand nombre mourront de faim, parce qu’ils ne connoissent pas’
cet aliment; si on les leur met dans le bec, ordinairement ils les rejettent
; mais si on les écrase, ils les avalent avec avidité, Uela prouve
évidemment qu’ils ont un goût très-fin.
Les oiseaux même qui avalent tout d’un coup leur nourriture, tels
que les poules, les pigeons, etc., distinguent les baies et les graines en
les touchant du bout du bec. Que l’on mêle des graines de vesce avec
des graines du robinia caragana, du cytise des Alpes, etc., les poules
et les pigeons les prendront toutes sans distinction, mais ils ne tarderont
pas à rejeter les dernières. Ainsi l’extrémité cornée de la langue
n’exclut pas le goût; elle semble au contraire être une prolongation
du nerf lingual, destinée à donner à cette partie un goût plus fin.
Si l’on a habitué des cicognes à recevoir dans leur bec les rats et les
grenouilles qu’on leur jette, elles les avalent avec avidité, après les
avoir lancés plusieurs fois en l’air, les avoir repris, et les avoir écrasés;
mais si on leur jette un crapaud, elles le rejettent à l’instant.
Elles avalent avec plaisir de grosses mouches et des abeilles ; mais si
1 Phalaris canariensis.
I. 20