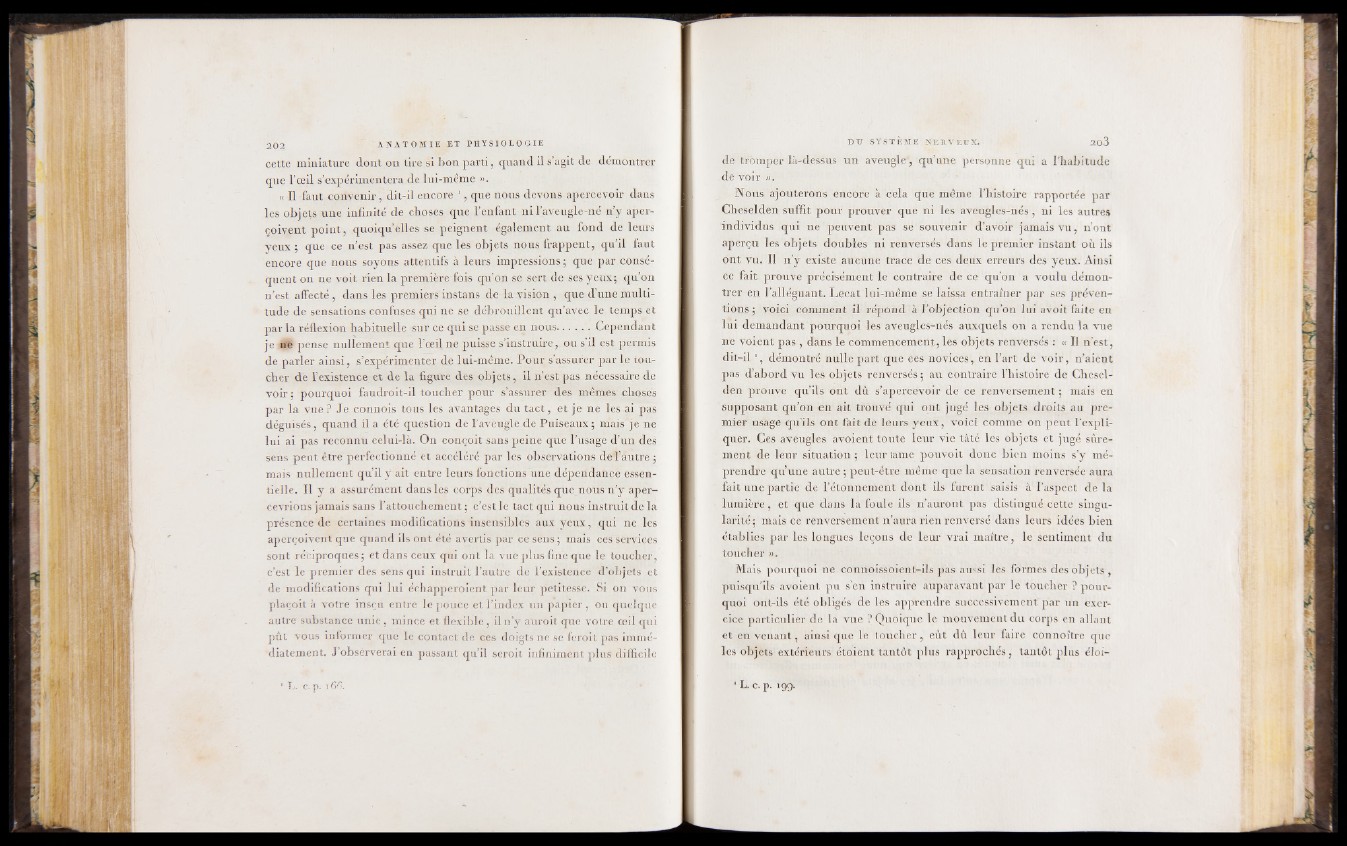
cette miniature dont on tire si bon parti, quand il s’agit de démontrer
que l’ceil s’expérimentera de lui-même ».
« Il faut convenir, dit-il encore ', que nous devons apercevoir dans
les objets une infinité de choses que l’enfant ni l’aveugle-né n’y aperçoivent
point, quoiqu’elles se peignent également au fond de leurs
yeux ; que ce n’est pas assez que les objets nous frappent, qu’il faut
encore que nous soyons attentifs à leurs impressions ; que par conséquent
on ne voit rien la première fois qu’on se sert de ses yeux; qu’on
n’est affecté, dans les premiers instans de la vision , que d’une multitude
de sensations confuses qui ne se débrouillent qu’avec le temps et
par la réflexion habituelle sur ce qui se passe en nous.. . . . . Cependant
je ne pense nullement que l’oeil ne puisse s’instruire, ou s’il est permis
de parler ainsi, s’expérimenter de lui-même. Pour s’assurer par le toucher
de l’existence et de la figure des objets, il n’est pas nécessaire de
voir ; pourquoi faudroit-il toucher pour s’assurer des mêmes choses
par la vue ? Je connois tous les avantages du tact, et je ne les ai pas
déguisés, quand il a été question de l’aveugle de Puiseaux; mais je ne
lui ai pas reconnu celui-là. On conçoit sans peine que l’usage d’un des
sens peut être perfectionné et accéléré par les observations de l’autre ;
mais nullement qu’il y ait entre leurs fonctions une dépendance essentielle.
Il y a assurément dans les corps des qualités que nous n’y apercevrions
jamais sans l’attouchement ; c’est le tact qui nous- instruit de la
présence de certaines modifications insensibles aux yeux, qui ne les
aperçoivent que quand ils ont été avertis par ce sens ; mais ces services
sont réciproques; et dans ceux qui ont la vue plus fine que le toucher,
c’est le premier des sens qui instruit l’autre de l ’existence d’objets et
de modifications qui lui échapperoient par leur petitesse. Si on vous
plaçoit à votre insçu entre le pouce et l’index un papier , ou quelque
autre substance unie , mince et flexible, il n’y auroit que votre oeil qui
pût vous informer que le contact de ces doigts ne se feroit pas immédiatement.
J’observerai en passant qu’il seroit infiniment plus difficile
de tromper là-dessus un aveugle', qu’une personne qui a l ’habitude
de voir sl'ljf-'?
Nous ajouterons encore à cela que même l’histoire rapportée par
Gheselden suffit pour prouver que ni les aveugles-nés , ni les autres
individus qui ne peuvent pas se souvenir d’avoir jamais vu, n’ont
aperçu les objets doubles ni renversés dans le premier instant où ils
ont vu. Il n’y existe aucune trace de ces deux erreurs des yeux. Ainsi
ce fait prouve précisément le contraire de ce qu’on a voulu démontrer
en l’alléguant. Lecat lui-même se laissa entraîner par ses préventions
; voici comment il répond à l ’objection qu’on lui avoit faite en
lui demandant pourquoi les aveugles-nés auxquels on a rendu la vue
ne voient pas , dans le commencement, les objets renversés : « Il n’est,
dit-il1, démontré nulle part que ces novices, en l’art de voir, n’aient
pas d’abord vu les objets renversés; au contraire l’histoire de Chesel-
den prouve qu’ils ont dû s’apercevoir de ce renversement ; mais en
supposant qu’on en ait trouvé qui ont jugé les objets droits au premier
usage qu’ils ont fait de leurs yeux, voici comme on peut l ’expliquer.
Ces aveugles avoient toute leur vie tâté les objets et jugé sûrement
de leur situation ; leur lame pouvoit donc bien moins s’y méprendre
qu’une autre ; peut-être même que la sensation renversée aura
fait une partie de l’étonnement dont ils furent saisis à l ’aspect de la
lumière, et que dans la foule ils n’auront pas distingué cette singularité;
mais ce renversement n’aura rien renversé dans leurs idées bien
établies par les longues leçons de leur vrai maître, le sentiment du
toucher ».
Mais pourquoi ne connoissoient-ils pas aussi les formes des objets
puisqu’ils avoient pu s’en instruire auparavant par le toucher ? pourquoi
ont-ils été obligés de les apprendre successivement par un exercice
particulier de la vue ? Quoique le mouvement du corps en allant
et en venant, ainsique le toucher, eût dû leur faire connoître que
les objets extérieurs étaient tantôt plus rapprochés, tantôt plus éloi