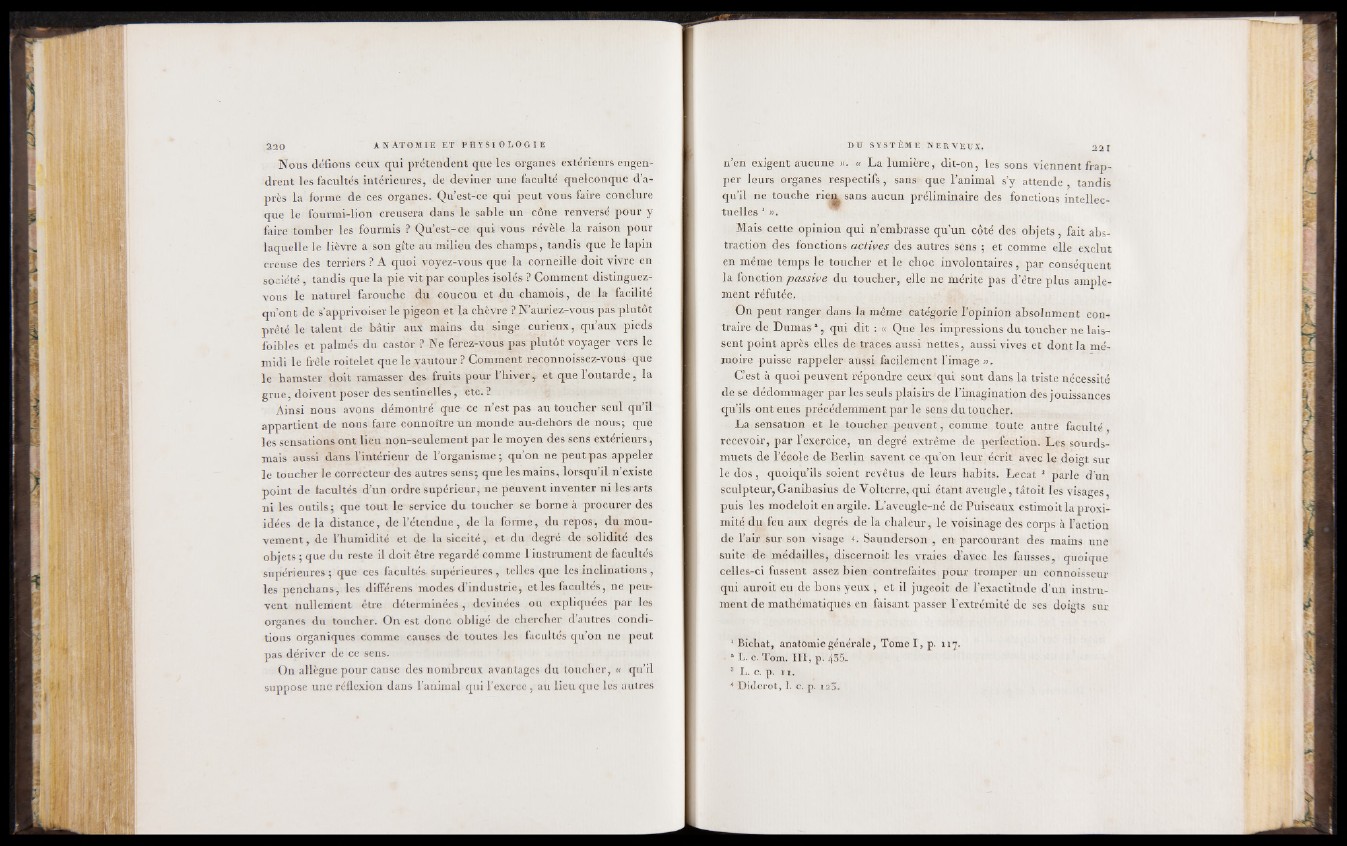
Nous défions ceux qui prétendent que les organes extérieurs engendrent
les facultés intérieures, de deviner une faculté quelconque d’après
la forme de ces organes. Qu’est-ce qui peut vous faire conclure
que le fourmi-lion creusera dans le sable un cône renversé pour y
faire tomber les fourmis ? Qu’est-ce qui vous révèle la raison pour
laquelle le lièvre a son gîte au milieu des champs, tandis que le lapin
creuse des terriers ? A quoi voyez-vous que la corneille doit vivre en
société , tandis que la pie vit par couples isolés ? Comment distinguez-
vous le naturel farouche du coucou et du chamois, de la facilité
qu’ont de s’apprivoiser le pigeon et la chèvre ? N’auriez-vous pas plutôt
prêté le talent de bâtir aux mains du singe curieux, qu’aux pieds
foibles et palmés du castor ? Ne ferez-vous pas plutôt voyager vers le
midi le frêle roitelet que le vautour ? Comment reconnoissez-vous que
le hamster doit ramasser des fruits pour l’hiver, et que 1 outarde, la
grue, doivent poser des sentinelles, etc.?
Ainsi nous avons démontré que ce n’est pas au toucher seul qu’il
appartient de nous faire connoitre un monde au-dehors de nous; que
les sensations ont lieu non-seulement par le moyen des sens extérieurs,
mais aussi dans l’intérieur de l’organisme ; qu’on ne peut pas appeler
le toucher le correcteur des autres sens; que les mains, lorsqu’il n’existe
point de facultés d’un ordre supérieur, ne peuvent inventer ni les arts
ni les outils; que tout le service du toucher se borne à procurer des
idées de la distance, de l’étendue, de la forme, du repos, du mouvement,
de l’humidité et de la siccité, et du degré de solidité des
objets ; que du reste il doit être regardé comme 1Instrument de facultés
supérieures; que ces facultés supérieures, telles que les inclinations ,
les penchans, les differens modes d’industrie, et les facultés, ne peuvent
nullement être déterminées, devinées ou expliquées par les
organes du toucher. On est donc obligé de chercher d autres conditions
organiques comme causes de toutes les facultés qu’on ne peut
pas dériver de ce sens.
On allègue pour cause des nombreux avantages du toucher, « qu’ri
suppose une réflexion dans l’animal qui l’exerce, au lieu que les autres
n’en exigent aucune », << La lumière, dit-on, les sons viennent frapper
leurs organes respectifs , sans« que l’animal s’y attende tandis
qu’il ne touche rien sans aucun préliminaire des fonctions intellectuelles
‘ ».
Mais cette opinion qui n’embrasse qu’un côté des objets, fait abstraction
des fonctions actives des autres sens ; et comme elle exclut
en même temps le toucher et le choc involontaires, par conséquent
la fonction passive du toucher, elle ne mérite pas d’être plus amplement
réfutée.
On peut ranger dans la même catégorie l ’opinion absolument contraire
de Dumas *, qui dit : « Que les impressions du toucher ne laissent
point après elles de traces aussi nettes, aussi vives et dont la mémoire
puisse rappeler aussi facilement l’image »,
C’est à quoi peuvent répondre ceux qui sont dans la triste nécessité
de se dédommager par les seuls plaisirs de l’imagination des jouissances
qu’ils ont eues précédemment par le sens du toucher.
La sensation et le toucher peuvent, comme toute autre“ faculté
recevoir, par l’exercice, un degré extrême de perfection, Les sourds-
muets de l’école de Berlin savent ce qu’on leur écrit avec 1« doigt sur
le dos, quoiqu’ils soient revêtus de leurs habits. Lecat 3 parle d’un
sculpteur, Ganibasius de Volterre, qui étant aveugle, tâtoit les visages,
puis les modeloit en argile. L ’aveugle-né de Puiseaux estimoit la proximité
du feu aux degrés de la chaleur, le voisinage des corps à l’action
de l’air sur son visage *. Saunderson , en parcourant des mains une
suite de médailles, discernoit les vraies d’avec les fausses, quoique
celles-ci fussent assez bien contrefaites pour tromper un connoisseur
qui auroit eu de bons yeux , et il jugeoit de l’exactitude d’un instrument
de mathématiques en faisant passer l’extrémité de ses doigts sur
1 Bichat, anatomie générale, Tome I, p.
. L. c. Tom. III, p. 455-
3 L. C. p. I L
I Diderot, I. c. p. 123.