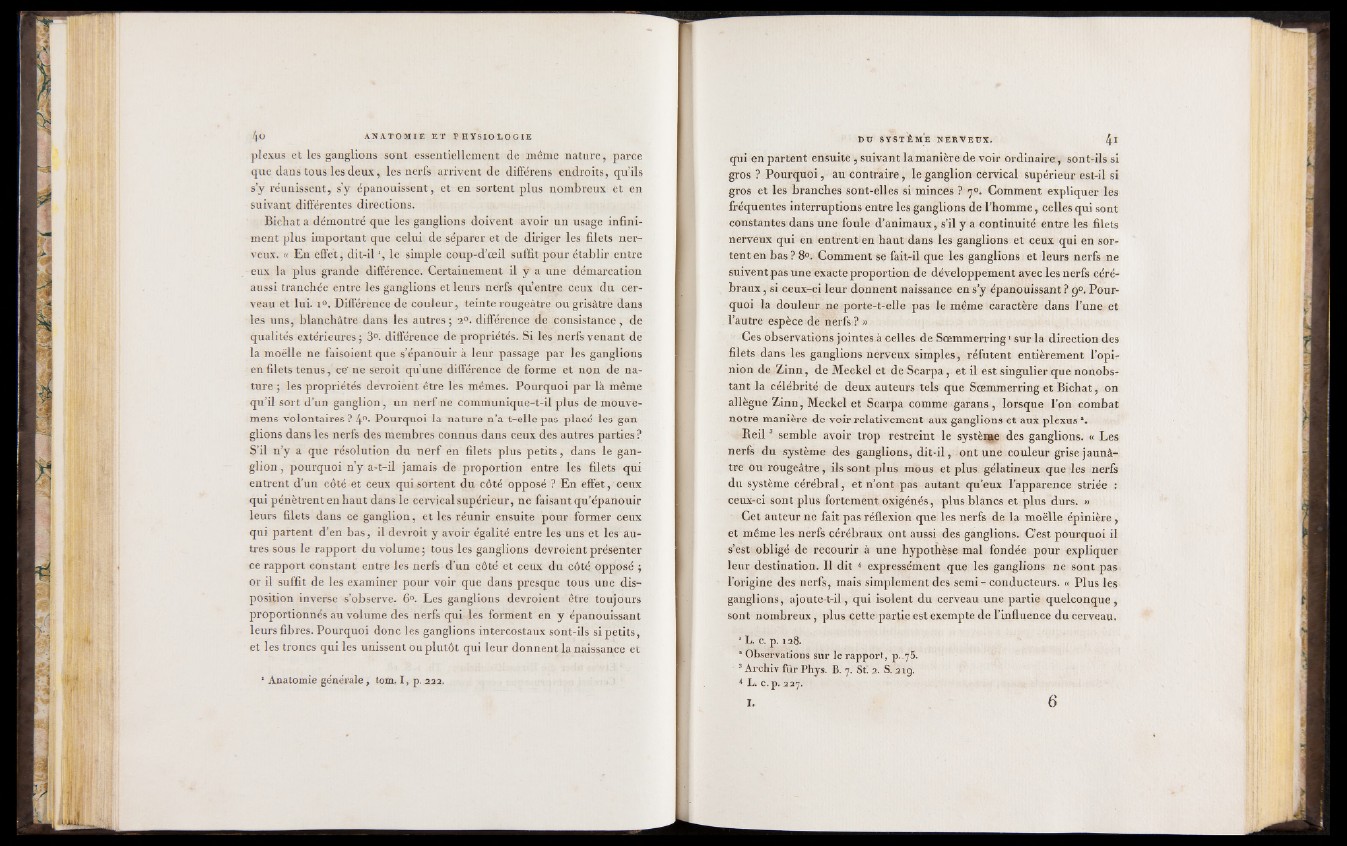
I /? >
uüL
plexus et les ganglions sont essentiellement de meme nature, parce
que dans tous les deux, les nerfs arrivent de différens endroits, qu’ils
s’y réunissent, s’y épanouissent, et en sortent plus nombreux et en
suivant différentes directions.
Bichat a démontré que les ganglions doivent avoir un usage infiniment
plus important que celui de séparer et de diriger les filets nerveux.
« En effet, dit-il *, le simple coup-d’oeil suffit pour établir entre
eux la plus grande différence. Certainement il y a une démarcation
aussi tranchée entre les ganglions et leurs nerfs qu’entre ceux du cerveau
et lui. i°. Différence de couleur, teinte rougeâtre ou grisâtre dans
les uns, blanchâtre dans les autres; 2°. différence de consistance, de
qualités extérieures ; 3°. différence de propriétés. Si les nerfs venant de
la moëlle ne faisoient que s’épanouir à leur passage par les ganglions
en filets tenus, ce' ne seroit qu’une différence de forme et non de nature
; les propriétés devroient être les mêmes. Pourquoi par là même
qu’il sort d’un ganglion, un nerf ne communique-t-il plus de mouve-
mens volontaires ? 4°. Pourquoi la nature n’a-t-elle pas placé les ganglions
dans les nerfs des membres connus dans ceux des autres parties ?
S’il n’y a que résolution du nerf en filets plus petits, dans le ganglion
, pourquoi n’y a-t-il jamais de proportion entre les filets qui
entrent d’un côté et ceux qui sortent du côté opposé? En effet, ceux
qui pénètrent en haut dans le cervical supérieur, ne faisant qu’épanouir
leurs filets dans ce ganglion, et les réunir ensuite pour former ceux
qui partent d’en bas, il devroit y avoir égalité entre les uns et les autres
sous le rapport du volume; tous les ganglions devroient présenter
ce rapport constant entre les nerfs d’un côté et ceux du côté opposé ;
or il suffit de les examiner pour voir que dans presque tous une disposition
inverse s’observe. 6°. Les ganglions devroient être toujours
proportionnés au volume des nerfs qui les forment en y épanouissant
leurs fibres. Pourquoi donc les ganglions intercostaux sont-ils si petits,
et les troncs qui les unissent ou plutôt qui leur donnent la naissance et
1 Anatomie générale, tom. I, p. 222.
qui en partent ensuite , suivant la manière de voir ordinaire , sont-ils si
gros ? Pourquoi, au contraire, le ganglion cervical supérieur est-il si
gros et les branches sont-elles si minces ? 70. Comment expliquer les
fréquentes interruptions entre les ganglions de l’homme, celles qui sont
constantes dans une foule d’animaux, s’il y a continuité entre les filets
nerveux qui en entrent en haut dans les ganglions et ceux qui en sortent
en bas ? 8°. Comment se fait-il que les ganglions et leurs nerfs ne
suiventpasune exacte proportion de développement avec les nerfs cérébraux
, si ceux-ci leur donnent naissance en s’y épanouissant ? 90. Pourquoi
la douleur ne porte-t-elle pas le même caractère dans l’une et
l’autre espèce de nerfs ? »
Ces observations jointes à celles de Soemmerring1 sur la direction des
filets dans les ganglions nerveux simples, réfutent entièrement l’opinion
de Zinn, de Meckel et de Scarpa, et il est singulier que nonobstant
la célébrité de deux auteurs tels que Soemmerring et Bichat, on
allègue Zinn, Meckel et Scarpa comme garans , lorsque l’on combat
notre manière de voir relativement aux ganglions et aux plexus \
B e il3 semble avoir trop restreint le système des ganglions. « Les
nerfs du système des ganglions, dit-il, ont une couleur grise jaunâtre
ou rougeâtre, ils sont plus mous et plus gélatineux que les nerfs
du système cérébral, et n’ont pas autant qu’eux l’apparence striée :
ceux-ci sont plus fortement oxigénés, plus blancs et plus durs. »
Cet auteur ne fait pas réflexion que les nerfs de la moëlle épinière ,
et même les nerfs cérébraux ont aussi des ganglions. C’est pourquoi il
s’est obligé de recourir à une hypothèse mal fondée pour expliquer
leur destination. Il dit 4 expressément que les ganglions ne sont pas
l’origine des nerfs, mais simplement des semi - conducteurs. « Plus les
ganglions, ajoute-t-il, qui isolent du cerveau une partie quelconque,
sont nombreux, plus cette partie est exempte de l’influence du cerveau.
* L, c. p. 128-
* Observations sur le rapport, p..75,
■ 3 Archiv fur Phys. B. 7. Sti 2. S. 21g.
4 L. c. p. 227.
I. 6