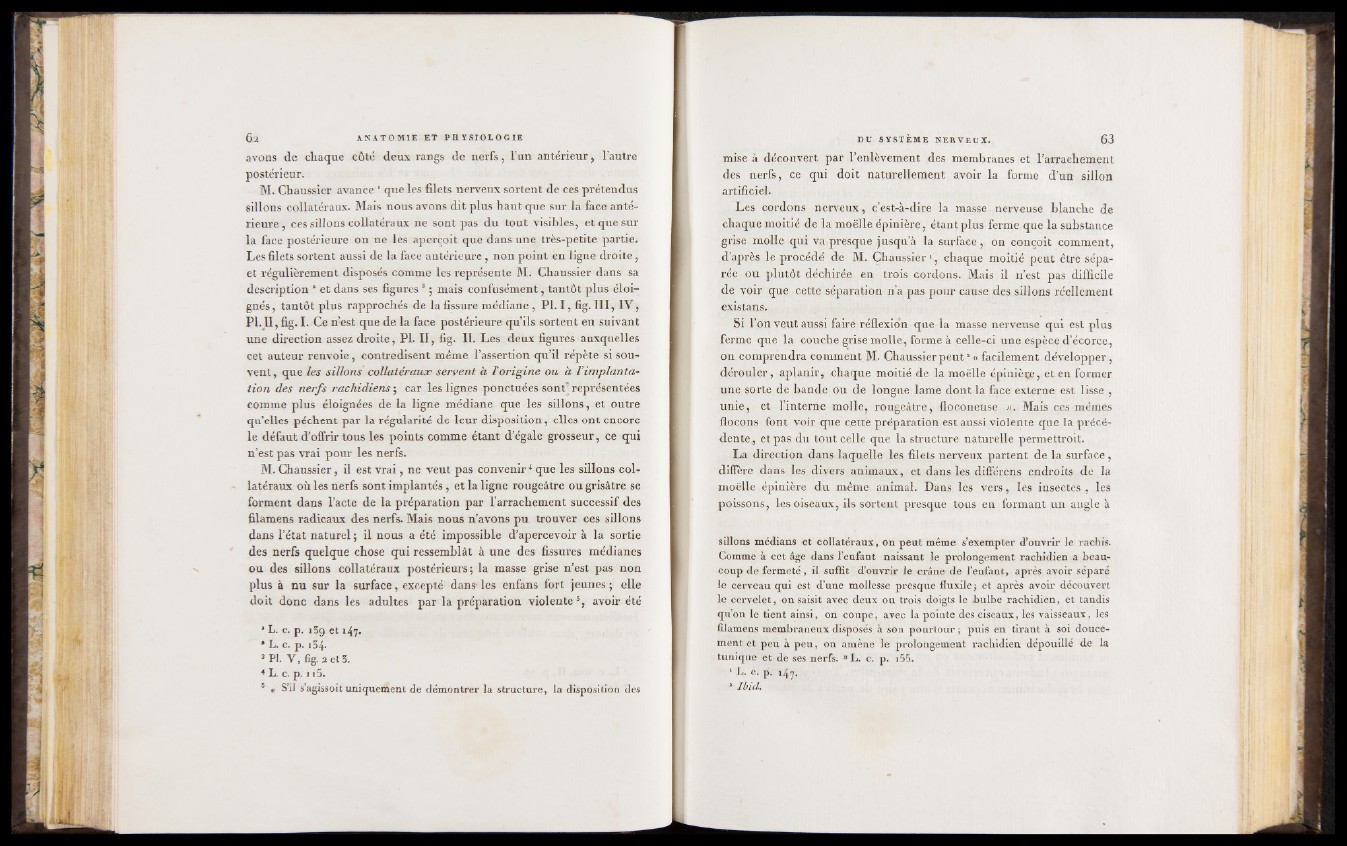
a
avons de chaque côté deux rangs de nerfs, l’un antérieur, l’autre
postérieur.
M. Chaussier avance ‘ que les filets nerveux sortent de ces prétendus
sillons collatéraux. Mais nous avons dit plus haut que sur la face antérieure
, ces sillons collatéraux ne sont pas du tout visibles, et que sur
la face postérieure on ne les aperçoit que dans une très-petite partie.
Les filets sortent aussi de la face antérieure, non point en ligne droite,
et régulièrement disposés comme les représente M. Chaussier dans sa
description * et dans ses figures3 ; mais confusément, tantôt plus éloignés
, tantôt plus rapprochés de la fissure médiane , PI. I , fig. III, IV ,
PL H, fig. I. Ce n’est que de la face postérieure qu’ils sortent en suivant
une direction assez droite, PL II, fig. IL Les deux figures auxquelles
cet auteur renvoie, contredisent même l’assertion qu’il répète si souvent
, que les sillons collatéraux servent à T origine ou à l ’implantation
des nerfs rachidiens ; car les lignes ponctuées sont’ représentées
comme plus éloignées de la ligne médiane que les sillons, et outre
qu’elles pèchent par la régularité de leur disposition, elles ont encore
le défaut d’offrir tous les points comme étant d’égale grosseur, ce qui
n’est pas vrai pour les nerfs.
M. Chaussier, il est vrai, ne veut pas convenir4 que les sillons collatéraux
où les nerfs sont implantés, et la ligne rougeâtre ou grisâtre se
forment dans l’acte de la préparation par l’arrachement successif des
filamens radicaux des nerfs. Mais nous n’avons pu trouver ces sillons
dans l ’état naturel ; il nous a été impossible d’apercevoir à la sortie
des nerfs quelque chose qui ressemblât à une des fissures médianes
ou des sillons collatéraux postérieurs; la masse grise n’est pas non
plus à nu sur la surface, excepté dans- les enfans fort jeunes ; elle
doit donc dans les adultes par la préparation violente 5, avoir été
' L. c. p. r3g et 147.
* L. c. p. 134.
3 PI. V, fig. 2 et 5.
4 L. c. p. 115.
5 « S’il s’agissoit uniquement de démontrer la structure, la disposition des
mise à découvert par l’enlèvement des membranes et l ’arrachement
des nerfs, ce qui doit naturellement avoir la forme d’un sillon
artificiel.
Les cordons nerveux, c’est-à-dire la masse nerveuse blanche de
chaque moitié de la moelle épinière, étant plus ferme que la substance
grise molle qui va presque jusqu’à la surface, on conçoit comment,
d’après le procédé de M. Chaussier 1, chaque moitié peut être séparée
ou plutôt déchirée en trois cordons. Mais il n’est pas difficile
de voir que cette séparation n’a pas pour cause des sillons réellement
existans.
Si l’on veut aussi faire réflexion que la masse nerveuse qui est plus
ferme que la couche grise molle-j forme à celle-ci une espèce d’écorce,
on comprendra comment M. Chaussier peut * « facilement développer,
dérouler, aplanir, chaque moitié de la moelle épinièçe, et en former
une sorte de bande ou de longue lame dont la face externe est lisse ,
unie, et l’interne molle, rougeâtre, floconeuse ». Mais ces mêmes
flocons font voir que cette préparation est aussi violente que la précédente,,
et pas du tout celle que la structure naturelle permettroit.
La direction dans laquelle les filets nerveux partent de la surface,
diffère dans les divers animaux, et dans les différens endroits de la
moëlle épinière du même animal. Dans les vers, les insectes , les
poissons, les oiseaux, ils sortent presque tous en formant un angle à
sillons médians et collatéraux, on peut même s’exempter d’ouvrir le rachis.
Comme à cet âge dans l’enfant naissant le prolongement rachidien a beaucoup
de fermeté, il suffit d’ouvrir le crâne de l’enfant, après avoir séparé
le cerveau qui est d’une mollesse presque fluxile; et après avoir découvert
le cervelet, on saisit avec deux ou trois doigts le Jbulbe rachidien, et tandis
qu’on le tient ainsi, on coupe, avec la pointe des ciseaux, les vaisseaux, les
filamens membraneux disposés à son pourtour ; puis en tirant à soi doucement
et peu à peu, on amène le prolongement rachidien dépouillé de la
tunique et de ses nerfs. ” L. c. p. i55.
‘ L- c- P- >47- a Ibid.