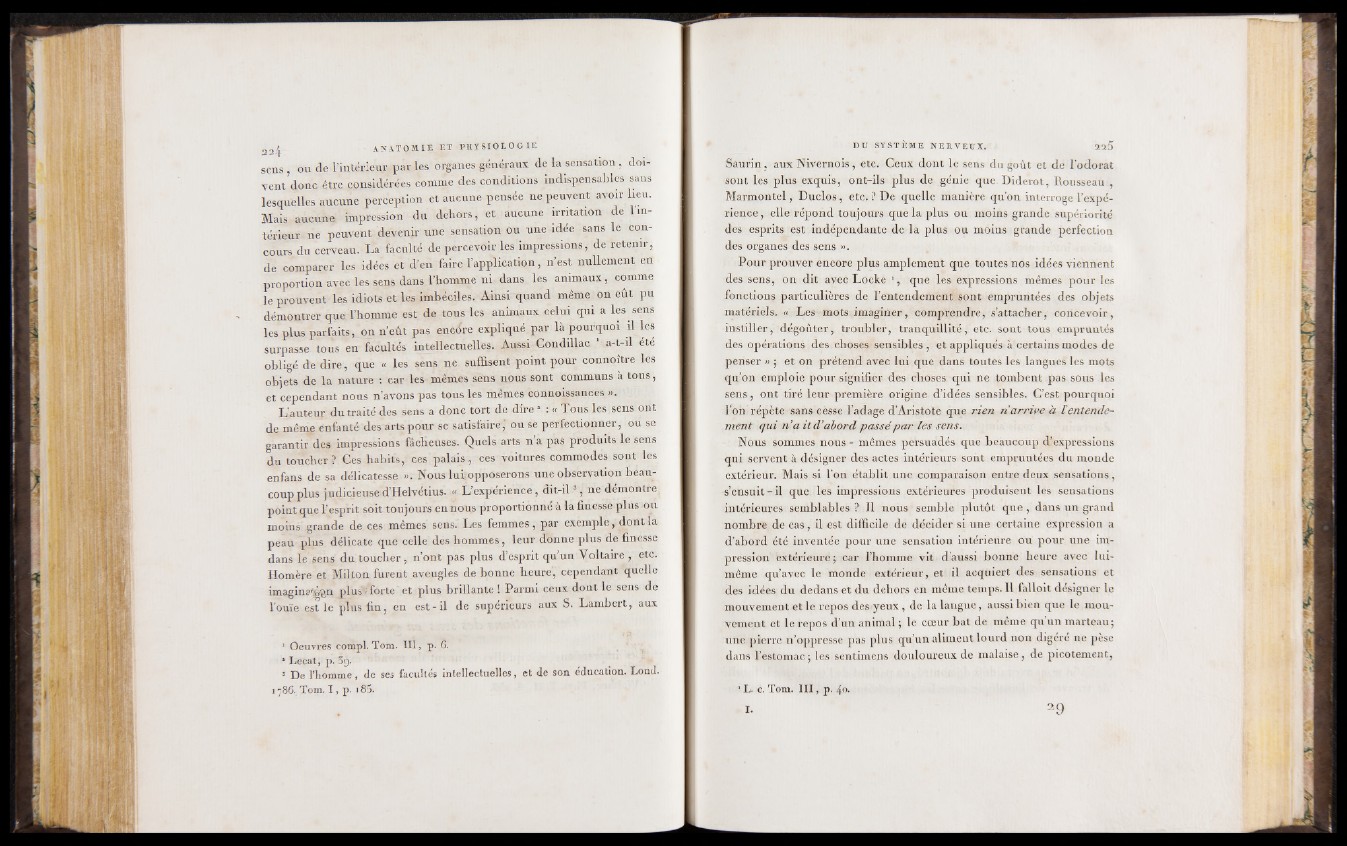
sens , ou de l’intérieur par les organes généraux de la sensation , doivent
donc être considérées comme des conditions indispensables sans
lesquelles aucune perception et aucune pensée ne peuvent avoir lieu.
Mais aucune impression du dehors, et aucune irritation de l’intérieur
ne peuvent devenir une sensation ou une idée sans le concours
du cerveau. La faculté de percevoir les impressions,' de retenir,
de comparer les idées et d’en faire l’application, n’est nullement en
proportion avec les sens dans l’homme ni dans les animaux, comme
le prouvent les idiots et les imbéciles. Ainsi quand même on eût pu
démontrer que l’homme est de tous les animaux celui qui a les sens
les plus parfaits, on n’eût pas encore expliqué par là pourquoi il les
surpasse tous en facultés intellectuelles. Aussi Condillac 1 a-t-il été
obligé de dire, que « les sens ne suffisent point pour connoître les
objets de la nature : car les mêmes sens nous sont communs à tous,
et cependant nous n’avons pas tous les mêmes connoissances ».
L’auteur du traité des sens a donc tort de dire * : « Tous les sens ont
de même enfanté des arts pour se satisfaire,’ ou se perfectionner, ou se
garantir des impressions fâcheuses. Quels arts n a pas produits le sens
du toucher? Ces habits, ces palais, ces voitures commodes sont les
enfans de sa délicatesse ». Nous lui;opposerons une observation beaucoup
plus judicieuse d’Helvétius. « L ’expérience, dit-il1 * 3, ne démontre
point que l’esprit soit toujours en nous proportionné à la finesse plus ou
moins grande de ces mêmes sens. Les femmes, par exemple, dont la
peau plus délicate que celle des hommes, leur donne plus de finesse
dans le sens du toucher , n’ont pas plus d’esprit qu’un Voltaire , etc.
Homère et Milton furent aveugles de bonne heure, cependant quelle
imagina^ô-gn plus ; forte et plus brillante ! Parmi ceux dont le sens de
l’ouïe est le plus fin, en est-il de supérieurs aux S. Lambert, aux
1 Oeuvres compl. Tom. III, p. 6.
* Lecat, p. 3g.
3 De l’homme, de ses facultés intellectuelles, et de son éducation. Lond.
1786. Tom. I , p. 185.
Saurin, aux Nivernois, etc. Ceux dont le sens du goût et de l'odorat
sont les plus exquis, ont-ils plus de génie que Diderot, Rousseau
Marmontel, Duclos, etc. ? De quelle manière qu’on interroge l’expérience,
elle répond toujours que la plus ou moins grande supériorité
des esprits est indépendante de la plus ou moins grande perfection
des organes des sens ».
Pour prouver encore plus amplement que toutes nos idées viennent
des sens, on dit avec Locke *, que les expressions mêmes pour les
fonctions particulières de l ’entendement sont empruntées des objets
matériels. « Les mots imaginer, comprendre, s’attacher, concevoir,
instiller, dégoûter, troubler, tranquillité, etc. sont tous empruntés
des opérations des choses sensibles, et appliqués à certains modes de
penser » ; et on prétend avec lui que dans toutes les langues les mots
qu’on emploie pour signifier des choses qui ne tombent pas sous les
sens, ont tiré leur première origine d’idées sensibles. C’est pourquoi
l’on répète sans cesse l’adage d’Aristote que rien n’arrive à ïentendement
qui n’a it d’abord passé par les sens.
Nous sommes nous - mêmes persuadés que beaucoup d’expressions
qui servent à désigner des actes intérieurs sont empruntées du monde
extérieur. Mais si l’on établit une comparaison entre deux sensations,
s’ensuit-il que les impressions extérieures produisent les sensations
intérieures semblables ? Il nous semble plutôt que, dans un grand
nombre de cas, il est difficile de décider si une certaine expression a
d’abord été inventée pour une sensation intérieure ou pour une impression
extérieure ; car l’homme vit d aussi bonne heure avec lui-
même qu’avec le monde extérieur, et il acquiert des sensations et
des idées du dedans et du dehors en même temps. Il falloit désigner le
mouvement et le repos des yeux, de la langue, aussi bien que le mouvement
et le repos d’un animal ; le coeur bat de même qu un marteau;
une pierre n’oppresse pas plus qu’un aliment lourd non digéré ne pese
dans l’estomac; les sentimens douloureux de malaise, de picotement,
1L. c. Tom. II I, p. 40.
I. 2 9