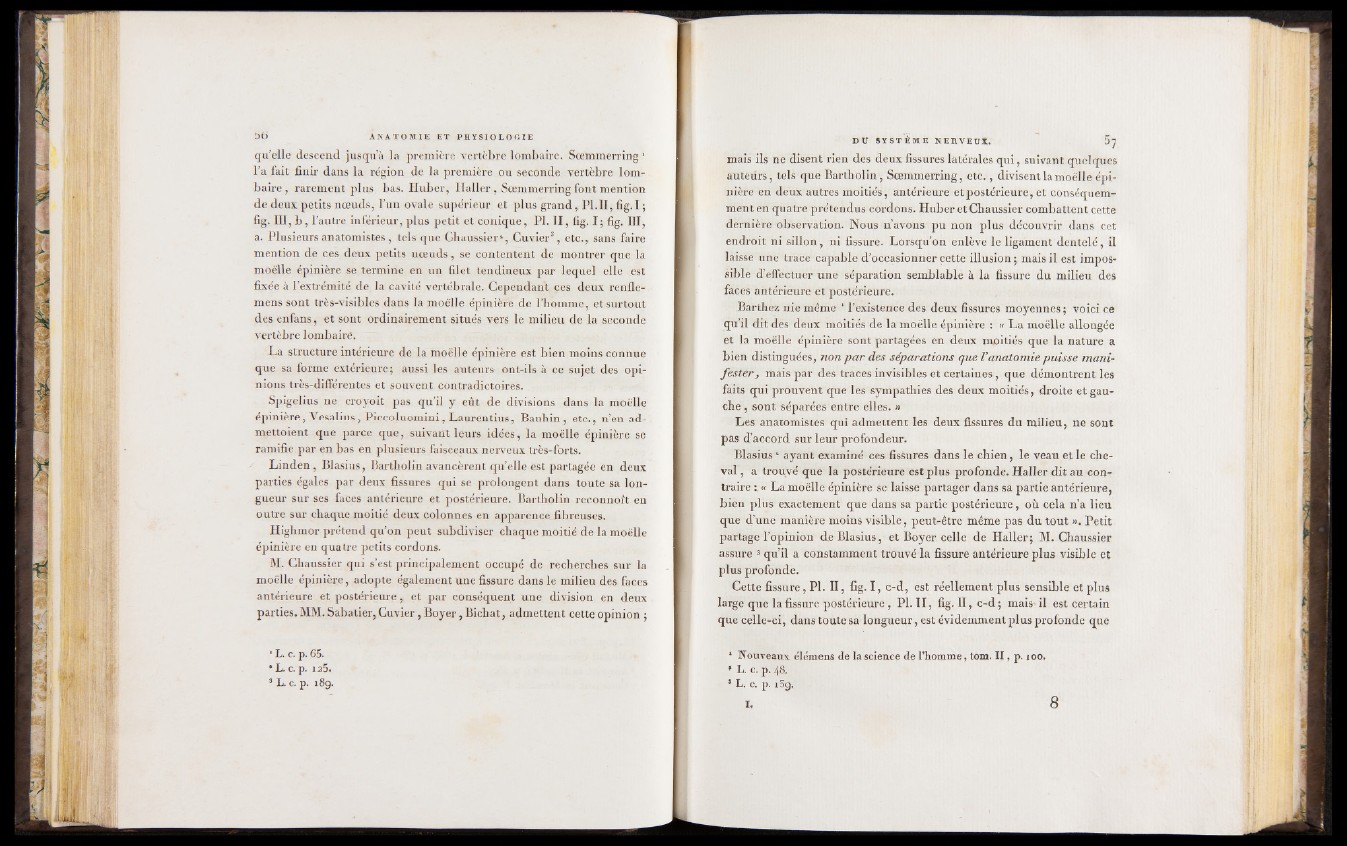
qu’elle descend jusqu’à la première vertèbre lombaire. Soemmerring 1
l’a fait finir dans la région de la première ou seconde vertèbre lombaire
, rarement plus bas. Huber, Haller, Soemmerring font mention
de deux petits noeuds, l’un ovale supérieur et plus grand, PI.Il, fig.I;
fig. III, b , l’autre inférieur, plus petit et conique, PI. II, fig. I; fig. III,
a. Plusieurs anatomistes, tels que Chaussier“, Cuvier3, etc., sans faire
mention de ces deux petits noeuds, se contentent de montrer que la
moelle épinière se termine en un filet tendineux par lequel elle est
fixée à l'extrémité de la cavité vertébrale. Cependant ces deux renfle-
mens sont très-visibles dans la moelle épinière de l’homme, et surtout
des enfans, et sont ordinairement situés vers le milieu de la seconde
vertèbre lombaire.
La structure intérieure de la moelle épinière est bien moins connue
que sa forme extérieure; aussi les auteurs^ ont-ils à ce sujet des opinions
très-différentes et souvent contradictoires.
Spigelius ne croyoit pas qu’il y eût de divisions dans la moelle
épinière, Vesalius, Piccoluomini , Laurentius, Bauhin , etc., n’en ad-
mettoient que parce que, suivant leurs idées, la moelle épinière se
ramifie par en bas en plusieurs faisceaux nerveux très-forts.
Linden, Blasius, Bartbolin avancèrent qu’elle est partagée en deux
parties égales par deux fissures qui se prolongent dans toute sa longueur
sur ses faces antérieure et postérieure. Bartholin reconnoît en
outre sur chaque moitié deux colonnes en apparence fibreuses.
Highmor prétend qu’on peut subdiviser chaque moitié de la moëlle
épinière en quatre petits cordons.
M. Chaussier qui s’est principalement occupé de recherches sur la
moëlle épinière, adopte également une fissure dans le milieu des faces
antérieure et postérieure, et par conséquent une division en deux
parties. MM. Sabatier, Cuvier, Boyer, Bichat, admettent cette opinion ;
■ L. c. p. 65.
* L. c. p. 125.
3 L. c. p. 189.
mais ils ne disent rien des deux fissures latérales qui, suivant quelques
auteurs, tels que Bartholin, Soemmerring, etc., divisent la moëlle épinière
en deux autres moitiés, antérieure et postérieure, et conséquemment
en quatre prétendus cordons. Huber et Chaussier combattent cette
dernière observation. Nous n’avons pu non plus découvrir dans cet
endroit ni sillon, ni fissure. Lorsqu’on enlève le ligament dentelé, il
laisse une trace capable d’occasionner cette illusion; mais il est impossible
d’effectuer une séparation semblable à la fissure du milieu des
faces antérieure et postérieure.
Barthez nie même 1 l’existence des deux fissures moyennes ; voici ce
qu’il dit dés deux moitiés de la moëlle épinière : « La moëlle allongée
et la moëlle épinière sont partagées en deux moitiés que la nature a
bien distinguées, non par des séparations que l ’anatomie puisse manifester,
mais par des traces invisibles et certaines, que démontrent les
faits qui prouvent que les sympathies des deux moitiés, droite et gauche
, sont séparées entre elles. »
Les anatomistes qui admettent les deux fissures du milieu, ne sont
pas d’accord sur leur profondeur.
Blasius“ ayant examiné ces fissures dans le chien, le veau et le cheval
, a trouvé que la postérieure est plus profonde. Haller dit au contraire
« La moëlle épinière se laisse partager dans sa partie antérieure,
bien plus exactement que dans sa partie postérieure, où cela n’a lieu
que dune manière moins visible, peut-être même pas du tout ». Petit
partage l ’opinion de Blasius, et Boyer celle de Haller; M. Chaussier
assure 3 qu’il a constamment trouvé la fissure antérieure plus visible et
plus profonde.
Cette fissure, PI. II, fig. I , c-d, est réellement plus sensible et plus
large que la fissure postérieure, PL I I , fig. II, c-d ; mais- il est certain
que celle-ci, dans toute sa longueur, est évidemment plus profonde que
* Nouveaux élémens de la science de l’homme, tom. I l , p. joo.
f L. c. p. 48,
5 L. c. p. 13g,