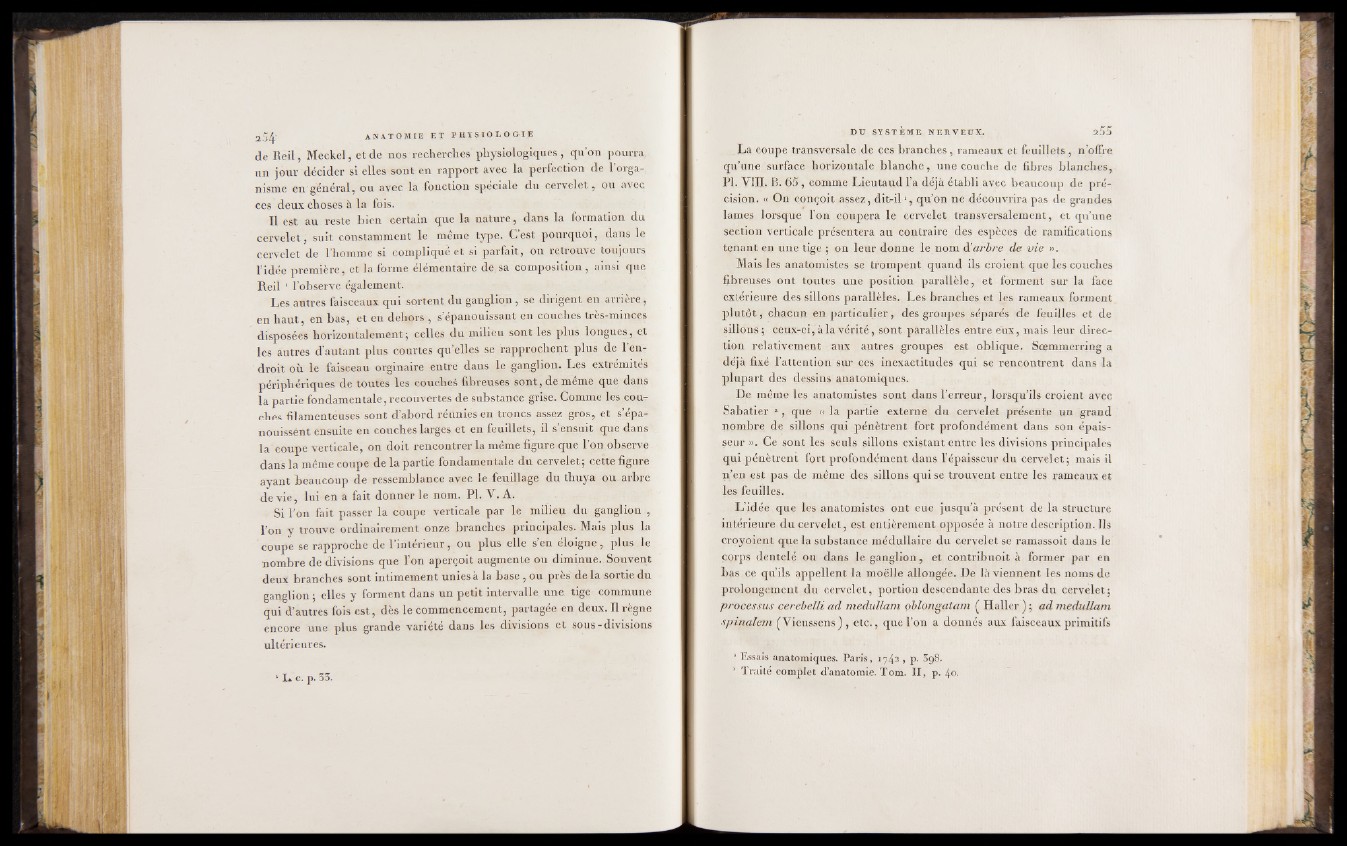
de Reil, Meckel, et de nos recherches physiologiques, qu’on pourra,
un jour décider si elles sont en rapport avec la perfection de l'organisme
en'général, ou avec la fonction spéciale du cervelet, ou avec
ces deux choses à la fois.
Il est au reste bien certain que la nature, dans la formation du
cervelet, suit constamment le même type. C’est pourquoi, dans le
cervelet de l’homme si compliqué et si parfait, on retrouve toujours
l’idée première, et la forme élémentaire de sa composition , ainsi que
Reil ’ l’observe également.
Les autres faisceaux qui sortent du ganglion, se dirigent en arrière,
en haut, en bas, et en dehors , s épanouissant en couches tres-mmces
disposées horizontalement; celles du milieu sont les plus longues , et
les autres d’autant plus courtes qu’elles se rapprochent plus de 1 endroit
où le faisceau orginaire entre dans le ganglion. Les extrémités
périphériques de toutes les couches fibreuses sont, de même que dans
la partie fondamentale, recouvertes de substance grise. Comme les couches
filamenteuses sont d’abord réunies en troncs assez gros,, et s’épanouissent
ensuite en couches larges et en feuillets, il s’ensuit que dans
la coupe verticale, on doit rencontrer la même figure que l ’on observe
dans la même coupe de la partie fondamentale du cervelet, cette figure
ayant beaucoup de ressemblance avec le feuillage du thuya ou arbre
de vie, lui en a fait donner le nom. PI. Y. A.
Si l’on fait passer la coupe verticale par le milieu du ganglion.,
l’on y trouve ordinairement onze branches principales. Mais plus la
coupe se rapproche de l’intérieur, ou plus elle s’en éloigne, plus le
nombre de divisions que l’on aperçoit augmente ou diminue.. Souvent
deux branches sont intimement unies à la base , ou près de la sortie du
ganglion ; elles y forment dans un petit intervalle une tige commune
qui d’autres fois est, dès le commencement, partagée en deux. Il règne
encore une plus grande variété dans les divisions et sous - divisions
ultérieures.
I* c. p. 35.
La coupe transversale de çes branches, rameaux et feuillets , n’offre
qu’une surface horizontale blanche, une couche de fibres blanches,
PI. VIII. B. 65, comme Lieutaud l’a déjà établi avec beaucoup de précision.
« On conçoit assez, dit-il1, qu’on ne découvrira pas de grandes
lames lorsque l’on coupera le cervelet transversalement, et qu’une
section verticale présentera au contraire des espèces de ramifications
tenant en une tige ; on leur donne le nom d’arbre de vie ».
Mais les anatomistes se trompent quand ils croient que les couches
fibreuses ont toutes une position parallèle, et forment sur la face
extérieure des sillons parallèles. Les branches et les rameaux forment
plutôt, chacun en particulier, des groupes séparés de feuilles et de
sillons; ceux-ci, à la vérité, sont parallèles entre eux, mais leur direction
relativement aux autres groupes est oblique. Soemmerring a
déjà fixé l’attention sur ces inexactitudes qui se rencontrent dans la
plupart des dessins anatomiques.
De même les anatomistes sont dans l ’erreur, lorsqu’ils croient avec
Sabatier *, que « la partie externe du cervelet présente un grand
nombre de sillons qui pénètrent fort profondément dans son épaisseur
». Ce sont les seuls sillons existant entre les divisions principales
qui pénètrent fort profondément dans l’épaisseur du cervelet; mais il
n’en est pas de même des sillons qui se trouvent entre les rameaux et
les feuilles.
L ’idée que les anatomistes ont eue jusqu’à présent de la structure
intérieure du cervelet, est entièrement opposée à notre description. Us
croyoient que la substance médullaire du cervelet se ramassoit dans le
corps dentelé ou dans le ganglion, et contribuoit à former par en
bas ce qu’ils appellent la moelle allongée. De là viennent les noms de
prolongement du cervelet, portion descendante des bras du cervelet;
processus cerebelli ad medullam oblongatam Ç Haller ) ; ad medullam
spinalem (Vieussens), etc., que l’on a donnés aux faisceaux primitifs
1 Essais anatomiques. Paris, 1742 , p. 598.
' Traité complet d’anatomie. Tom. IX, p. 40.