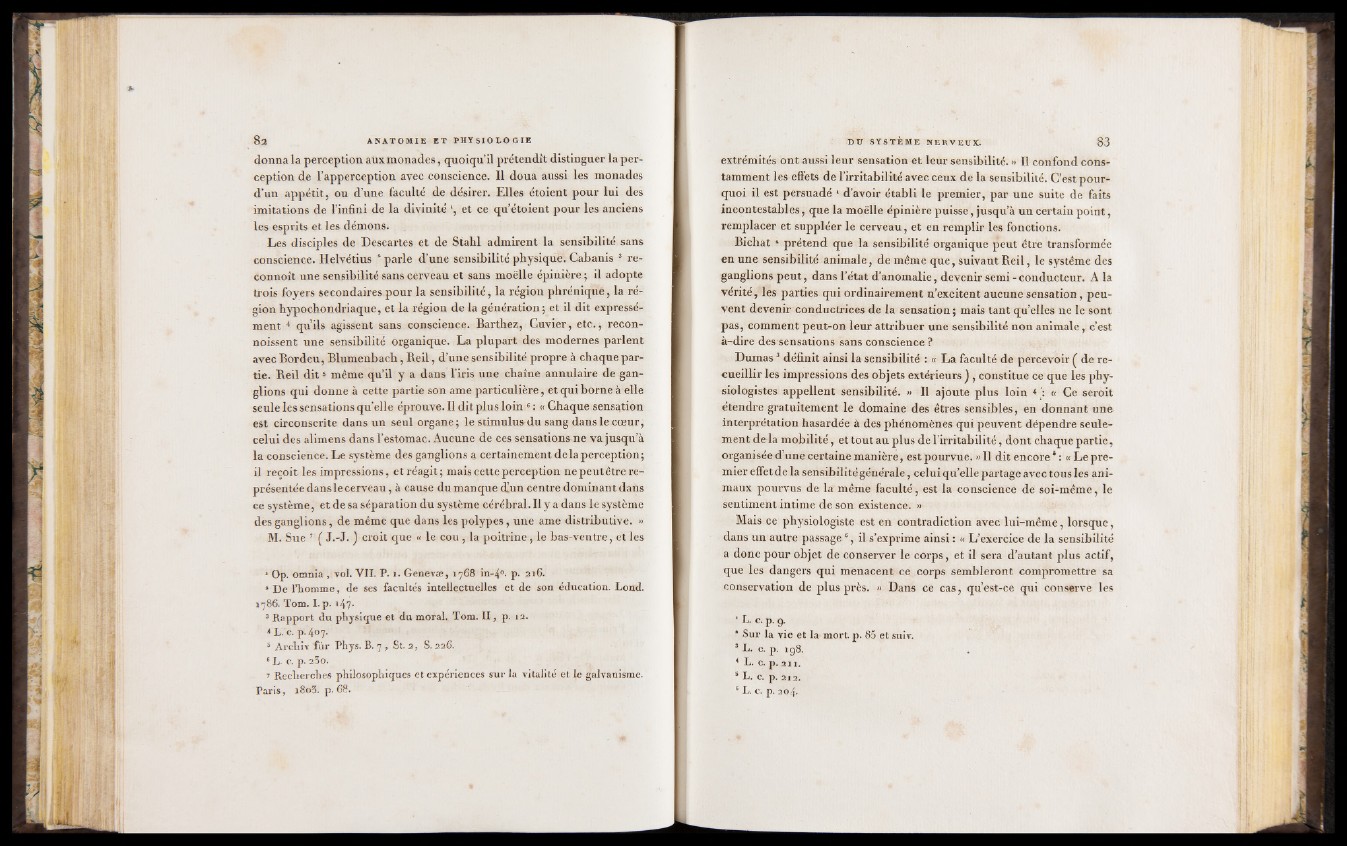
donna la perception aux monades, quoiqu’il prétendît distinguer la perception
de l’apperception avec conscience. Il doua aussi les monades
d’un appétit, ou d’une faculté de désirer. Elles étoient pour lui des
imitations de l’infini de la divinité ', et ce qu’étoient pour les anciens
les esprits et les démons.
Les disciples de Descartes et de Stahl admirent la sensibilité sans
conscience. Helvétius § parle d’une sensibilité physique. Cabanis 1 * 3 re-
connoît une sensibilité sans cerveau et sans moelle épinière ; il adopte
trois foyers secondaires pour la sensibilité, la région phrénique, la région
hypochondriaque, et la région de la génération; et il dit expressément
4 qu’ils agissent sans conscience. Barthez, Cuvier, etc., recon-
noissent une sensibilité organique. La plupart des modernes parlent
avec Bordeu, Blumenbach, Beil, d’une sensibilité propre à chaque partie.
Beil d it5 * même qu’il y a dans l’iris une chaîne annulaire de ganglions
qui donne à cette partie son ame particulière, et qui borne à elle
seule les sensations qu’elle éprouve. Il dit plus loin 5 : Éj Chaque sensation
est circonscrite dans un seul organe; le stimulus du sang dans le coeur,
celui des alimens dans l’estomac. Aucune de ces sensations ne va jusqu’à
la conscience. Le système des ganglions a certainement delà perception;
il reçoit les impressions, et réagit; mais cette perception ne peut être représentée
danslecerveau, à cause du manque tfun centre dominant dans
ce système, et de sa séparation du système cérébral. Il y a dans le système
des ganglions, de même que dans les polypes, une ame distributive. »
M. Sue 7 ( J.-J. ) croit que « le cou, la poitrine, le bas-ventre, et les
1 Op. omnia , vol. VII. P. i. Genevæ, 1768 in-4°. p. 216.
’ De l’homme, de ses facultés intellectuelles et de son éducation. Lond.
1786. Tom. I.p. 147-
3 Rapport du physique et du moral. Tom. I I , p. 12.
4 L.'c. p. 4 °7-
5 Archiv fur Phys. B. 7 , St. 2, S. 226.
*L . c. p. 23o. 7 Recherches philosophiques et expériences sur la vitalité et le galvanisme.
Paris., i8o3. p. 68.
extrémités ont aussi leur sensation et leur sensibilité. » Il confond constamment
les effets de l’irritabilité avec ceux de la sensibilité. C’est pourquoi
il est persuadé ‘ d’avoir établi le premier, par une suite de faits
incontestables, que la moelle épinière puisse, jusqu’à un certain point,
remplacer et suppléer le cerveau, et en remplir les fonctions.
Bichat • prétend que la sensibilité organique peut être transformée
en une sensibilité animale, de même que, suivant B eil, le système des
ganglions peut, dans l’état d’anomalie, devenir semi - conducteur. A la
vérité, les parties qui ordinairement n’excitent aucune sensation, peuvent
devenir conductrices de la sensation ; mais tant qu’elles ne le sont
pas, comment peut-on leur attribuer une sensibilité non animale , c’est
à-dire des sensations sans conscience ?
Dumas3 définit ainsi la sensibilité : « La faculté de percevoir f de recueillir
les impressions des objets extérieurs ) , constitue ce que les physiologistes
appellent sensibilité. » Il ajoute plus loin 4 ’! « Ce seroit
étendre gratuitement le domaine des êtres sensibles, en donnant une
interprétation hasardée à des phénomènes qui peuvent dépendre seulement
de la mobilité, et tout au plus de l’irritabilité, dont chaque partie,
organisée d’une certaine manière, est pourvue. » Il dit encore ‘ : « Le premier
effet de la sensibilitégénérale, celui qu’elle partage avec tous les animaux
pourvus de la même faculté, est la conscience de soi-même, le
sentiment intime de son existence. »
Mais ce physiologiste est en contradiction avec lui-même, lorsque,
dans un autre passage 5, il s’exprime ainsi : « L ’exercice de la sensibilité
a donc pour objet de conserver le corps, et il sera d’autant plus actif,
que les dangers qui menacent ce corps sembleront compromettre sa
conservation de plus près. » Dans cë cas, qu’est-ce qui conserve les
‘ L- c. p. g.
* Sur la vie et la mort. p. 85 et suiv.
3 L. c. p. 198.
4 L. c. p. ai i.
‘ L. c. p. 212.
‘ L. c. p. 304.