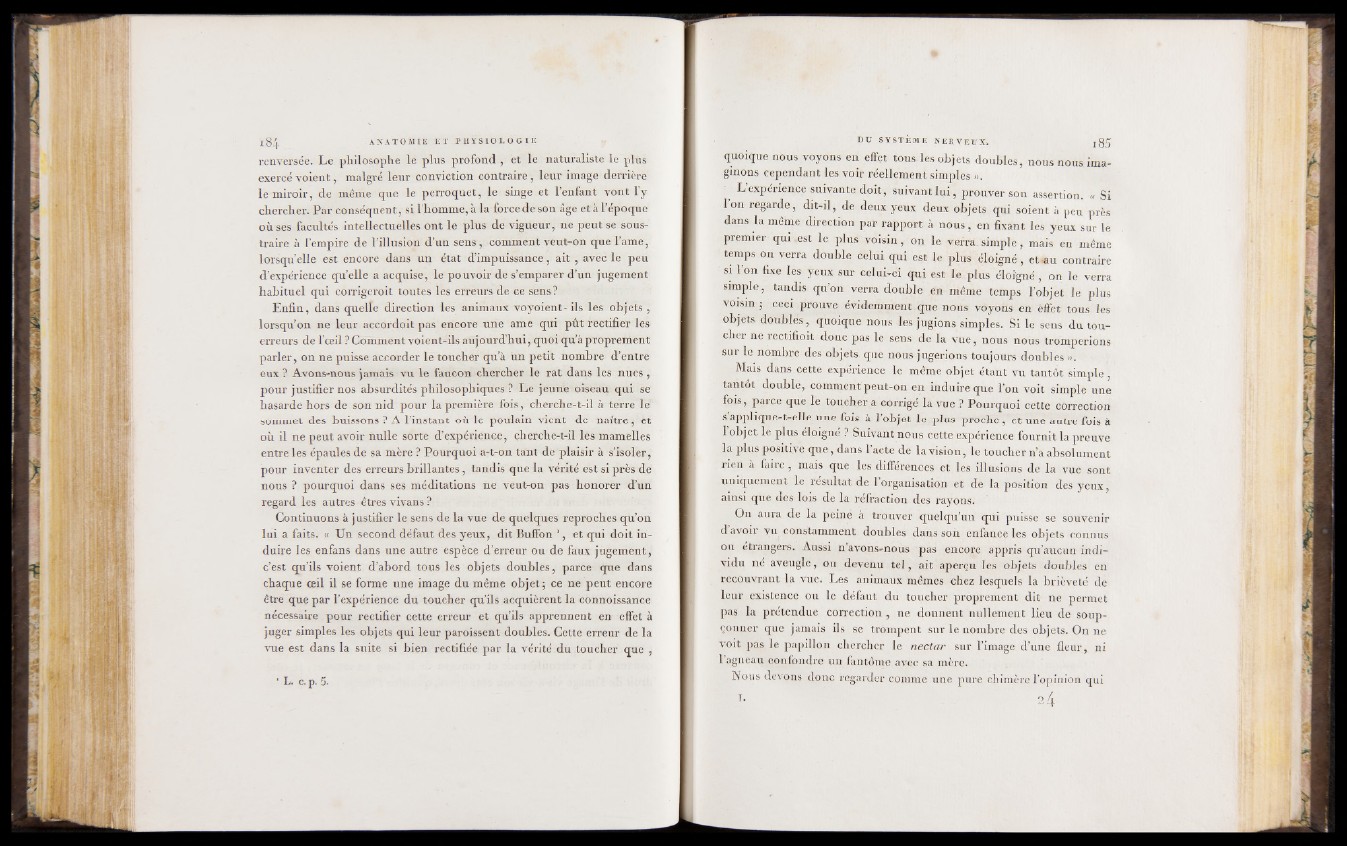
renversée. Le philosophe le plus profond , et le naturaliste le plus
exercé voient, malgré leur conviction contraire, leur image derrière
le miroir, de même que le perroquet, le singe et l’enfant vont l’y
chercher. Par conséquent, si l'homme, à la force de son âge et à l’époque
où ses facultés intellectuelles ont le plus de vigueur, ne peut se soustraire
à l’empire de l'illusion d’un sens, comment veut-on que l’ame,
lorsqu’elle est encore dans un état d’impuissance, ait , avec le peu
d’expérience qu’elle a acquise, le pouvoir de s’emparer d’un jugement
habituel qui corrigeroit toutes les erreurs de ce sens ?
Enfin, dans quelle direction les animaux voyoient-ils les objets ,
lorsqu’on ne leur accordoit pas encore une ame qui pût rectifier les
erreurs de l’oeil ? Comment voient-ils aujourd’hui, quoi qu’à proprement
parler, on ne puisse accorder le toucher qu’à un petit nombre d’entre
eux ? Avons-nous jamais vu le faucon chercher le rat dans les nues ,
pour justifier nos absurdités philosophiques ? Le jeune oiseau qui se
hasarde hors de son nid pour la première fois, cherche-t-il à terre le
sommet des buissons ? A l’instant où le poulain vient de naître, et
où il ne peut avoir nulle sorte d’expérience, çherche-t-il les mamelles
entre les épaules de sa mère ? Pourquoi a-t-on tant de plaisir à s’isoler,
pour inventer des erreurs brillantes, tandis que la vérité est si près de
nous ? pourquoi dans ses méditations ne veut-on pas honorer d’un
regard les autres êtres vivans ?
Continuons à justifier le sens de la vue de quelques reproches qu’on
lui a faits. « Un second défaut des yeux, dit Buffon ', et qui doit induire
les enfans dans une autre espèce d’erreur ou de faux jugement,
c’est qu’ils voient d’abord tous les objets doubles, parce que dans
chaque ceil il se forme une image du même objet; ce ne peut encore
être que par l’expérience du toucher qu’ils acquièrent la connoissance
nécessaire pour rectifier cette erreur et qu’ils apprennent en effet à
juger simples les objets qui leur paroissent doubles. Cette erreur de la
vue est dans la suite si bien rectifiée par la vérité du toucher que ,
L. c. p. 5.
quoique nous voyons en effet tous.les objets doubles, nous nous imaginons
cependant les voir réellement simples ».
; L expérience suivante doit, suivant lui, prouver son assertion. « Si
l’on regarde, dit-il, de deux yeux deux objets qui soient à peu près
dans la même direction par rapport à nous , en fixant les yeux sur le
premier qui .est le plus voisin, on le verra, simple, mais en même
temps on verra double celui qui est le plus éloigné , et.au contraire
si l’on fixe les yeux sur celui-ci qui est le plus éloigné , on le verra
simple, tandis quon verra double en même temps l’objet le plus
voisin ; ceci prouve évidemment que nous voyons en effet tous les
objets doublés, quoique nous des jugions simples. Si le sens du toucher
ne rectifioit donc pas le sens de la vue, nous nous tromperions
sur le nombre d:es objets que nous jugerions toujours doubles ».
Mais dans cette expérience le même objet étant vu tantôt simple,
tantôt double, comment peut-on en induire que l’on voit simple une
fois, parce que le toucher a corrigé la vue ? Pourquoi cette correction
s applique-t-elle une fois à l’objet le plus proche , et une autre fois à
1 objet le plus éloigne ? Suivant nous cette expérience fournit la preuve
,1a plus positive que, dans 1 acte de la vision, le toucher n’a absolument
rien à faire , mais que les différences et les illusions de la vue sont
uniquement le résultat de l ’organisation et de la position des yeux,
ainsi que des lois de la réfraction des rayons.
On aura de la peine à trouver quelqu’un qui puisse se souvenir
d avoir vu constamment doubles dans son enfance les objets connus
ou etrangers. Aussi n avons-nous pas encore appris qu’aucun individu
ne aveugle, ou devenu te l, ait aperçu les objets doubles en
recouvrant la vue. Les animaux mêmes chez lesquels la brièveté de
leur existence ou le défaut du toucher proprement dit ne permet
pas la prétendue correction, ne donnent nullement lieu de soupçonner
que jamais ils se trompent sur le nombre des objets. On ne
voit pas le papillon chercher le nectar sur l’image d’une fleur, ni
1 agneau confondre un fantôme avec sa mère.
Nous devons donc regarder comme une pure chimère l’opinion qui