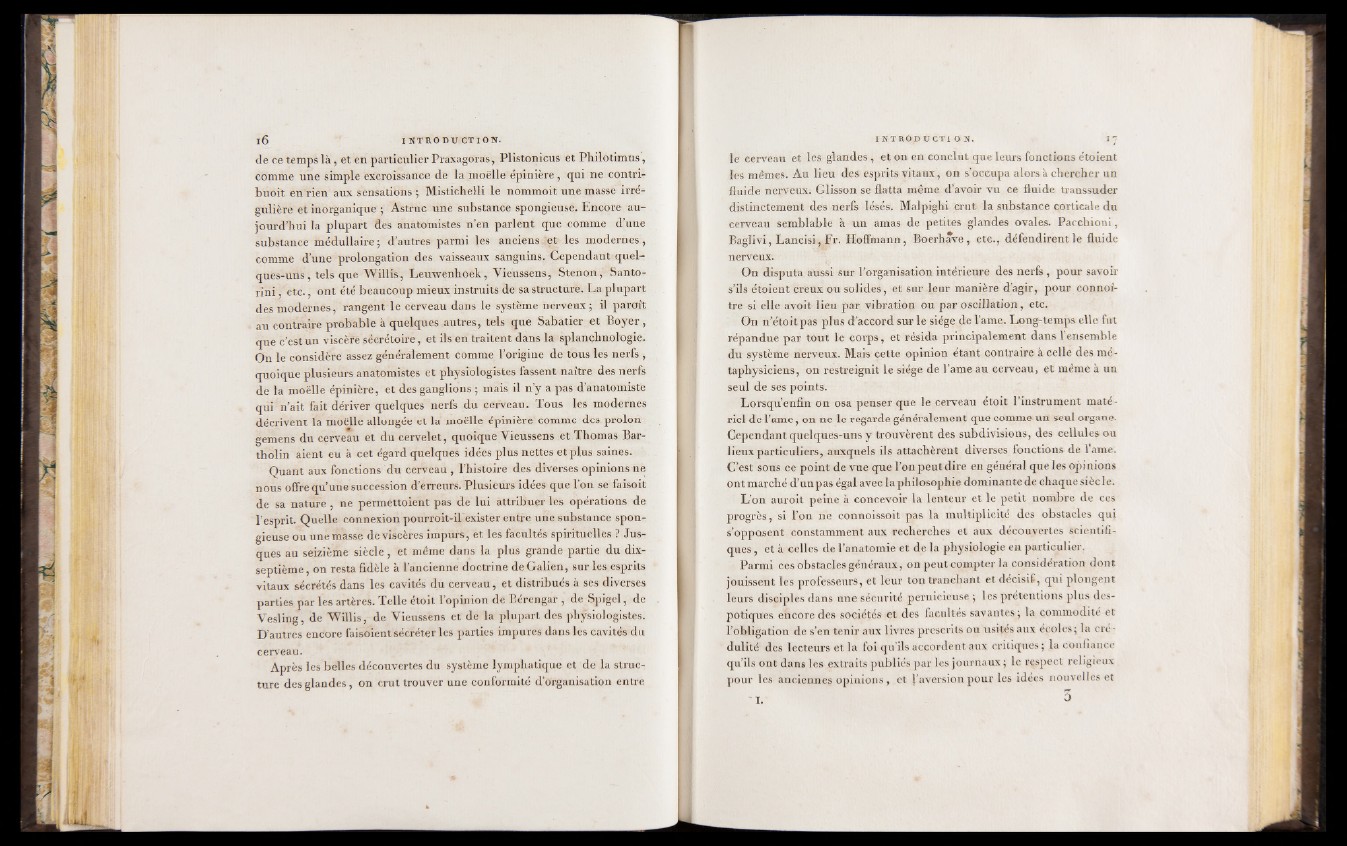
de ce temps là , et en particulier Praxagoras, Plistonicus et Philotimus,
comme une simple excroissance de la moelle épinière, qui ne contri-
buoit en rien aux sensations | Mistichelli le nommoit une masse irrégulière
et inorganique ; Astruc une substance spongieuse. Encore aujourd’hui
la plupart des anatomistes n’en parlent que comme d'une
substance médullaire ; d’autres parmi les anciens .’et les modernes,
comme d’une prolongation des vaisseaux sanguins. Cependant quelques
uns, tels que Willis, Leuwenhoek, Yieussens, Stenon, Santo-
rini, etc., ont été beaucoup mieux instruits de sa structure. La plupart
des modernes, rangent le cerveau dans le système nerveux ; il paraît
au contraire probable à quelques autres, tels que Sabatier et Boyer,
que c’est un viscère sécrétoire, et ils en traitent dans la splançhnologie.
On le considère assez généralement comme l’origine de tous les nerfs ,
quoique plusieurs anatomistes et physiologistes fassent naître des nerfs
de la moëlle épinière, et des ganglions ; mais il n’y a pas d’anatomiste
qui n’ait fait dériver quelques nerfs du cerveau. Tous les modernes
décrivent la moëlle allongée et la moëlle épinière comme des prolon-
gemens du cerveau et du cervelet, quoique Yieussens et Thomas Bar-
tholin aient eu à cet égard quelques idées plus nettes et plus saines.
Quant aux fonctions du cerveau , l’histoire des diverses opinions ne
nous offre qu’une succession d’erreurs. Plusieurs idées que l’on se faisoit
de sa nature , ne permettoient pas de lui attribuer les opérations de
l’esprit. Quelle connexion pourroit-il'exister entre une substance spongieuse
ou unemasse de viscères impurs, et les facultés spirituelles ? Jus-
ques au seizième siècle, et même dans la plus grande partie du dix-
septième , on resta fidèle à l’ancienne doctrine de Galien, sur les esprits
vitaux sécrétés dans les cavités du cerveau, et distribués à ses diverses
parties par les artères. Telle étoit 1 opinion de Bérengar , de Spigel, de
Vesling, de Willis, de Vieussens et de la plupart des physiologistes.
D’autres encore faisoient sécréter les parties impures dans les cavités du
cerveau.
Après les belles découvertes du système lymphatique et de la structure
des glandes, on crut trouver une conformité d’organisation entre
le cerveau et les glandes , et on en conclut que leurs fonctions étaient
les mêmes. Au lieu des esprits vitaux, on s’occupa alors à chercher un
fluide nerveux; Glisson se flatta même d’avoir vu ce fluide transsuder
distinctement des nerfs lésés. Malpighi crut la substance corticale du
cerveau semblable à un amas de petites glandes ovales. Pacchioni,
Baglivi, Lancisi, Fr. Hoffmann, Boerhave, etc., défendirent le fluide
nerveux.
On disputa aussi sur l’organisation intérieure des nerfs , pour savoir
s’ils étaient creux ou solides, et sur leur manière d’agir, pour connoî-
tre si elle avoit lieu par vibration ou par oscillation, etc.
On n’était pas plus d’accord sur le siège de l’ame. Long-temps elle fut
répandue par tout le corps, et résida principalement dans l’ensemble
du système nerveux. Mais cette opinion étant contraire à celle des métaphysiciens,
on restreignit le siège de l’ame au cerveau, et même à un
seul de ses points.
Lorsqu’enfin on 06a penser que le cerveau était l ’instrument matériel
de l’ame, on ne le regarde généralement que comme un seul organe.
Cependant quelques-uns y trouvèrent des subdivisions, des cellules ou
lieux particuliers, auxquels ils attachèrent diverses fonctions de l’ame.
C’est sous ce point de vue que l’on peut dire en général que les opinions
ont marché d’un pas égal avec la philosophie dominante de chaque siée le.
L’on auroit peine à concevoir la lenteur et le petit nombre de ces
progrès, si l’on ne connoissoit pas la multiplicité des obstacles qui
s’opposent constamment aux recherches et aux découvertes scientifiques
, et à celles de l’anatomie et de la physiologie en particulier.
Parmi ces obstacles généraux, on peut compter la considération dont,
jouissent les professeurs, et leur ton tranchant et décisif, qui plongent
leurs disciples dans une sécurité pernicieuse ; les prétentions plus despotiques
encore des sociétés et des facultés savantes ; la commodité et
l’obligation de s’en tenir aux livres prescrits ou usités aux écoles ; la cré dulité
des lecteurs et la foi qu ils accordent aux critiques; la confiance
qu’ils ont dans les extraits publiés par les journaux ; le respect religieux
pour les anciennes opinions , et j’aversion pour les idées nouvelles et
I. 3