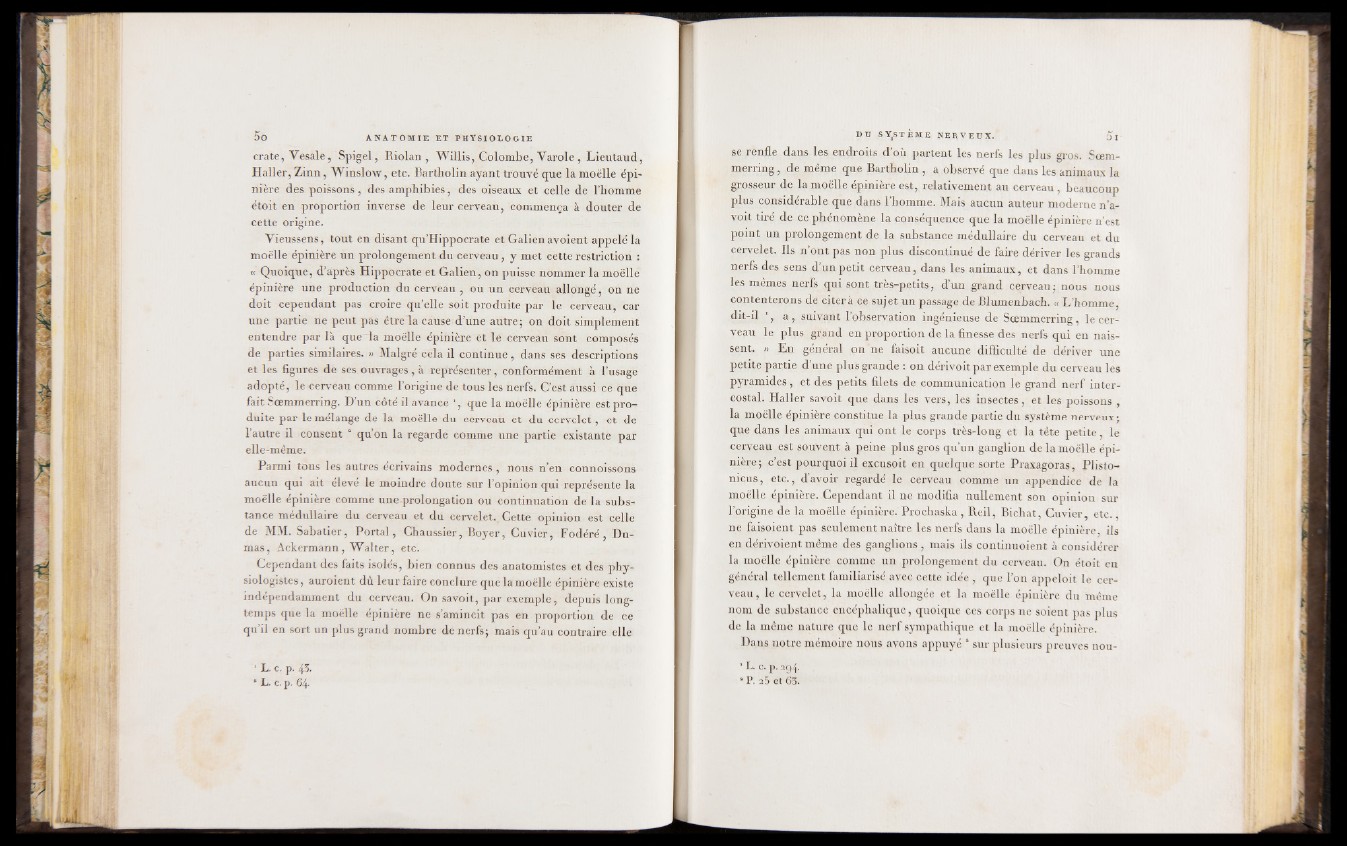
crate, Yesale, Spigel, Riolan , Willis, Colombe, Yarole , Lieutaud,
Haller, Zinn, Winslow, etc. Bartholin ayant trouvé que la moelle épinière
des poissons, des amphibies, des oiseaux et celle de l’homme
étoit en proportion inverse de leur cerveau, commença à douter de
cette origine.
Vieussens, tout en disant qu’Hippocrate et Galien avoient appelé la
moelle épinière un prolongement du cerveau, y met cette restriction :
« Quoique, d’après Hippocrate et Galien, on puisse nommer la moelle
épinière une production du cerveau , ou un cerveau allongé, on ne
doit cependant pas croire qu’elle soit produite par le cerveau, car
une partie ne peut pas être la cause d’une autre; on doit simplement
entendre par là que la moelle épinière et le cerveau sont composés
de parties similaires. » Malgré cela il continue, dans ses descriptions
et les figures de ses ouvrages, à représenter, conformément à l’usage
adopté, le Cerveau comme l’origine de tous les nerfs. C’est aussi ce que
fait Scemmerring. D’un côté il avance ’ , que la moelle épinière est produite
par le mélange de la moelle du cerveau et du cervelet, et de
l’autre il consent ? qu’on la regarde comme une partie existante par
elle-même.
Parmi tous les autres écrivains modernes , nous n’en connoissons
aucun qui ait élevé le moindre doute sur l’opinion qui représente la
moelle épinière comme une-prolongation ou continuation de la substance
médullaire du cerveau et du cervelet.. Cette opinion est celle
de MM. Sabatier, Portai, Chaussier, Boyer, Cuvier, Fodéré , Dumas,
Ackermann, Walter, etc.
Cependant des faits isolés, bien connus des anatomistes et des physiologistes,
auroient dû leur faire conclure que la moelle épinière existe
indépendamment du cerveau. On savoit, par exemple, depuis longtemps
que la moëlle épinière ne s’amincit pas en proportion de ce
qu’il en sort un plus grand nombre de nerfs; mais qu’au contraire elle
’ L. c. p. 43.
* L. c. p. 64
se renfle dans les endroits d’où partent les nerfs les plus gros. Scem-
merring, de même que Bartholin , a observé que dans les animaux la
grosseur de la moëlle épinière est, relativement au cerveau, beaucoup
plus considérable que dans l’homme. Mais aucun auteur moderne n’a-
voit tiré de ce phénomène la conséquence que la moëlle épinière n’est
point un prolongement de la substance médullaire du cerveau et du
cervelet. Ils n’ont pas non plus discontinué de faire dériver les grands
nerfs des sens d’un petit cerveau, dans les animaux, et dans l’homme
les mêmes nerfs qui sont très-petits, d’un grand cerveau; nous nous
contenterons de citera ce sujet un passage de Blumenbach. « L ’homme,
dit-il 1, a , suivant 1 observation ingénieuse de Scemmerring, le cerveau
le plus grand en proportion de la finesse des nerfs qui en naissent.
» En général on ne faisoit aucune difficulté de dériver une
petite partie d’une plus grande : on dérivoit par exemple du cerveau les
pyramides, et des petits filets de communication le grand nerf intercostal.
Haller savoit que dans les vers, les insectes, et les poissons ,
la moëlle épinière constitue la plus grande partie du système nerveux;
que dans les animaux qui ont le corps très-long et la tête petite le
cerveau est souvent à peine plus gros qu’un ganglion de la moëlle épinière;
c’est pourquoi il excusoit en quelque sorte Praxagoras, Plisto-
nicus, etc., d’avoir regardé le cerveau comme un appendice de la
moëlle épinière. Cependant il ne modifia nullement son opinion sur
l’origine de la moëlle épinière. Prochaska, Reil, Bichat, Cuvier, etc.
ne faisoient pas seulement naître les nerfs dans la moëlle épinière, ils
en dérivoient même des ganglions, mais ils continuoient à considérer
la moëlle épinière comme un prolongement du cerveau. On étoit en
général tellement familiarisé avec cette idée , que l’on appeloit le cerveau,
le cervelet, la moëlle allongée et la moëlle épinière du même
nom de substance encéphalique, quoique ces corps ne soient pas plus
de la même nature que le nerf sympathique et la moëlle épinière.
Dans notre mémoire nous avons appuyé ‘ sur plusieurs preuves uou-
‘ L c. p. 294.
* P. a5 et 63.