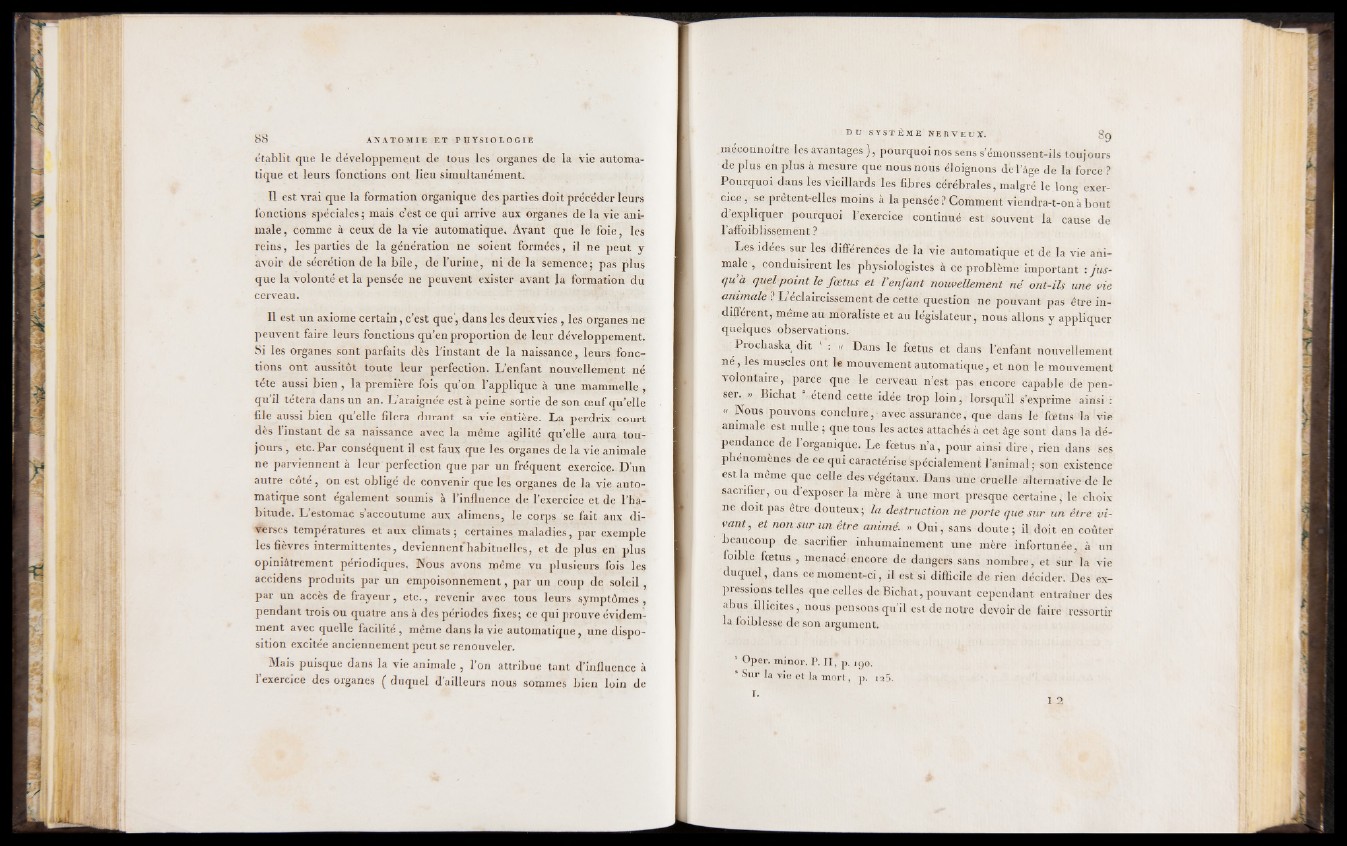
établit que le développement de tous les organes de la vie automatique
et leurs fonctions ont lieu simultanément.
Il est vrai que la formation organique des parties doit précéder leurs
fonctions spéciales ; mais c’est ce qui arrive aux organes de la vie animale
, comme à ceux de la vie automatique. Avant que le foie, les
reins, les parties de la génération ne soient formées, il ne peut y
avoir de sécrétion de la bile, de l’urine, ni de la semence; pas plus
que la volonté et la pensée ne peuvent exister avant la formation du
cerveau.
Il est un axiome certain, c’est que, dans les deux vies , les organes ne
peuvent faire leurs fonctions qu’en proportion de leur développement.
Si les organes sont parfaits dès l’instant de la naissance, leurs fonctions
ont aussitôt toute leur perfection. L ’enfant nouvellement né
tête aussi bien , la première fois qu’on l’applique à une mammelle ,
qu’il tétera dans un an. L’araignée est à peine sortie de son oeuf qu’elle
file aussi bien qu’elle filera durant sa vie entière. La perdrix court
dès l’instant de sa naissance avec la même agilité qu’elle aura toujours
, etc. Par conséquent il est faux que les organes de la vie animale
ne parviennent à leur perfection que par un fréquent exercice. D’un
autre côté, on est obligé de convenir que les organes de la vie automatique
sont également soumis à l’influence de l’exercice et de l’habitude.
L estomac s accoutume aux alimens, le corps se fait aux di-
vërses températures et aux climats ; certaines maladies, par exemple
les fièvres intermittentes, deviennent habituelles, et de plus en plus
opiniâtrement périodiques. Nous avons même vu plusieurs fois les
accidens produits par un empoisonnement, par un coup de soleil ,
par un accès de frayeur, etc., revenir avec tous leurs symptômes ,
pendant trois ou quatre ans à des périodes fixes; ce qui prouve évidemment
avec quelle facilité, même dans la vie automatique, une disposition
excitée anciennement peut se renouveler.
Mais puisque dans la vie animale , l’on attribue tant (J’influence à
1 exercice des organes ( duquel d’ailleurs nous sommes bien loin de
*iL
meconnoitre les avantages), pourquoi nos sens s’émoussent-ils toujours
de plus en plus à mesure que nous nous éloignons de l’âge de la force ?
Pourquoi dans les vieillards les fibres cérébrales, malgré le long exercice
, se pretent-elles moins à la pensée ? Comment viendra-t-on à bout
d expliquer pourquoi l’exercice continué est souvent la cause de
l ’affoiblissement ?
Les idées sur les différences de la vie automatique et de la vie animale
, conduisirent les physiologistes à ce problème important : jusqu
à quel point le foetus et l ’enfant nouvellement né ont-ils une vie
animale ? L éclaircissement de cette question ne pouvant pas être indifférent,
même au moraliste et au législateur, nous allons y appliquer
quelques observations.
Procbaska dit ‘ : « Dans le foetus et dans l’enfant nouvellement
né > les muscles ont le mouvement automatique, et non le mouvement
volontaire, parce que le cerveau n’est pas encore capable de penser.
» Bichat ’ étend cette idée trop loin, lorsqu’il s’exprime ainsi :
« Nous pouvons Conclure, avec assurance, que dans le foetus la vie
animale est nulle ; que tous les actes attachés à cet âge sont dans la dépendance
de 1 organique. Le foetus n’a , pour ainsi dire, rien dans ses
phénomènes de ce qui caractérise spécialement l’animal; son existence
est la même que celle des végétaux. Dans une cruelle alternative de le
sacrifier, ou d exposer la mère à une mort presque certaine, le choix
ne doit pas être douteux; la destruction ne porte que sur un être vivant,
et non sur un être animé. » Oui, sans doute; il doit en coûter
beaucoup de sacrifier inhumainement une mère infortunée, à un
foible foetus , menacé encore de daûgers sans nombre, et sur la vie
duquel, dans ce moment-ci, il est si difficile de rien décider. Des expressions
telles que celles de Bichat, pouvant cependant entraîner des
abus illicites, nous pensons qu’il est de notre devoir de faire ressortir
la foiblesse de son argument.
’ Oper, minor. P. II* p. igo.
* Sur la vie et la mort, p. ia5.
T. 1 2