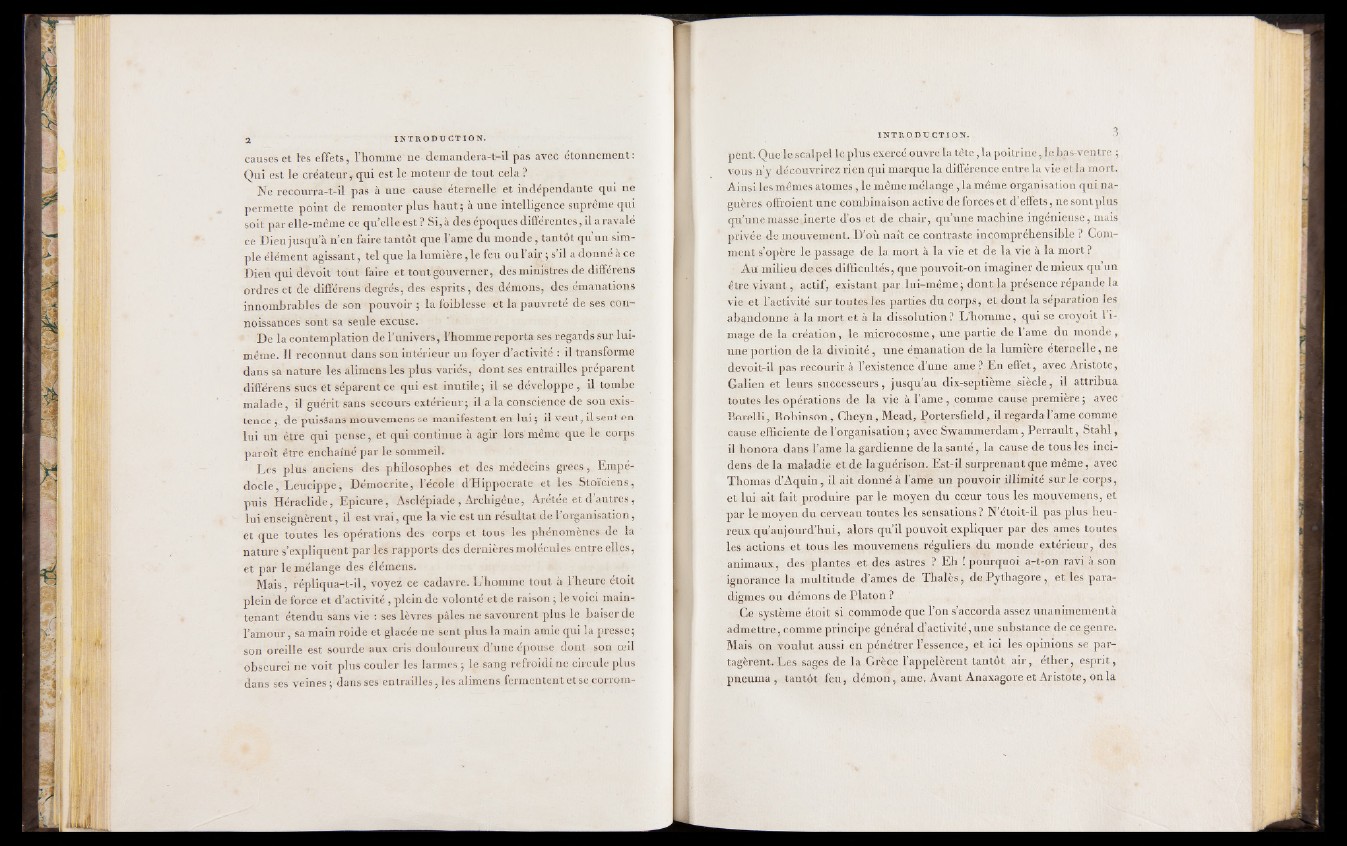
A
causes et tes effets, l’homme ne demandera-t-il pas avec étonnement :
Qui est le créateur r qui est le moteur de tout cela ?
Ne recourra-t-il pas à une cause éternelle et indépendante qui ne
permette point de remonter plus haut ; à une intelligence suprême qui
soit par elle-même ce quelle est ? Si,à des époques différentes, il a ravalé
ce Dieu jusqu’à n’en faire tantôt que l ame du monde, tantôt qu’un simple
élément agissant, tel que la lumière, le feu ou 1 air ; s il a donne à ce
Dieu qui dévoit tout faire et tout gouverner, des ministres de différons
ordres et de différens degrés, des esprits, des démons, des émanations
innombrables de son pouvoir ; la foiblesse et la pauvreté de ses con-
noissances sont sa seule excuse.
De la contemplation de l ’univers, l’homme reporta ses regards sur lui-
même. Il reconnut dans son intérieur un foyer d’activité : il transforme
dans sa nature les alimens les plus variés, dont ses entrailles préparent
différens sucs ét séparent ce qui est inutile; il se développe , il tombe
malade, il guérit sans secours extérieur; il a la conscience de son existence
; de puisSans mouvemens se manifestent en lui ; il veut, il sent en
lui un être qui pense, et qui continue à agir lors même que le corps
paroît être enchaîné par le sommeil.
Les plus anciens des philosophes et des médecins grecs, Empé-
docle, Leucippe, Démocrite, l’école d’Hippocrate et les Stoïciens,
puis Héraclide, Epicure, Asclépiade , Archigêne, Arétée et d’autres,
lui enseignèrent, il est vrai, que la vie est un résultat de l’organisation,
et que toutes les opérations des corps et tous les phénomènes de la
nature s’expliquent par les rapports des dernières molécules entre elles,
et par le mélange des élémens.
Mais, répliqua-t-il, voyez ce cadavre. L’homme tout à l’heure étoit
plein de force et d’activité , plein de volonté et de raison ; le voici maintenant
étendu sans vie : ses lèvres pâles ne savourent plus le baiser de
l’amour, sa main roide et glacée ne sent plus la main amie qui la presse;
son oreille est sourde aux cris douloureux d’une épouse dont son oeil
obscurci ne voit plus couler les larmes ; le sang refroidi ne circule plus
dans ses veines ; dans ses entrailles, les alimens fermentent et se corrompênt.
Que le scalpel le plus exercé ouvre la tête ,1a poitrine, le bas-ventre ;
vous n’y découvrirez rien qui marque la différence entre la vie et la mort.
Ainsi les mêmes atomes, le même mélange, la même organisation qui na-
guères offroient une combinaison active de forces et d’effets, ne sontplus
qu’une masse inerte d’os et de chair, qu’une machine ingénieuse, mais
privée de mouvement. D’où naît ce contraste incompréhensible ? Comment
s’opère le passage de la mort à la vie et de la vie à la mort ?
Au milieu de ces difficultés, que pouvoit-on imaginer de mieux qu’un
être vivant, actif, existant par lui-même ; dont la présence répande la
vie et l’activité sur toutes les parties du corps, et dont la séparation les
abandonne à la mort et à la dissolution? L ’homme, qui se croyoit 1 i-
mage de la création, le microcosme, une partie de l’ame du monde ,
une portion de la divinité, une émanation de la lumière éternelle, ne
devoit-il pas recourir à l’existence d’une ame ?;En effet, avec Aristote,
Galien et leurs successeurs, jusqu’au dix-septième siècle, il attribua
toutes les opérations de la vie à lame , comme cause première ; avec
Borelli, Robinson, Cheyn, Mead, Portersfield, il regarda lame comme
cause efficiente de l’organisation ; avec Swammerdam, Perrault, Stahl,
il honora dans l’ame la gardienne de la santé, la cause de tous les inci-
dens de la maladie et de la-guérison. Est-il surprenant que même, avec
Thomas d’Aquin, il ait donné à lame un pouvoir illimité sur le corps,
et lui ait fait produire par le moyen du coeur tous les mouvemens, et
par le moyen du cerveau toutes les sensations ? N’étoit-il pas plus heureux
qu’aujourd’hui, alors qu’il pouvoit expliquer par des âmes toutes
les actions et tous les mouvemens réguliers du monde extérieur, des
animaux, des plantes et des astres ? Eh ! pourquoi a-t-on ravi à son
ignorance la multitude d’ames de Thalès, de Pythagore, et les paradigmes
ou démons de Platon ?
Ce système étoit si commode que l’on s’accorda assez unanimement à
admettre, comme principe général d’activité, une substance de ce genre.
Mais on voulut aussi en pénétrer l’essence, et ici les opinions se partagèrent.
Les sages de la Grèce l’appelèrent tantôt air, éther, esprit,
pneuma , tantôt feu, démon, ame. Avant Anaxagore et Aristote, onia