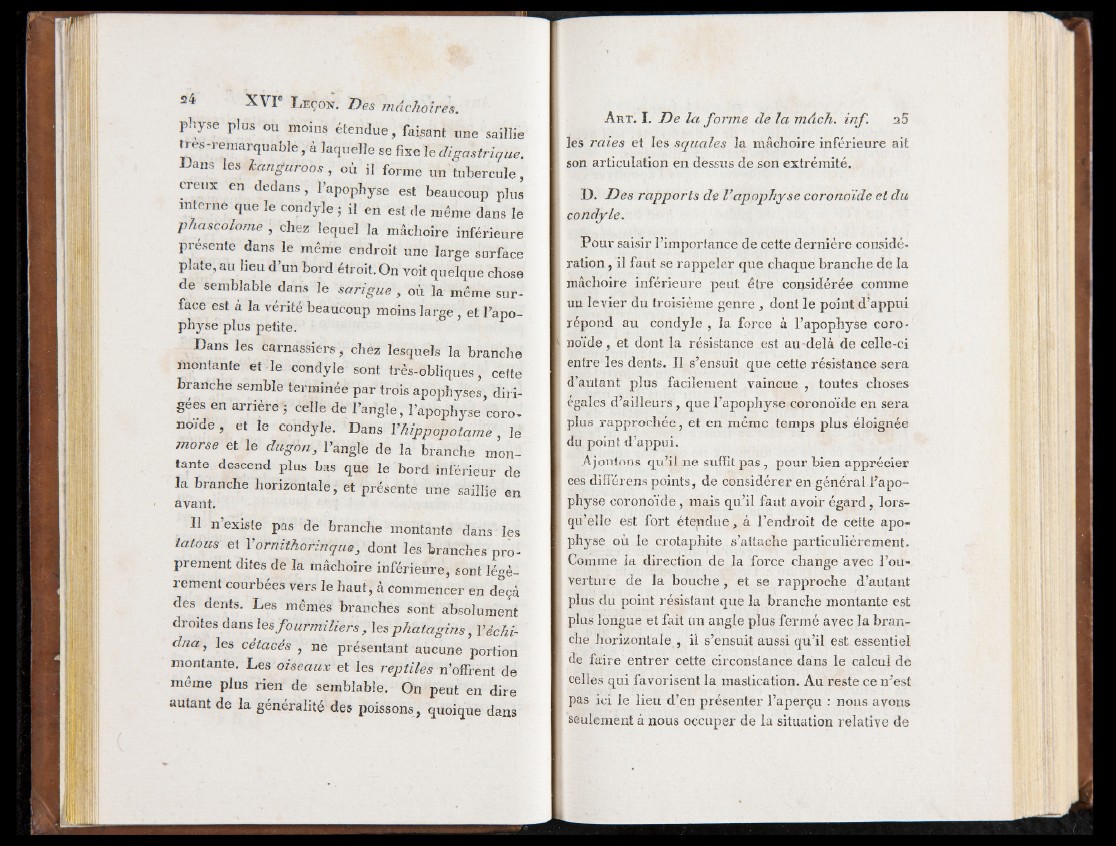
X V Ie L eçon. Des mâchoires.
physe plus ou moins étendue, faisant une saillie
très-remarquable, à laquelle se fixe le digastrique.
Dans les kanguroos, où il forme un tubercule,
creux en dedans, l’apophyse est beaucoup plus
interné que le condyle ; il en est de même dans le
phascolome , chez lequel la mâchoire inférieure
présente dans le même endroit une large surface
plate, au lieu d’un bord étroit. On voit quelque chose
de semblable dans le sarigue , où la même surface
est à la vérité beaucoup moins large, et l’apophyse
plus petite.
Dans les carnassiers, chez lesquels la branche
montante et-le condyle sont très-obliques, cette
branche semble terminée par trois apophyses, dirigées
en arrière 5 celle de l ’angle, l ’apophyse coro-
noide, et le condyle. Dans Y hippopotame , le
morse et le dugon, l ’angle de la branche montante
descend plus bas que le bord inférieur de
la branche horizontale, et présente une saillie en
avant.
Il n’existe pas de branche montante dans les
tatous et Vornithorinque, àonï les branches proprement
dites de la mâchoire inférieure, sont légèrement
courbées vers le haut, à commencer en deçà
des dents. Les mêmes branches sont absolument
droites dans les fourmiliers, les phatagins, Yéchi-
dna, les cétacés , ne présentant aucune portion
montante. Les oiseaux et les reptiles n’offrent de
meme plus rien de semblable. On peut en dire
autant de la généralité des poissons, quoique dans
Art. I. De la forme de la mdch. inf. o5
les raies et les squales la mâchoire inférieure ait
son articulation en dessus de son extrémité.
D. Des rapports de Vapophyse coronoïde et du
condyle.
Pour saisir l’importance de cette dernière considération
, il faut se rappeler que chaque branche de la
mâchoire inférieure peut être considérée comme
un levier du troisième genre , dont le point d’appui
répond au condyle , la force à l’apophyse coronoïde
, et dont la résistance est au-delà de celle-ci
entre les dents. Il s’ensuit que cette résistance sera
d’autant plus facilement vaincue , toutes choses
égales d’ailleurs, que l’apophyse coronoïde en sera
plus rapprochée, et en même temps plus éloignée
du point d’appui.
Ajoutons qu’il ne suffit pas, pour bien apprécier
ces différens points, de considérer en général l’apophyse
coronoïde, mais qu’il faut avoir égard, lorsqu’elle
est fort étepdue, à l ’endroit de cette apophyse
où le crotaphite s’attache particulièrement.
Comme la direction de la force change avec l’ouverture
de la bouche, et se rapproche d’autant
plus du point résistant que la branche montante est
plus longue et fait Un angle plus fermé avec la branche
horizontale , il s’ensuit aussi qu’il est essentiel
de faire entrer cette circonstance dans le calcul de
celles qui favorisent la mastication. Au reste ce n’est
pas ici le lieu d’en présenter l’aperçu : nous avons
seulement à nous occuper de la situation relative de