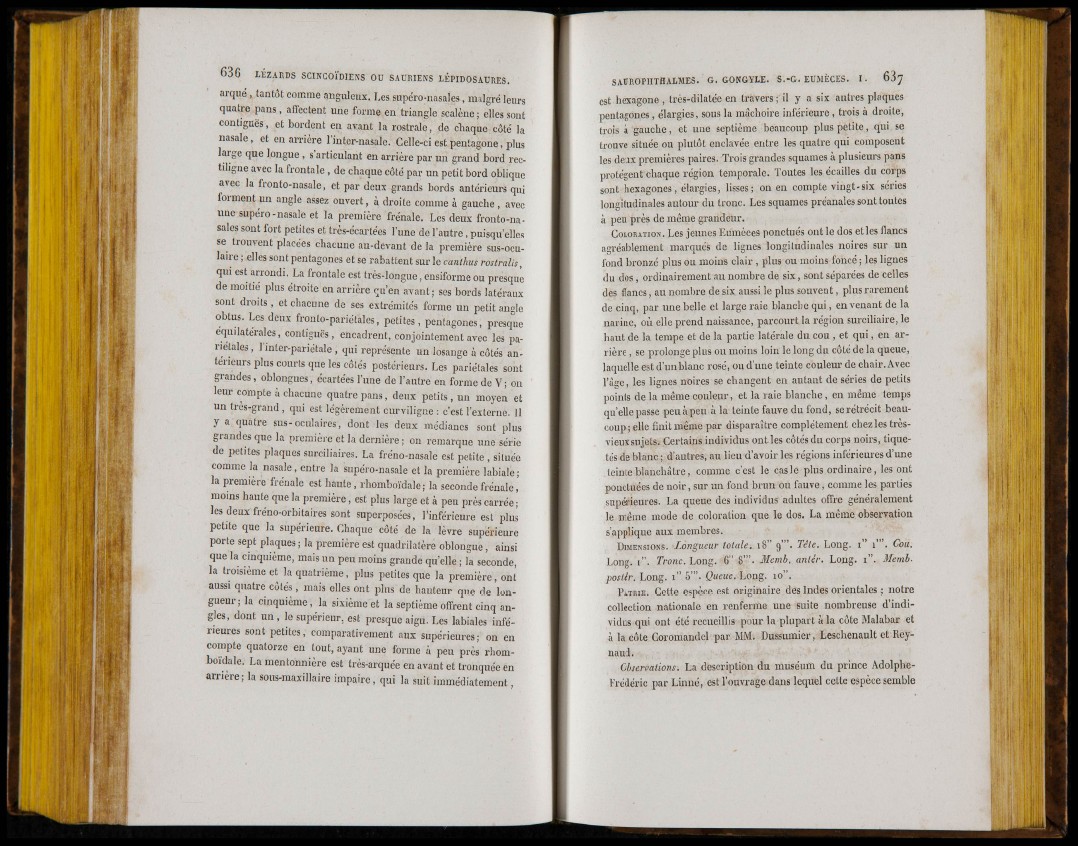
6 3 G LÉZARDS SCINCOÏDIENS OD SAUKIENS LÊPIDOSAURES.
arqué , tantôt comme anguleux. Les supéro-nasales, malgré leurs
quatre pans , affectent une forme en triangle scalène; elles sont
contiguës, et bordent en avant la rostrale, de cliaque côté la
nasale , et en arrière l'inter-nasale. Celle-ci est pentagone, plus
large que longue , s'articulant en arriére par un grand bord rectiligne
avec la frontale , de chaque côté par un petit bord oblique
avec la fronto-nasale, et par deux grands bords antérieurs qui
forment un angle assez ouvert, à droite comme à gauche , avec
une supero-nasale et la première frênaie. Les deux fronto-nasales
sont fort petites et très-écartées l'une de l'autre , puisqu'elles
se trouvent placées chacune au-devant de la première sus-oculaire
; elles sont pentagones et se rabattent sur le canihus rostralis,
qui est arrondi. La frontale est très-longue , ensiforme ou presque
de moitié plus étroite en arrière qu'en avant ; ses bords latéraux
sont droits , et chacune de ses extrémités forme un petit angle
obtus. Les deux fronto-pariétales, petites , pentagones, presque
equilatérales, contiguës, encadrent, conjointement avec les pariétales
, l'inter-pariétale , qui représente un losange à côtés anteneurs
plus courts que les côlés postérieurs. Les pariétales sont
grandes , oblongues, écartées l'une de l'autre en forme de V; on
leur compte à chacune quatre pans, deux petits, un moyen et
u n très-grand , qui est légèrement curviligne : c'est l'externe. 11
y a quatre sus-oculaires, dont les deux médianes sont plus
grandes que la première et la dernière ; on remarque une série
de petites plaques surciliaires. La fréno-nasale est petite , située
comme la nasale, entre la supero-nasale et la première labiale ;
la première frenale est haute , rhomboïdale; la seconde frênaie,
moins haute que la première , est plus large et à peu près carrée ;
les deux fréno-orbitaires sont superposées, l'inférieure est plus
petite que la supérieure. Chaque côté de la lèvre supérieure
porte sept plaques ; la première est quadrilatère oblongue, ainsi
que la cinquième, mais u n peu moins grande qu'elle ; la seconde,
la troisième et la quatrième, plus petites que la première, ont
aussi quatre côtés , mais elles ont plus de hauteur que de longueur;
la cinquième, la sixième et la septième offrent cinq angles,
dont un , le supérieur, est presque aigu. Les labiales inférieures
sont petites, comparativement aux supérieures; on en
compte quatorze en tout, ayant une forme à peu près rhomboïdale.
La mentonnière est très-arquée en avant et tronquée en
a r r i è r e ; la sous-maxillaire impaire , qui la suit immédiatement,
SAUROPIITHALMES. G. GONGYLE. S.-G. ETJMÈCES. I. 687
est hexagone , très-dilatée en travers ; il y a six autres plaques
pentagones , élargies, sous la mâchoire inférieure , trois à droite,
trois à gauche, et une septième beaucoup plus petite, qui se
trouve située ou plutôt enclavée entre les quatre qui composent
les deux premières paires. Trois grandes squames à plusieurs pans
protègent chaque région temporale. Toutes les écailles du corps
sont hexagones, élargies, lisses; on en compte vingt-six séries
longitudinales autour du tronc. Les squames préanales sont toutes
à peu près de même grandeur.
COLORATION. Les jeunes Eumèces ponctués ont le dos et les flancs
agréablement marqués de lignes longitudinales noires sur un
fond bronzé plus ou moins clair , plus ou moins foncé ; les lignes
du dos , ordinairement au nombre de six, sont séparées de celles
des flancs, au nombr e de six aussi le plus souvent, plus rarement
de cinq, par une belle et large raie blanche qui , en venant de la
narine, où elle prend naissance, parcourt la région surciliaire, le
haut de la tempe et de la partie latérale du cou , et qui, en arrière
, se prolonge plus ou moins loin le long du côté de la queue,
laquelle est d 'unblanc rosé, ou d'une teinte couleur de chair. Avec
l'âge , les lignes noires se changent en autant de séries de petits
points de la même couleur, et la raie blanche , en même temps
qu'elle passe peu à peu à la teinte fauve du fond, se rétrécit beaucoup
; elle finit même par disparaître complètement chez les trèsvieux
sujets. Certains individus ont les côtés du corps noirs, tiquetés
de blanc ; d'autres, au lieu d'avoir les régions inférieures d'une
teinte blanchâtre, comme c'est le cas le plus ordinaire, les ont
ponctuées de noi r , sur un fond brun ou fauve , comme les parties
supérieures. La queue des individus adultes offre généralement
le même mode de coloration que le dos. La même observation
s'applique aux membres.
DIMENSIONS. Longueur toUile. 18" 9"' . Téle. Long, i " 1"'. Cou.
Lons. i". Tronc. Lonc. 6" 8"'. Memb. anlér. Long. i". Memb.
poster. Long. 1" 5"'. Queue. Long. 10".
PATRIE. Cette espèce est originaire des Indes orientales ; notre
collection nationale en renferme une suite nombreuse d'individus
qui ont été recueillis pour la plupart à la côte Malabar et
à la côte Coromandel par MM. Dussumier, Leschenault et Reynaud.
Observations. La description du muséum du prince Adolphe-
Frédéric par Linné, est l'ouvi^age dans lequel cette espèce semble
1 I