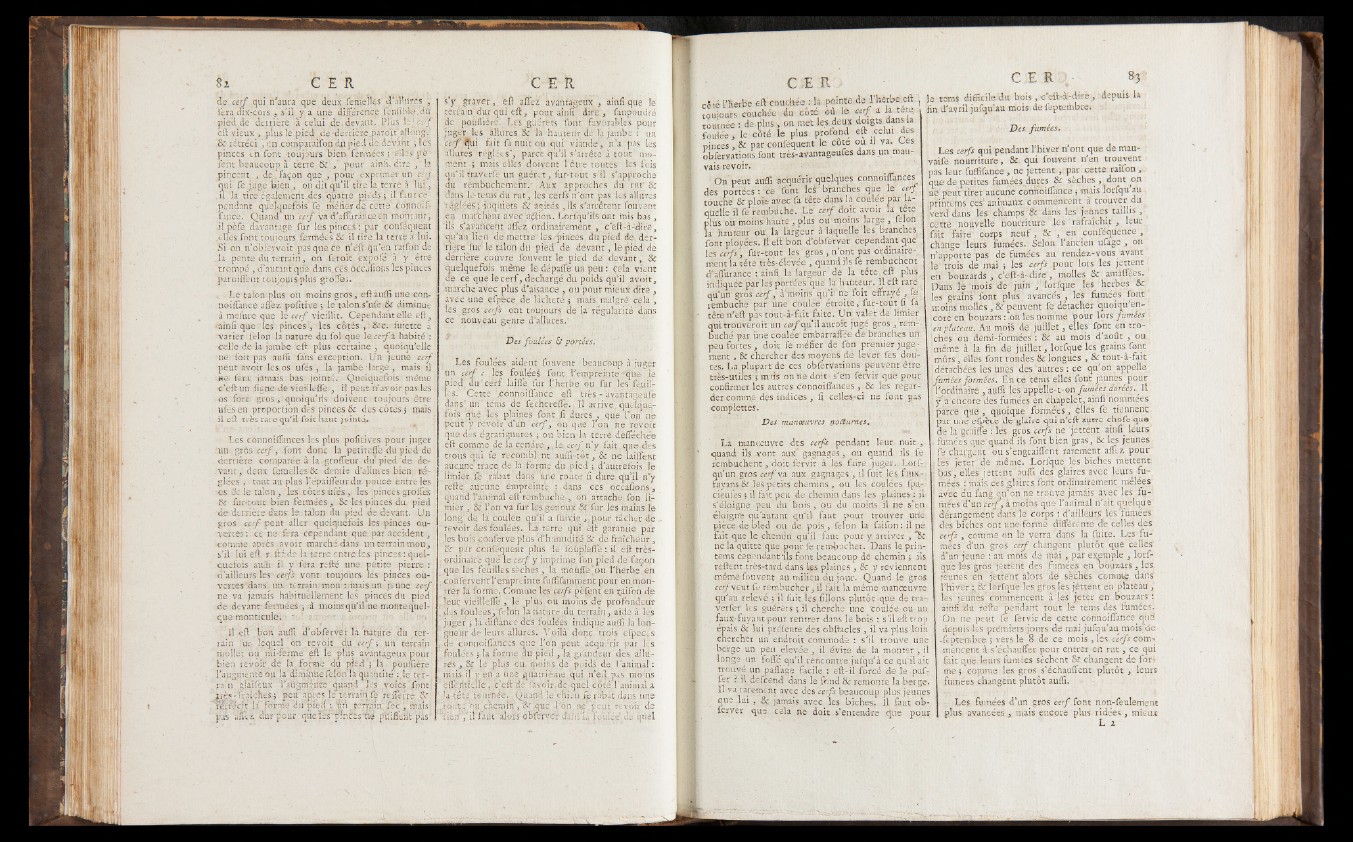
S i C E R
de cerf qui n'aura que deux femelles'' d’ail tirés' ,
fera dix-cors , s 'il y a une différence fenfible.du
pied de derrière -à celui 4 e« devant. Plus "le c ù f
eft vieux , .plus le pied 4è4errièrepàroit'allong;é
& rétréci , en comparaifon dupied de devant 5 les
pinces tn font toujours bien fermées j-ëîlèÿ p è lent
beaucoup à terre 6c 3 pour ainfi.. dire 3 la
pincent / d e , façon que.; p ouf exprimer un cerf
qui fe juge bien , on dit qu'il tire ia te r rè à lu i ,
.il la tire également dès quatre giëdsj il faut cependant
quelquefois" fie ' méfier de cette cônnoifi
fan ce. Quand un cerf va d’affuranceen montant,
il pèfe. davantage fur les.pinc.es':. par conféquent
.elles font toujours fermées ,6c il tire la terré à^ui-
Si on n’obfervcit pas que ce n’ë ftqü ’en tatfpn de
.la pente du terrain, on fieroit èxpofé'à y ■ être
trompe 5 d'autant que dans,ces occafions les piiicës
paroilfent toujours plus grôffes.
Le talon plus oti moins gros;, eft àuffî une con-
noilfance a fiez pofitiveqle talon.s’ufe 6c diminue
à mefure que le cerf vieillit. Cependant elle eft,
iainfi quelles p in c e s / le s côtés , & c . fu jette à
varier félon la nature du fol que leicerfàhabité :
celle de la jambe eft plus certaine , quoiqu'elle
ne- foit pas auffi fans exception/Un jeune cerf
peut avoir les, os Ufësi,: la jambe large, mais il
me fera jamais bas jointé. Quelquefois. même
c ’eft un ligne- de vieillelfe-, il peut n'avoir pas-les
os fort g ro sq u o iq u 'ils doivent toujours être
ufés en proportion des-pinces & des côtés ; mais
il eft très-rare qu'il foit haut jointé.
Les connoiffances les plus pofitives pour juger
- un gros cerf 3 font donc la petiteffie du pied de
derrière comparée à la -groffeur du* pied de. de-
. v-ant,. deux femelles & demie d’allures bien, réglées
j tout au plus l’épaifTeur du pouce ëntre les ,
es & le talon, les côtés uiés,,. les pinces grofïès
6c fur-tom bien fermées , & tes pinces du. pied •de derrière d'ans- le talon du pied de devant. Un
gros ’ cerf peut aller quelquefois les pinces ouvertes:
cé ne fera cependant que. par accident,
comme après lavoir marché dans un terrain mou ,
s'il lui eft r, fté de la terre entre les pinces : quelquefois
aufii il y fera refté une petite pierre r
d’ailleurs les cerfs vont toujours lés pinces ou- ;
vertes dans.', un terrain -mou r imais un ..jeune terf\
ne va jamais habituellement les pinces du pied
de devant’ fermées. ; ; à moinsqu’il ne monte quel- j
que monticule/ 2 / ? .
Il eft bon auffi d'o'bfer/éf la nature dû .fer- ’
rain fur.’’lequel ; b ü f i e y b k ^ d û j c e r f / .un terrain
mollet bu mi-fermé'eft le plus avantageux pour-
bien revoir de la forme du pjtefi 5Ta. poumère
l'augmente bu la" diminué fëpri la quantité :,le'ter-
; rain gjàifeüx Tàügménfè quand lés .yoj'ês-font
jtiès- fraîches.; peu après je terrain fe reiferrs ce rétrécît la forme du pied r ûrî
J p â à'üVl d'üf poiir qüefesvp!n£'ésifâ pàiffelft pas*.
c e R
s’y g r a v e r , eft afîez avantageux 3 ainfi que le
tèrrain dur qui e f t , pour ainfi d i r e , faupoudré
de ‘ poufliërè' Les guérëts font favorables, pour
juger les allures 8c là hauteur de la jambe : un
'cerf '^ui fait fa nuit ou qui viande1, n ’a pas les
allures -réglées’, parce qu’ il s’arrête à t o u t ’ moment
; mais elles doivent 1 être toutes les .fois
q u'il traverfe url g u é r e t , fur-tout s ’il s’ approche
au rémbuchemeht.' A u x approches du r u f '&
dans le-te ras. du ru t , les cerfs n'ont pas les allures
rég lé e s / in q u ie ts 6ç agités ,11s s'arrêtent fouvent
en mafchànt avec àiftion. Lorfqu'ils ont mis bas ,
'ils s’ avancent afifez ordinai/emént, c ’eft-à -d irë ,
qu'au lieu de mettre''les/pinces du pied de, de rrière
fur le talon du pied de d e v a n t , le pied dé
derrière cou vre fouvent le pied de d e van t, &
quelquefois même le dépaffe un peu : cela vient
,de c e que le c e r f , déchargé du poids qu’ il a v o it ,
marché avec plus d’aisance , ou pour mieüx dire ,
avec une çfpêce. de lâcheté ; mais malgré cela ,
les gros cerfi ont toujours de la régularité dans
ce nouveau genre d’allures/
D e s fo ü lé e s & portées.
Les foulées aident fouvent beaucoup à ju ger
un cerf : lès foûlée| font l'empreinte -que- je
pied dir c e r f laiffe fur l’ herbe ou fur les-feu illes.'
'C e t te /onnoiffance eft très -a yantàgeûfe dans.-'ün' terris de fechereffe.. Il arrivé, quelquefois
qüé.’Ies plaines font fi dûtes , que; l’ on ne :pèüt'ÿ fë voir d’un cerf 3 o u q dé l’ on ne révo it
que des égratïgnures'; ou bien la terrè defiéchëe
eft comme d e là c e n d r e ,d e cerf n’y fait, que-des
trous qui fe re comblent a u fiî- tô t , & ne laiffent
aucune trace, de la forme du pied ; d’ autrefois le
limier fe 'rabat dans une route fi dure qu’ il n'y
refte aucune: empreinte /d a n s ces o ç ç à f io n i,
quand l'anîmal eft rembuené^ on '. attache-, fon limier./
$Cl’ on' va fur lësg en ou x 8 / fur .les mains.le '
long' de la coulée qu'il a fui v ie / pour tâcher de ..
revoir des foulées. Là terre qui eft garantie par
les bois cônferve plus d’humidité 6c de fraîcheur ,
& par èohféquent plus le fôujfteffe : il eft très-
ordinaire que le cerf y imprime fon pied de 'façon
que les feuilles sèches, la mouffe ’ ou l’herbe eh
jConféryêhf l’empreinte fuffifamment pour en montrer
la forme. Comme les cerfs pëfient en raifort de
leur yieilleflè , le plus, ou moins .de" profondeur
des foidées; félon la. nature du terrain, aide à les
juger ; la diftàncedës'foulées indique aujfi la'lori-
gueur de leurs allurés. Voilà donc trois efpéces
de connoiffances que l’on peut, acquérir par les
foulées ; la forme du pied , la grandeur des allures
le plus ou- moins dè, poids,de l’animal :
mais-i/y/ti a line quatrième.qui h’eft.pas moins
éflenqêlljè / t ’eft dé fayôircdequel c.oté l ’animal a
ja-tête; 'f©ùtnéé/ Quaddftei/niën fe rabat dans une
ro.jfts;oifchemin yc z jque'd’on,;i(è’.pe,ut revoir de
rien ,/lr fàiïtdioïs' dbféi’vëf dàùs'ia'foïiléé de quel
c E R
c ê té lTierJ» eft:couchée :'la..peinte de th é rb e .e ft :
toûjauïs ■ couchée du c ô t é où lé cerf, a la tete,
tournée : de plus , on met le s deux doigts, dans la
fo u lé e , le cô té le plus profond e ft ,celu i des
p in c e s , & par conféquent le co te ou il va. Ce s
obfervarions.font très-avantageufes dans un mau-
. vais-revoir.
On peut auffi acquérir quelques conr.oiiTances
des portées’ : " c e ; fo n t leé btanches que le'
tou çh é 6c ploie avec' fa tê te dans là, coù le e par la quelle
il fe irembtiche. L e cerf doit avoir là têtp ;
plus :ou moins- haute , plus ou j moins large / félon
la hauteur ou', la largeur à laquelle les b ran ches.
font ployees. Il eft' bon d’obferver cependant que .
les cerfs, fur-tout; les gros., n ’ont pas ordinairement
la rèté tVès-élevée, quand ils fe rembuchent
d?affurance : ainfi la la rg e u r 'd e la tê te , eft plus,
indiquée pafleà' portées que là haUtéuf. I le f t rarè.
qu’ un gros cerf 3; a itibins qu’ i ïn e foit effrayé ^,fe;
rembuche par Une' cou lé e é t r o it e ; fur-tout fi fà'
* tê te n’ eft pas tout-à-fait faite. Ü n v a le t de! limier
qui-trouvèroit un c e r feu ilauroit juge gros , rem--
buché par une coulée' embarraffée de branches un
peu fortes , doit fe méfier de fon premier ju g e ment
, & chercher des moyens dé lev er fes doutes.
La plupart de c e s -obfervatioris peuvent être
tres-utilès > m ds on'ne doit - s’ en ferVir que pour
confirmer les autres connoiffances , & les regarder
commp. des indices 3 fi celles.-ci ne fon t gas
complettes.
Des manoeuvres nofturnes.
L à manceuyre des cerfs pendant leur nuit
quand ils v on t aux'' gagnages, ou quand i l s . fe
rembu ch ent, do it fervir à les faire ju ger., Lorf-
qu’ un gros cerf va. aux gagnages , il fu it les faux-
fu y an s& les petits chemins , ou les, coulées fpa-
cieufes ; il fait peu de chemin dans les plaines-: i
s’ éloigne peu du b o is , ou du moirls il ne s’ e-i
élo ign e q u ’autant qu’ il .faut pour trou ver urié
pièce de bled ou de p o is , félon la faifon : il ne
Fait que le chemin qu’ il 'fa u t pour y arriver i *6c
ne.la quitte que pour fe rembucher. Dans le prin-
tems cependant*ils font beaucoup de chemin ; ils
refteiit très-tard dans fes plaines , 6c y reviennent
■ même fouvent au milieu du jour. Quand le gros
cerf veu t fe rembu ch ér, il fait la même manoeuvre
qu’au relevé ; il fuit, les filions plutôt q u e de tr;
verfer" les guérets ; il cherche une 'coulée ou un,
, faux-fuyant pour rentrer dans le bois : s ’il eft t ro t
épais 6c lui prélente des cbftacles , il va plus loin
chercher un endroit commode : s ’ il trou v e une
b erg e un peu é l e v é e , il é v ite de la monter
longe -un fofle qu’ il reheontre jufqu’ à c e qu’il ait
t rou vé un pairage facile / e ft- il -,forcé de le pafi
fer ?. il defeend dans lé fond 8c remonte la berge.
Il va rarement ayec des cerfs beaucoup plus jeunes
que .lui , 8c jamais a vec les biches. 11 faut ob-
ferve r que . cela , ne do it . s’entendre que pour
C E R ; »3
le terns difficile du bois , c reft-à-dirë ;, depuis la
fin d’ avril jufqmau mois de feptembre.
Des fumées.
Le s cerfs q ui pendant l’hiver n’ ont que de mau-
vaife n ou rr itu re , & qui fou ven t n en trouvent
pas leur fuffifance, ne j e t t e n t p a r ce tte raifon
e de petites fumées^aures & sèches ,. dont o n
: p'èut tirer aucune connoilfance ; mais Iorfqu au
à trou ver du
ivêrcf dans lés champs!$c-dans les 'jeû n e s t a i l li s ,
ce tte nouvelle houtfiture les rafraîchit , leur
fait faité ; corps n e u f , 6c , en confeqùence ,
change leurs fumées. Selon l’ ancien u fa g e , on
'apporte pas de fumées au rend ez -vous avant
: trois de mai > les cerfs pour lors les jettent
w/ bouzards , c’eft-à-dire , molles & amàftées. '
Dans le 'mois de juin / Iorfque les herbes &
les'g ra in s1 font plus ' ayantes , les fumées font
moins mollés , & peuvent fe détacher 'quoiqu’en-
core en 'b ouzars : .on les nomme pour lors fumees
en plateau. Au mois de ju i l le t , elles fpnt en tro -
hes .ou démi-fôrmées1 : & au mois d’ a o u t , ou
nême à la fin de ju i l le t , Iorfque les grains font
mu rs, elles fon t rondes 8c longues , 6c.tou t-à - fa it
détachées les unes des 'autres : ce qu’ on appelle
,fu.niée‘s formées. En c e teins1 elles font jaunes pour
’ ■’u rdinaïfê , 'àuffî. lès àpp'elle-t-on fumées foréès. Il
^^àéiicdre des fumées en çh'àpelét, ainfi nommées
parce q u e , quoiqué fo rm é e s , èîles fe tiennent
par une espèce de glaire qui n’éft autre chofe que
de la graiffe : lès gros- cerfs ne je tten t ainfi leurs
fumées que quand iis font bien g ras, 6c le.s jeunes
fe chargent ou s’ engraiffent rarement affez pou r
les je te r ' de même. Lorfque les biches mettent
b a s ,,elles , je ttent auffi des glaires a v ec leurs-fu-
meés : mais ces .gîâirès font ordinairement mêlées
avec du fang,qu’ on ne troü ve jamàis a v ec les fu mées
d’ un Cerf 3 à mofes que l’animal n’ait quelque
dérangement dans l e corps : d’ ailleurs les fumées
des biches ont Une- forme différente de celles des
cerfs, comme on le verra dans' la fuite. Les fumées
d’un gros cerf changent plutôt que celles*
d’ urt jeune : au mois de mai , par exemple , lorfi-
que les grôs jé n tën t des ‘fôfriées en DÔuzars, les.
jeunes ;en je ttent alors d e sèches coitimç dans'
Î’hivër i 8/ldrfqùe les gros les jê t tén te h 'p là tè â u ,
les jeuriés’ commencent a les je te r en bouzars :
ainfi'4 ü rèfte 'pendant tou t le tems dés fumées.
On né peut fe fervir de ce tte cônnoiffance que
depuis le s premiers jours de mai jufqu’ au mois’de
.feptembre .; vers le 8 de ce mois , le srcerfs comv
..mencent à s ’échauffer pour entrer-en r u t , ce qui
fa it que. leurs fumées sèchent & changent de fo r ;
me 3 comme les gros s’échauffent plu tô t , leurs
fumées changent plutôt auffi. -
■ Le s fumées d ’ un gros cerf fon t non-feulement
plus a v an c é e s ,. mais encore plus r id é e s , mieux
L 2