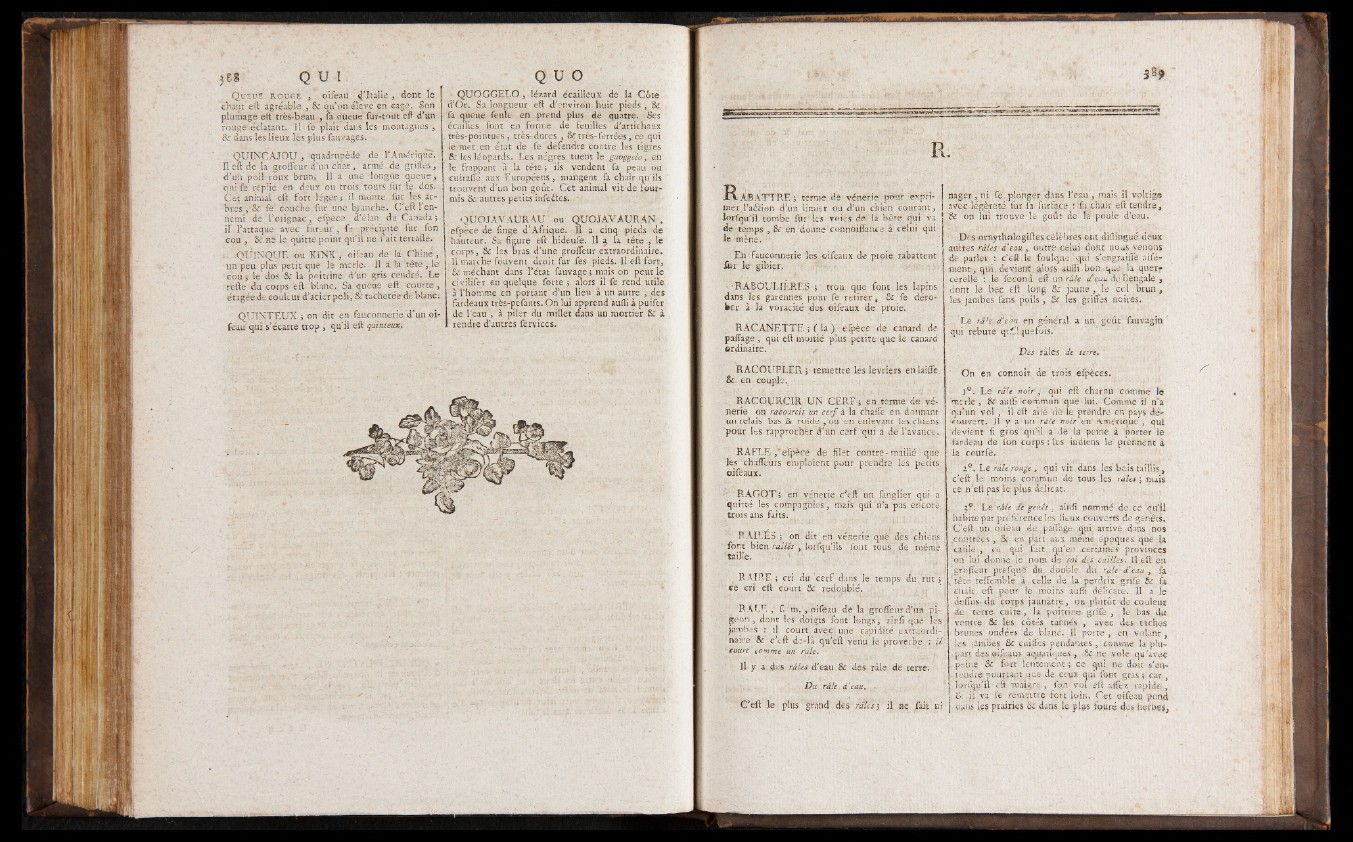
5 CS Q U I
Queue rougé- , oifeau «JTtalia, dont ie
chant eft agréable , & qu’on/élève en cage.. Son
plumage eft très-beau , fa düeue fur-tout eft d’un
rouge.éclatant.- Il- le plaît dans les montagnes ,
<k dans les lieux les plus fauvages.
QUINCAJOU , quadrupède de l’Amérique.
Il eft de la- groffeur »d’un chat, armé de griffes ,
d’ un poil roux brum Il a une longue queue 3
qui fe replie en deux ou trois tours fur 4e dós.
C et animal eft fort léger -, il monte fur les arbres
, & fe couche fur une tu-anche. C ’eft l’ennemi
de l’orignàcK efpèce d’élan du Canada;/
il l’attaque avec fureur, fe précipite fur Ton
cou , & nê le qùitte point qu’ il ne 1 ait terraffé.
,. QÜINQUE. ou KLNK , oifeau de la Chine,
un peu plus petit que le merle.; Il à la tê t e , le'
cou s le dos & la poitrine d’un gris cendré. Le
refte du corps eft blanc, §a queue eft courte,
étagée de coule ur d’acier poli, & tachetée de blanc:
QU INTEU X ; on dit en > fauconnerie d’un oifeau
qui s’écarte trop , qu’il eft quinteux.
q u o
Q U O G G E LO , lézard écailleux de la Côté
d’Or. Sa longueur eft d’environ huit pieds, &
fa queue feule en prend plus de quatre. Ses
écailles font en forme de feuilles d’artichaux
très-pointues 3 très*dures , & très-ferrées, ce qui
le met en état de fe défendre contre les tigres
&: les léopards. Les nègres tuènt le guoggelo r eh
le frappant à la tête; ils vendent fa peau ou
cui'raffe aux Européens , mangent fa chair qu’ils
trouvent d’un bon goût. C et animai vit de fourmis
& autres petits infeétes.
Q U OJAVAUR A.U ou QU O J A V AUR AN ,
efpèce de linge d’Afrique. Il a cinq pieds de
hauteur. Sa figure eft liideufe. 11 a. la tête , le
, corps, & les bras d’une groffeur extraordinaire.
11 maçche fouvent droit fur fes pieds. Il eft fort,
& méchant dans l’état fauvage; mais on peut le
civilifer en quelque forte ; alors il fe rend utile
à l’homme en portant d’ un lieu à un autre , .des
fardeaux très-pefants. On lui apprend àuftî à puifer
de l’eau , à piler du millet dans un mortier & à
rendre d’autres fervices.
3 « ?
R.
R a b a t t r e ; terme de vénerie pour exprimer.
l’aéiion d’un limier ou d’un chien courant,
lorfqu’ il tombe fur' les voies de'là bêtq qui va 1
de temps , & en donne connoiffanee à celui qui
le mene. \ W -
Eli fauconnerie les'oifçaux de proie rabattent
fur le gibier.
- -RABOULIÊRES ; trou que font les lapins
dans les garenhes pour fe retirer # & Te dérober
à la voracité des oifeaux de proie.
R À C A N E T T E 5 f la ) .efpèce de canard de
paffage, qui eft moitié plus petite que le canard
ordinaire.
RAGOUPLER 5 remettre lés lévriers enlaiffe
& en couple. 1..
RA CQU R CIR UN CERF ; en terme de vénerie
on racourcit un cerf, à là chaffe en donnant
un relais bas ,& roide , ou en enlevant les chiens 1
'pour ItrS rapprocher d’un cerf qui a de l’avance.
RAFLEr,"efpèce de filet contre-maillé que
lés chaffeurs emploient.pour prendre les petits
oifeaux.
R A G O T ; en vénerie c’ eft un fanglier qui a
quitté les compagnies, mais; qui n’a pas encore i
trois ans faits. ..
R AILÉS ; on dit' en vénerie que dès chiens J
font bien railés , lorfqu’ils font tous de même :
taille.
R AIRE ; cri du cerf dans le temps du. rut';
ce cri eft court & redoublé.
RALE , f. m ., oifeau de la groffeur d’un pigeon
, dont les doigts font longs - ainfi que lès
jambes : il court avec une rapidité extrr,ordi-:
naire & c\.ft de-là qu’eft venu le proverbe. : il
court comme un râle.
Il y a des râles d’eau & des râle de terre.
Du râle, d'eau.
C e f t le plus grand à e s rd le s i il ne fait ni
nager, ni fe plonger dans l’eau , mais il voltige
avecdégèreté fur la fiirface.r.feohair eft tendre,
& on lui trouve le goût de la poule d’eau.
Des ornythologifles célèbres or«t diftingué deux
aultes râles d’eau, outre .celui dont nous venons
de parler : çeft le foulque qui s’engraiffé aifé-
ment', qui, devient- alors auffi bon que-, la query
cerelle : le fécond eft un râk d'eau de Bengale ,
•dont le bec eft long & jaune, le col brun,
les jambes fané poils, & les griffes noires. :
Le râk d'eau en général a un goût fauvagin
qui rebute quelquefois.
Des râles de terre.
On en connoît de trois éfpèces,
iQ. Le raie noir, qui eft charnu comme le
merle, & auiî commun que lui. Comme il n’ a
qu-un v o l , il eft aifé dë le prendre en pays découvert.
Il y a un râle hoir en Amérique , qui
dévient fi gros"qu’il a de la peine à porter iè
fardeau de fon corps fies indiens le prennent à
la courfe. |
zQ . Le râle rouge 3 qui vit dans les bois taillis,
c’eft le moins, corqmun de tous les râles $ mais
ce n’ eft pas le plus délicat.
. 3P. Le râle dle genêt. ainfi nommé de.ee qu’il
habite par préférence les lieux couverts de genêts.
C ’eff uri-oifeau .de .paiTege qui arrive dans nos
,cqntréès, Sç ên paft aux même époques que U
caille ,. ce qui fait qu’eu .certaines provinces
'^oh ' Iûi dd.nue-.Lë.mom de roi descailles. 11 eft en
grofteur prefquë' du double du raie d'eau, fa
étêt'e reffemble ’ à celle de Ja perdrix grife & fa
chair, eft pour le moins âuffi délicate. Il a le
.defftis-du corps jaunâtre, ou plutôt de couleur
de terre, cuite , la poitrine grife , . le bas du
ventre & les côtés tannés , avec des tâchés
brunes ondées de blanc. Il porte , en volant,
les jambes & cuiffes pendantes, comme la plupart
dés .oifeaux aquatiques , : 8c ne vole qu’avec
. peine fort lentement ; ce qui ne doit s’en-
, tendre pourtant que de ceux qui font gras ; car ,
lorfqu’ ii eft ’maigre , fon vof eft affez rapide,
& riL va fe remettre fot-t loin. Cet oifeau pond
dans les prairies & dans, le plus fouré 4os hefpeSj
m