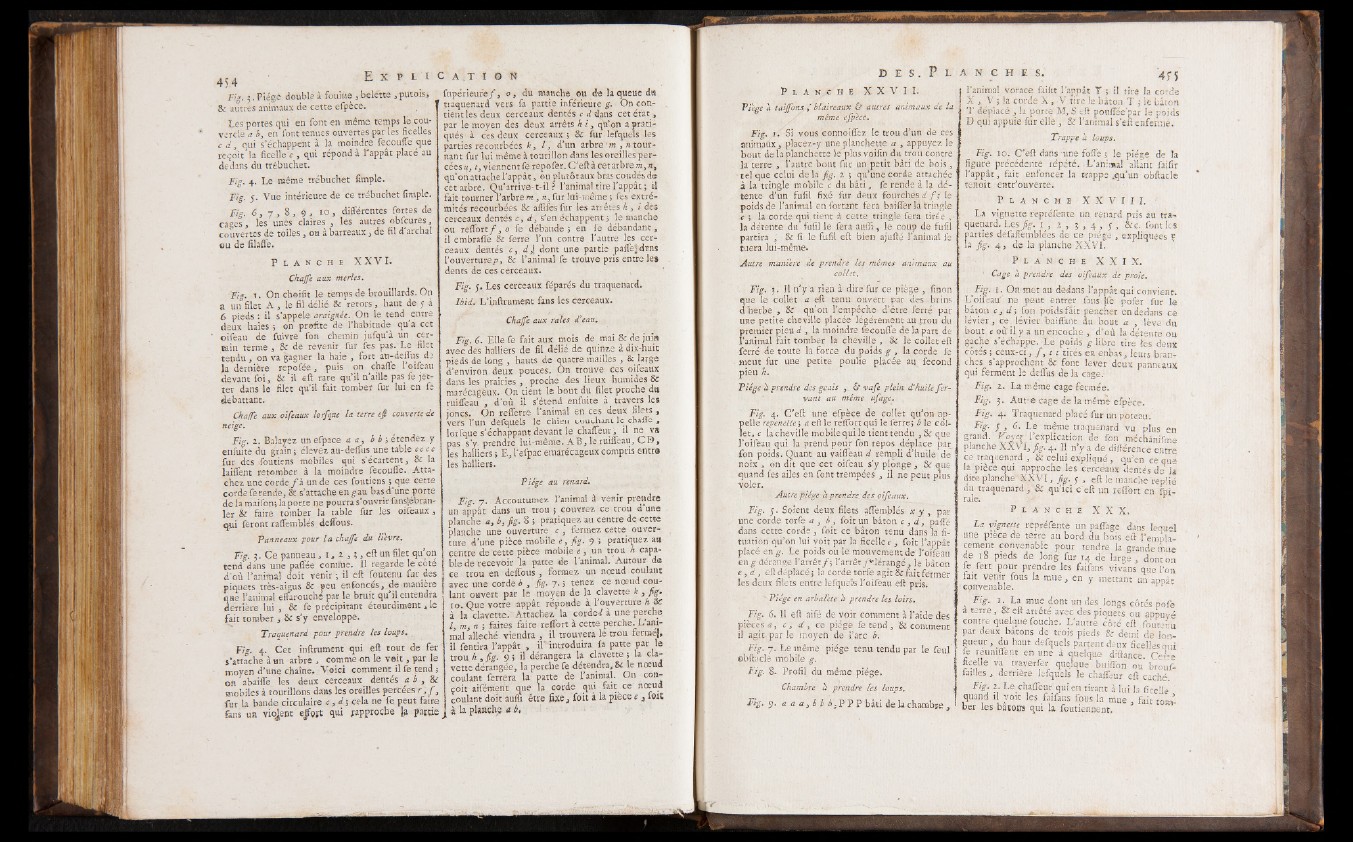
454 E x P L I
Fig. 3. Piège double à fouine 3 belette , putois,
& autres animaux de cette efpèce.
Les portes qui en font en même temps le couvercle
a b y en font tenues ouvertes par les ficelles c d y qui s’échappent à la moindre fecouffe que
reçoit la ficelle e 3 qui répond a 1 appat placé au
dedans du trébuchet.
Fig. 4. Le même trébuchet impie.
Fig. y. Vue intérieure de ce trébuchet impie.
Fig. 6 s 7 , 8 , 9 , 1 0 , différentes fortes de
cage s , les unes claires , les autres obfçures,
couvertes de toiles , ou à barreaux 3 de fil d’ archal
ou de filaffe.
P l a n c h e X X V I .
Ckajfe aux merles.
c a t i o n
fnpérieure/, o , du manche ou de là queue da
1 traquenard vers fa partie inférieure g. On contient
Fig. f. On choifit le temps de brouillards. On
a un filet A , le fil délié & retors, haut de y à 6 pieds : il s’appele araignée. On le tend entre
deux haies ; on profite de l’habitude qu’ a cet
oifeau de fuivre fon chemin jufqu a un cer-
tain terme 3 & de revenir fur fes pas. Le filet
tendu, on va gagner là haie , fort atr-deflus dè
la dernière repofée, puis on chaffe l’oifeau
devant fo i, & il eft rare qu’il n’aille pas fe jet-
ter dans le filet qu’il fait tomber fur lui en fe
débattant.
Ckajfe aux oifeaux lorfqae la terre eft couverte de
neige.
Fig. 2. Balayez un efpace a a y b b 5 étendez y
enfuite dü grain ; élevez au-deffus une table cc cc
fur des .foutiens mobiles qui s’écartent, Sc la
laiffent retomber à la moindre fecouffe. Attachez
une corde ƒ à un de ces foutiens ; que cette
corde fe rende, & s’attache en gau bas d’ une porte
de la maifon, la porte ne pourra s’ouvrir fansjebran-
ler & faire tomber la table fur les oifeaux,
qui feront raffemblés deffous.
Vanneaux pour la ckajfe du lièvre.
Fig. 3. C e panneau, 1 , 2 , 3 , eft un filet qu’ on
tend dans une paffée conifue. Il regarde le cote
d’où l’animal doit venir *, il eft foutenu fur des
piquets très-aigus & peu enfoncés, de manière
ene l’animal effarouche par le bruit qu’ il entendra
derrière lu i , & fe précipitant étourdiment, le
fait tomber , & s’y enveloppe.
Traquenard pour prendre les loups. '
Fig. 4. C e t infiniment qui eft tout de fer
s’attache à un arbre , comme on le v o i t , par le
moyen d’ une chaîne. Vo ic i commentai fe tend ;
oh abaiffe les deux cerceaux dentés a b , &
mobiles à tourillons dans les oreilles percées r , ƒ ,
fur la bande circulaire cy d-3 cela ne fe peut faire
fans un violent effort qui ^approche Ja partie
les deux cerceaux dentés c d dans cet é ta t ,
par le moyen des deux arrêts h i , qu’on a pratiqués
à ces deux cerceaux 5 & fur lesquels les
parties recourbées k3 l 3 d’un arbre ' m ,» tournant
fur lui même à tourillon dans les oreilles percées
uy ty viennent fe repofer. C ’ eft à cet arbre m, «,
qu’on attache l’appât, eu plutôt aux bras coudés de
cet atbre. Qu’ arrive-1-il ? l ’animal tire l’ appât ; il
faip tourner l’arbre m , n3 fur lui-même j fes extrémités'
recourbées & affifes fur les arrêtes h , i des
cerceaux dentés cy d 3 s’en échappent > le manche
ou reffort/', 0 fe débande j en fe débandant,
il embraffe & ferre l’un contre l’autre les cerceaux
dentés cy,d 3\ dont une partie paffe|drns
l’ouverturep, & l’animal fe trouve pris entre le»
dents de ces cerceaux.
Fig. y. Les cerceaux féparés du traquenard.
Ibid. L ’inftrument fans les cerceaux.
Ckajfe aux raies d’eau.
Fig. 6. Elle fe fait aux mois de mai & de juin
avec des huiliers de fil délié de quinze à dix-huit
pieds de long , hauts de quatre maillés, & large
d’environ deux pouces. On trouve ces oifeaux
dans les prairies , proche des lieux humides &
marécageux. On tient le bout du filet proche du
ruiffeau , d ’où il s’étend enfuite à travers les
joncs. On refferre l’ animal en ces deux filets ,
vers l’un defqueîs le chien couchant le chaffe ,
lorfque s’échappant devant le chaffeur^ il ne va
pas s’y prendre lui-même. A B , le ruiffeau, C B ,
les halliers > E , l'efpac emarécageux compris entra
les halliers.
Piège au renard.
Fig. 7. Accoutumez l’animal à venir prendre
un appât dans un trou > couvrez ce trou d’une
planche a, b3 fig. 8 > pratiquez au centre de cette
planche une ouverture c , fermez cette ouverture
d’une pièce mobile e, fig. 9 > pratiquez au
centre de'cette pièce mobile e , un trou A capable
de recevoir la patte de l ’animal. Autour de
ce trou en deffous , formez un noeud coulant
avec une corde b , fig. 7• i tenez ce noeud coulant
ouvert par le moyen de la clavette k , fig*
10. Que votre appât réponde à l’ouverture h QC
à la clavette. Attachez la corde^ à une perche l3 m, n ; faites faire reffort à cette perche. L’animal
alléché viendra , il trouvera le trou fermée
il fentira l’appât , il'introduira fa patte par le
trou h , fig. 9 ; il dérangera la clavette ; la clavette
dérangée, la perche fe détendra, & le noeud
.coulant ferrera la patte de l’ animal. On conçoit
aifémerit que la corde qui fait ce noeud
coulant doit aum être fixe 9 foit a la pièce e ^ foit
à la planche a b,
D E S. P L
P l a n c h e X X V I I .
Piège a taijfons, J blaireaux & autres animaux de la
même efpèce.
Fig■. j. Si vous connoiffez le trou d’ un de ces
animadx, placez-y une planchette a , appuyez le
bout de la planchette le" plus voifin du trou contre
la terre , l ’autre bout fur un petit bâti de bois ,
•tel que celui delà fig. 2 ; qu’ une corde attachée
à la tringle mobile c du b â ti, fe rende à la détente
d’ un fufil fixé fur deux fourches d ƒ / le
poids de l’animal en fortant fera baiffer la tringle c y la corde qui tient à cette tringle fera tirée
la détente du fufil le fera aiiffi, le coup de fufil
partira & fi le fufil eft bien ajufté l’animal fe
tuera lui-même.
Autre manière de prendre les mêmes animaux au
colin.
Fig. 3. Il n’y a rien à dire'fur ce piège , fînon
que le collet a eft tenu ouvert par -des. brins
d ’herbe , & qu’on l’empêche d’être ferré par
une petite cheville placée légèrement au trou du
premier pieu d , la moindre fecouffe de la part de
l ’animal fait tomber la cheville , & le collet eft
ferré de toute la force du poids g , la, corde fe
meut fur une petite poulie placée au fécond
pieu h.
Piège a prendre des geais 3. & vafe plein d'huile fer-
vant au même ufage.
Fig. 4. C ’eft une efpèce de collet qu’on apÏielle
repenelle j a efl le reffort qui le ferre; k le col-
et, c la cheville mobile qui le tient tendu , & que
l ’oifeau qui la prend pour fon repos déplace par
fon poids. Quant au vaiffeau d rempli d’ huile de !
noix , on dit que cet oifeau s’y plonge, & que i
quand fes ailes en font trempées , il ne peut plus
voler. Autre piège a prendre des oifeaux.
Fig. y. Soient deux filets affemblés x y , par
une corde torfe a , b , foit un bâton c 3 d 3 paffé
dans cette corde j foit ce bâton tenu dans la fi-
tuation qu’on lui voit par la ficelle c , foit l'appât
placé en g. Le poids ou le mouvement de l'oifeau
en g dérange l'arrêt ƒ ; l'arrêt /"dérangé , le bâton e , d , efl déplacé j la corde torfe agit & fait fermer
les deux filets entre le (quels l'oifeau eft pris.
' Piège en arbalète a prendre les loirs.
Fig. 6. II eft aifé de voir comment à l’aide des
pièces a, t , i , ce piège fe tend, & comment
il agit, par le moyen de l ’arc b.
Fig. 7. Le même piège tenu tendu par le feul
©bftacle mobile g.
Fig. 8. Profil du même piège.
Chambre a prendre les loups. i
Fig. 9. a a a 3 b b b. P P P bâti de la chambre ,
A N C H E S . '
i l’ animal vorace faifit l'appât Y ; il tire la corde
X , V j la corde X , V tire le bâton T ; le bâton
T déplacé , la porte M, S eft poulîée'par le poids
D qui appuie fur e l le , & l’animal s’eft enfermé.
Trappe à loups.
Fig. 10. C ’eft dans une foffe ; le piège de la
figure précédente répété. .L'animal allant faifir
l’ appât, fait enfoncer la trappe .qu’ un obftacle
tenoit entrouverte.
P l a n c h e X X V I I I . '
La vignette repréfente un renard pris au traquenard.
Les fig. i_, 2 , 3 , 4 , y , & c . font les
parties défaffemblées de ce piège , expliquées Ç
la fig. 4 , de la planche-XXVI.
P l a n c h e X X I X .
' Cage à prendre des oifeaux de proie.
Ftg. 1. On met au dedans l’appât qui convient.
L’oifeau' ne peut entrer fans |fe pofer fur le
bâton c 3 d-, fon poids fait pencher en dedans ce
l'évier, ce dévier baiffant du bout a , lève du
bout e ou il y a un encoche ,■ d’où la détente ou
gâche s’échappe. Lé poids g libre tire les deux
côtés ; ceux-ci, ƒ , 11 tirés en enbas, leurs bran-
, ches s'approchent & font lever deux panneaux
qui ferment le deffus dè la cage:
Fig. 1 . La même cage fermée.
Fig. 3. Aut1 e cage de la même efpèce.
Fig. 4. Traquenard placé fur un poteau.
Fig. y , 6. Le même traquenard vu plus en
grand. Voye^ l’explication de fon méchànifme
planche X X V I, fig. 4. Il n'y a de différence entre
ce traquenard , & celui expliqué , qu’en ce que
la pièce qui approche les cerceaux dentés de la
dite planche X X V I , fig. y , eft le manche replié
du traquenard, & qu’ici c'eft un reffort en fpi-
raîe. . r P t A' N c h E X X X ,
La vignette repréfente un paffage dans lequel
une pièce de terre au bord du bois eft l ’empla-
[ cernent convenable pour tendre la grande mue
de 18 pieds de long fur 14 de large , dont on
i fe fert pour prendre les faifans vivans que l’on
| fait venir fous la mue , en y mettant un appât
î convenable.
, F!e- !• La mue dont un dès longs côtés pofe
i a Mrre> &,eft anêté avec des piquets ou appuyé
: contre quelque fouche. L’autre côté eft fout.=ru
par deux bâtons de trois pieds & demi de lon-
gueur, du haut defqueîs partent deux ficelles qui
fe réunifient en une à quelque diftance. Cet-e
ficelle va ttaverfer quelque buiffon ou’ brou7-
failles, derrière lefquels le chaffeur eft caché.
Fig. 1. Le chaflèur qui en tirant à lui la fice’le
quand il voit les faifans fous la mue fait tomber
les batotrs qui la foutiennent.