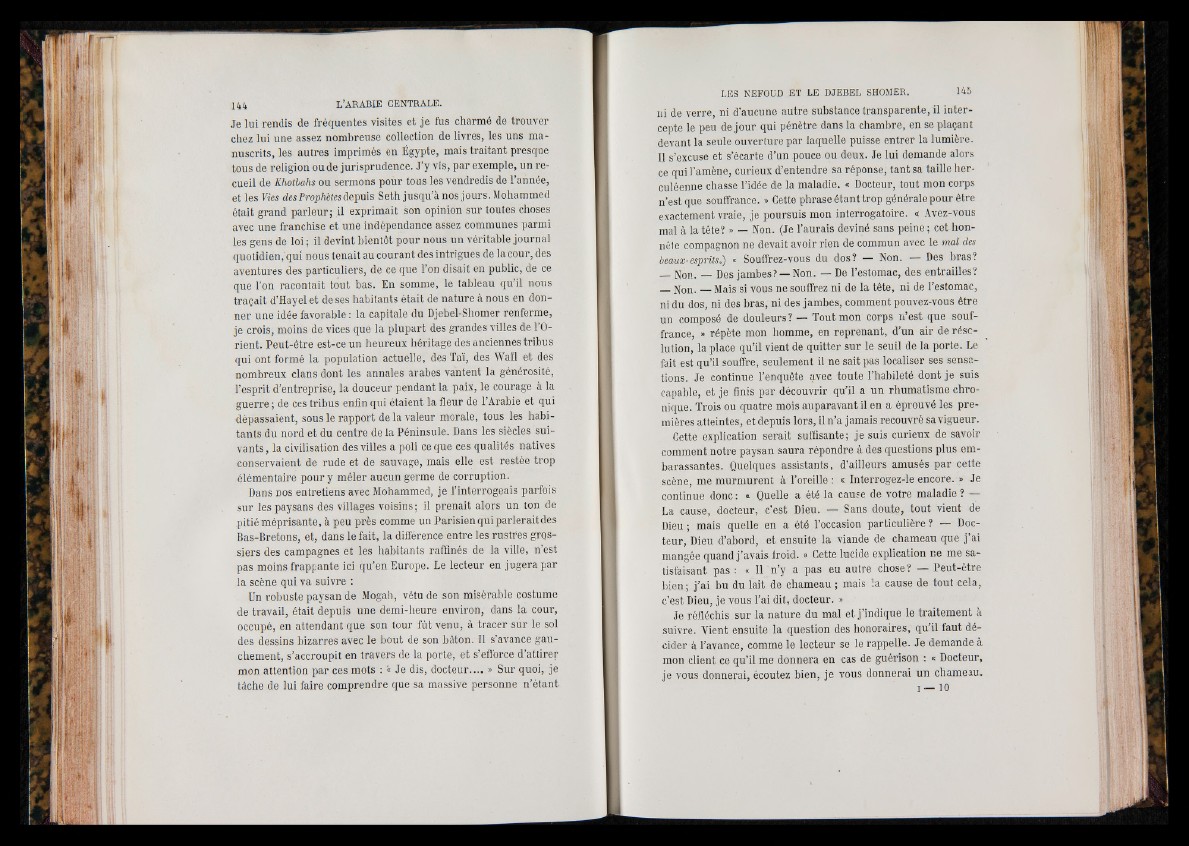
Je lui rendis de fréquentes visites et je fus charmé de trouver
chez lui une assez nombreuse collection de livres, les uns manuscrits,
les autres imprimés en Égypte, mais traitant presque
tous de religion ou de jurisprudence. J’y vis, par exemple, un recueil
de Khotbahs ou sermons pour tous les vendredis de l’année,
et les Viesdes Prophètes depuis Seth jusqu’à nos jours. Mohammed
était grand parleur; il exprimait son opinion sur toutes choses
avec une franchise et une indépendance assez communes parmi
les gens de loi ; il devint bientôt pour nous un véritable journal
quotidien, qui nous tenait au courant des intrigues de la cour, des
aventures des particuliers, de ce que l’on disait en public, de ce
que l’on racontait tout bas. En somme, le tableau qu’il nous
traçait d’Hayel et de ses habitants était de nature à nous en donner
une idée favorable : la capitale du Djebel-Shomer renferme,
je crois, moins de vices que la plupart des grandes villes de l’Orient.
Peut-être est-ce un heureux héritage des anciennes tribus
qui ont formé la population actuelle, des Taï, des Waïl et des
nombreux clans dont les annales arabes vantent la générosité,
l’esprit d’entreprise, la douceur pendant la paix, le courage à la
guerre ; de ces tribus enfin qui étaient la fleur de l’Arabie et qui
dépassaient, sous le rapport de la valeur morale, tous les habitants
du nord et du centre de la Péninsule. Dans les siècles suivants,
la civilisation des villes a poli ce que ces qualités natives
conservaient de rude et de sauvage, mais elle est restée trop
élémentaire pour y mêler aucun germe de corruption.
Dans d o s entretiens avec Mohammed, je l’interrogeais parfois
sur les paysans des villages voisins; il prenait alors un ton de
pitié méprisante, à peu près comme un Parisien qui parlerait des
Bas-Bretons, et, dans le fait, la différence entre les rustres grQS-
siers des campagnes et les habitants raffinés de la ville, n'est
pas moins frappante ici qu’en Europe. Le lecteur en jugera par
la scène qui va suivre :
Un robuste paysan de Mogah, vêtu de son misérable costume
de travail, était depuis une demi-heure environ, dans la cour,
occupé, en attendant que son tour fût venu, à tracer sur le sol
des dessins bizarres avec le bout de son bâton. Il s’avance gauchement,
s’accroupit en travers de la porte, et s’efforce d’attirer
mon attention par ces mots : * Je dis, docteur.... » Sur quoi, je
tâche de lui faire comprendre que sa massive personne n’étant
ni de verre, ni d’aucune autre substance transparente, il in te rcepte
le peu de jo u r qui pénètre dans la chambre, en se plaçant
devant la seule ouverture par laquelle puisse entre r la lumière.
Il s’excuse e t s’écarte d’un pouce ou deux. Je lui demande alors
ce qui l’amène, curieux d’entendre sa réponse, ta n t sa taille h e rculéenne
chasse l ’idée de la maladie. « Docteur, tout mon corps
n’est que souffrance. « Cette phrase é tan t trop générale pour être
exactement vraie, je poursuis mon interrogatoire. « Avez-vous
mal à la tête? » — Non. (Je l’aurais deviné sans peine ; cet honnête
compagnon ne devait avoir rien de commun avec le mal des
beaux-esprits.) a Souffrez-vous du dos? — Non. Des bras?
Non. — Des jambes? — Non. — De l’estomac, des entrailles?
Non. — Mais si vous ne souffrez ni de la tête, ni de l’estomac,
ni du dos, ni des bras, ni des jambes, comment pouvez-vous être
un composé de douleurs? — Tout mon corps n’est que souffrance,
» répète mon homme, en rep ren an t, d’un air de résolution,
la place qu’il vient de quitter su r le seuil de la porte. Le
fait est qu’il souffre, seulement il ne sait pas localiser ses sensations.
Je continue l’enquête avec toute l’habileté dont je suis
capable, et je finis par découvrir qu’il a un rhumatisme chronique.
Trois ou quatre mois auparavant il en a éprouvé les p re mières
atteintes, et depuis lors, i ln ’a jamais recouvré sa vigueur.
Cette explication serait suffisante; je suis curieux de savoir
comment notre paysan saura répondre à des questions plus em-
barassantes. Quelques assistants, d’ailleurs amusés p a r cette
scène, me murmurent à l’oreille : « Interrogez-le encore. * Je
continue donc : » Quelle a été la cause de votre maladie ? —
La cause, docteur, c’est Dieu. — Sans doute, to u t vient de
Dieu ; mais quelle en a été l’occasion particulière ? — Docte
u r, Dieu d’abord, et ensuite la viande de chameau que j ’ai
mangée quand j ’avais froid. » Cette lucide explication ne me satisfaisant
pas : « Il n ’y a pas eu autre chose? — P eut-être
b ien ; j ’ai bu du lait de chameau ; mais la cause de to u t cela,
c’est Dieu, je vous l’ai dit, docteur. »
Je réfléchis su r la nature du mal et j ’indique le tra item en t à
suivre. Vient ensuite la question des honoraires, qu’il faut décider
à l’avance, comme le le cteur se le rappelle. Je demande à
mon client ce qu’il me donnera en cas de guérison : « Docteur,
je vous donnerai, écoutez bien, je vous donnerai u n chameau.
i — 10