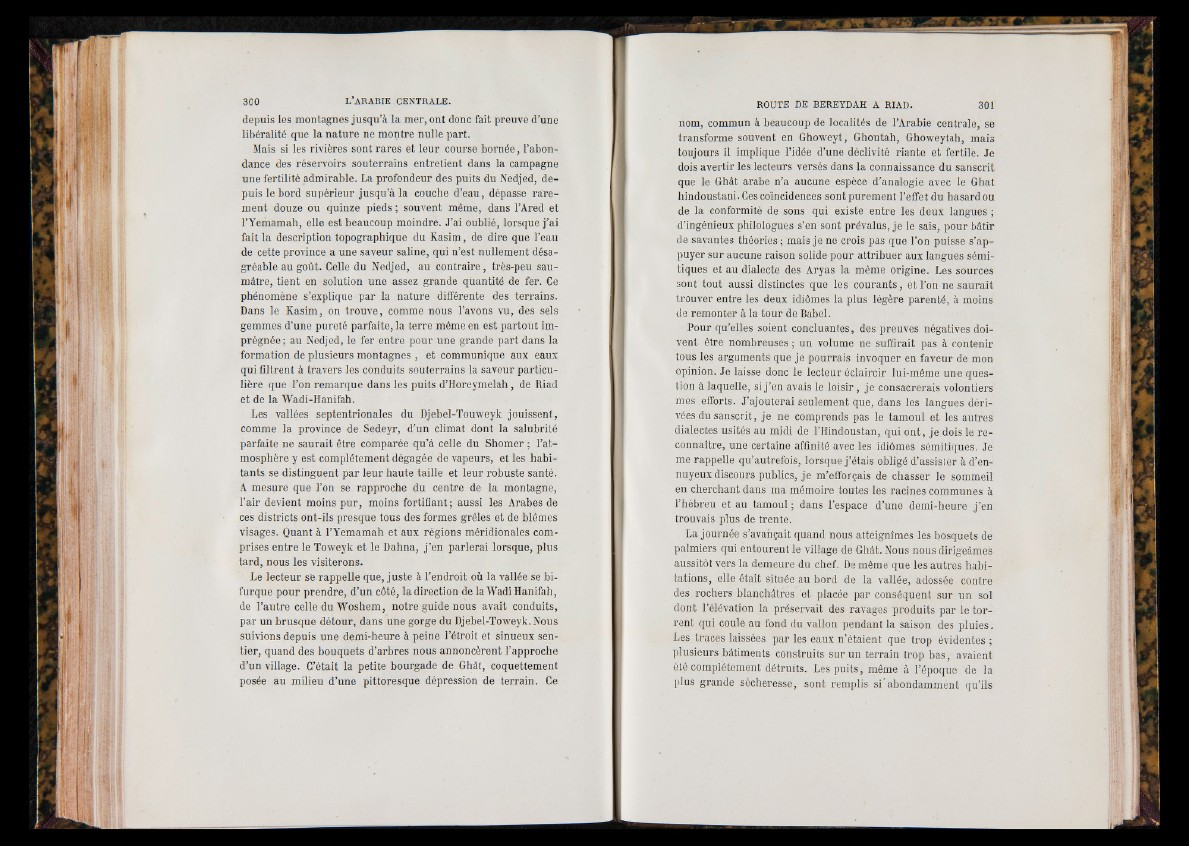
depuis les montagnes jusqu’à la mer, ont donc fait preuve d’une
libéralité que la n a tu re ne montre nulle part.
Mais si les rivières sont ra re s et leu r course b o rn ée, l’abondance
des réservoirs souterrains entretient dans la campagne
une fertilité admirable. La profondeur des puits du Nedjed, depuis
le bord supérieur ju sq u ’à la couche d’e a u , dépasse ra re ment
douze ou quinze pieds ; souvent même, dans l ’Ared et
l’Yemamah, elle est beaucoup moindre. J’ai oublié, lorsque j’ai
fait la description topographique du Kasim, de dire que l’eau
de cette province a une saveur saline, qui n ’est nullement désagréable
au goût. Celle du Nedjed, au co n tra ire, très-peu saumâtre,
tie n t en solution une assez grande qüantité de fer. Ce
phénomène s’explique par la nature différente des terrains.
Dans le Kasim, on trouve, comme nous l’avons vu, des sels
gemmes d’une pureté parfaite, la terre même en est partout imprégnée
; au Nedjed, le fer entre pour une grande p art dans la
formation de plusieurs montagnes , e t communique aux eaux
qui filtrent à travers les conduits souterrains la saveur particulière
que l’on remarque dans les puits d’Horeymelah, de Riad
e t de la Wadi-Hanifah.
Les vallées septentrionales du Djebel-Touweyk jouissent,
comme la province de Sedeyr, d’un climat dont la salubrité
parfaite ne saurait être comparée qu’à celle du Shomer ; l’atmosphère
y est complètement dégagée de vapeurs, et les habitan
ts se distinguent p a r leur haute taille et leur robuste santé.
A mesure que l’on se rapproche du centre de la montagne,
l’air devient moins p u r, moins fortifiant; aussi les Arabes de
ces districts ont-ils presque tous des formes grêles et de blêmes
visages. Quant à l ’Yemamah et aux régions méridionales comprises
entre le Toweyk et le Dahna, j ’en parlerai lorsque, plus
fard, nous les visiterons.
Le lecteur se rappelle que, ju s te à l’endroit où la vallée se bifurque
pour prendre, d’un côté, la direction de la Wadi Hanifah,
de l ’au tre celle du Woshem, notre guide nous avait conduits,
par un brusque détour, dans une gorge du Djebel-Toweyk.Nous
suivions depuis une demi-heure à peine l’étroit et sinueux sentie
r, quand des bouquets d’arbres nous annoncèrent l’approche
d’un village. C’était la petite bourgade de Ghât, coquettement
posée au milieu d’une pittoresque dépression de terrain. Ce
nom, commun à beaucoup de localités de l’Arabie centrale, se
transforme souvent en Ghoweyt, Ghoutah, Ghoweytah, mais
toujours il implique l’idée d’une déclivité riante e t fertile. Je
dois avertir les lecteurs versés dans la connaissance du sanscrit
que le Ghât arabe n’a aucune espèce d’analogie avec le Ghat
hindoustani. Ces coïncidences sont purement l’effet du hasard ou
de la conformité de sons qui existe entre les deux langues ;
d’ingénieux philologues s’en sont prévalus, je le sais, pour bâtir
de savantes théories ; mais je ne crois pas que l ’on puisse s’ap puyer
sur aucune raison solide pour attribuer aux langues sémitiques
et au dialecte des Aryas la même origine. Les sources
sont tout aussi distinctes que les co u ra n ts , e t l’on ne sa u ra it
trouver entre les deux idiômes la plus légère parenté, à moins
de remonter à la tour de Babel.
Pour qu’elles soient concluantes, des preuves négatives doivent
être nombreuses ; un volume ne suffirait pas à contenir
tous les arguments que je pourrais invoquer en faveur de mon
opinion. Je laisse donc le lecteur éclaircir lui-même une question
à laquelle, si j ’en avais le lo is ir, je consacrerais volontiers
mes efforts. J’ajouterai seulement que, dans les langues dérivées
du sanscrit, je ne comprends pas le tamoul et les aulres
dialectes usités au midi de l’Hindoustan, qui o n t, je dois la r e connaître,
une certaine affinité avec les idiômes sémitiques. Je
me rappelle qu’autrefois, lorsque j ’étais obligé d’assister à d’ennuyeux
discours publics, je m’efforçais de chasser le sommeil
en cherchant dans ma mémoire toutes les racines communes à
l’hébreu et au tamoul ; dans l ’espace d’une demi-heure j ’en
trouvais plus de trente.
La journée s’avançait quand nous atteignîmes les bosquets de
palmiers qui entourent le village de Ghât. Nous nous dirigeâmes
aussitôt vers la demeure du chef. De même que les autres habitations,
elle était située au bord de la vallée, adossée contre
des rochers blanchâtres et placéé par conséquent sur u n sol
dont l ’élévation la préservait des ravages produits par le to rren
t qui coule au fond du vallon pendant la saison des p lu ie s.
Les traces laissées p a r les eaux n ’étaient que trop évidentes ;
plusieurs bâtiments construits sur un terrain trop bas, avaient
été complètement détruits. Les puits, même à l’époque de la
plus grande sécheresse, sont remplis si'abondammént qu’ils