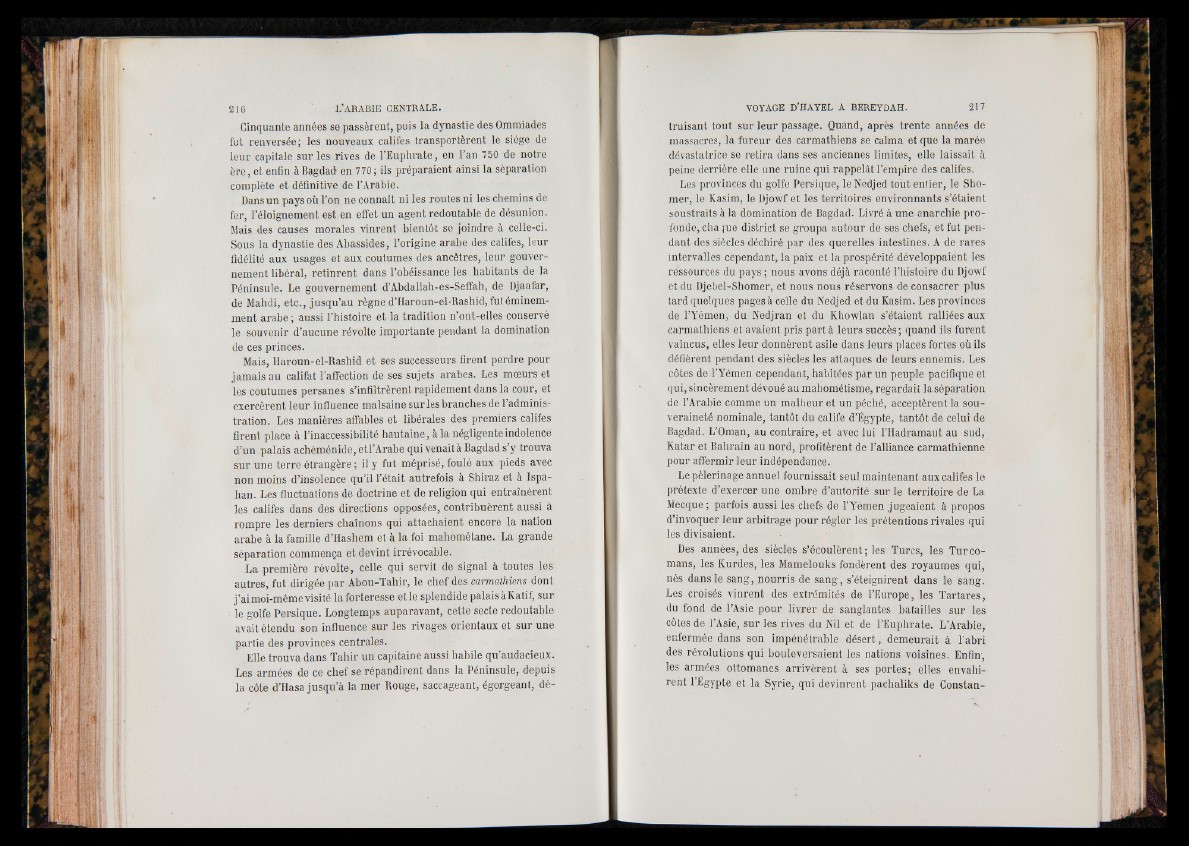
Cinquante années se p assèrent, puis la dynastie des Ommiades
fut renversée; les nouveaux califes transportèrent le siège de
leu r capitale su r les rives de l’E u p h ra te , en l’an ”50 de notre
è r e , et enfin à Bagdad en 770 ; ils préparaient ainsi la séparation
complète e t définitive de l’Arabie.
Dans un pays où l’on ne connaît ni les routes ni les chemins de
fer, l’éloignement est en effet un agent redoutable de désunion.
Mais des causes morales vinrent bientôt se joindre à celle-ci.
Sous la dynastie des Abassides, l’origine arabe des califes, leur
fidélité aux usages et aux coutumes des ancêtres, leur gouvernement
libéral, re tin ren t dans l’obéissance les habitants de la
Péninsule. Le gouvernement d’Abdallah-es-Seffah, de Djaafar,
de Mahdi, etc., ju sq u 'au règne d’Haroun-el-Rashid, fut éminemment
arabe ; aussi l’histoire et la tradition n’ont-elles conservé
le souvenir d’aucune révolte importante pendant la domination
de ces princes.
Mais, Haroun-el-Rashid e t ses successeurs firent perdre pour
jam ais au califat l’affection de ses sujets arabes. Les moeurs et
les coutumes persanes s’infiltrèrent rapidement dans la cour, et
exercèrent le u r influence malsaine sur les branches de l’administration.
Les manières affables e t libérales des premiers califes
firent place à l’inaccessibilité hautaine, à la négligente indolence
d’u n palais achéménide, e tl’Arabe qui venait à Bagdad s’y trouva
su r une te rre étrangère ; il y fut méprisé, foulé aux pieds avec
non moins d’insolence q u ’il l’était autrefois à Shiraz et à Ispa-
han. Les fluctuations de doctrine et de religion qui entraînèrent
les califes dans des directions opposées, contribuèrent aussi à
rompre les derniers chaînons qui attachaient encore la nation
arabe à la famille d’Hashem et à la foi mahométane. La grande
séparation commença et devint irrévocable.
La première révolte, celle qui servit de signal à toutes les
autres, fut dirigée p a r Abou-Tahir, le chef des carmathiens dont
j ’aimoi-même visité la forteresse et le splendide palais àKatif, sur
le golfe Persique. Longtemps auparavant, cette secte redoutable
avait étendu son influence sur les rivages orientaux et su r une
partie des provinces centrales.
Elle trouva dans Tahir un capitaine aussi habile qu’audacieux.
Les armées de ce chef se répandirent dans la Péninsule, depuis
la côte d’Hasa ju sq u ’à la mer Rouge, saccageant, égorgeant, détruisant
tout sur leur passage. Quand, après trente années de
massacres, la fu reu r des carmathiens se calma et que la marée
dévastatrice se re tira dans ses anciennes limites, elle laissait à
peine derrière elle une ruine qui rappelât l’empire des califes.
Les provinces du golfe Persique, leNedjed tout entier, le Sho-
mer, le Kasim, le Djowf et les territoires environnants s’étaient
soustraits à la domination de Bagdad. Livré à une anarchie p ro fonde,
chaque district se groupa autour de ses chefs, et fut pendant
des siècles déchiré par des querelles intestines. A de rares
intervalles cependant, la paix et la prospérité développaient les
ressources du pays ; nous avons déjà raconté l ’histoire du Djowf
et du Djebel-Shomer, e t nous nous réservons de consacrer plus
tard quelques pages à celle du Nedjed et du Kasim. Les provinces
de l’Yémen, du Nedjran et du Khowlan s’étaient ralliées aux
carmathiens et avaient pris part à leurs succès; quand ils furent
vaincus, elles leur donnèrent asile dans leurs places fortes où ils
défièrent pendant des siècles les attaques de leurs ennemis. Les
côtes de l’Yémen cependant, habitées par un peuple pacifique et
qui, sincèrement dévoué au mahométisme, regardait laséparation
de l’Arabie comme un malheur et un péché, acceptèrent la souveraineté
nominale, tantôt du calife d’Egypte, tantôt de celui de
Bagdad. L’Oman, au contraire, et avec lui l’Hadramaut au sud,
Katar et Bahrain au nord, profitèrent de l’alliance carmathienne
pour affermir leur indépendance.
Le pèlerinage annuel fournissait seul maintenant aux califes le
prétexte d’exercer une ombre d’autorité sur le te rritoire de La
Mecque; parfois aussi les chefs de l’Yémen jugeaient à propos
d’invoquer leu r arbitrage pour régler les prétentions rivales qui
les divisaient.
Des années, des siècles s’écoulèrent ; les Turcs, les Turco-
mans, les Kurdes, les Mamelouks fondèrent des royaumes qui,
nés dans le sang, nourris de sa n g , s’éteignirent dans le sang.
Les croisés vinrent des extrémités de l’Europe, les Tartares,
du fond de l ’Asie pour livre r de sanglantes batailles sur les
côtes de l ’Asie, su r les rives du Nil et de l’Euphrate. L’Arabie,
enfermée dans son impénétrable désert, demeurait à l'abri
des révolutions qui bouleversaient les nations voisines. Enfin,
les armées ottomanes arrivèrent à ses portes; elles envahiren
t l’Égyptel et la Syrie, qui devinrent pachaliks de Constan