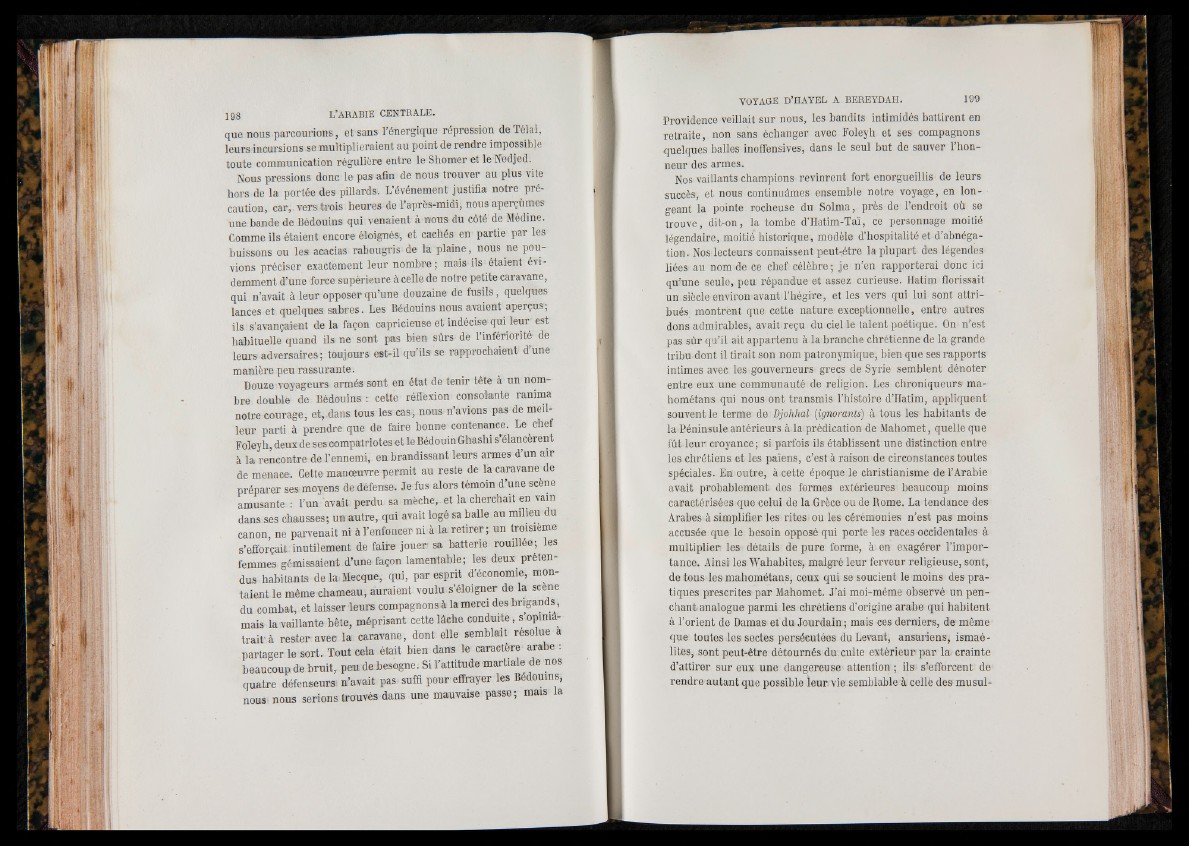
que nous p arcourions, et sans l’énergique répression deTélal,
leurs incursions se m ultiplieraient au point de rendre impossible
toute communication régulière entre le Shomer et le Nedjed.
Nous pressions donc le pas-afin de nous trouver au plus vite
hors de la portée des pillards. L’événement justifia notre précaution,
c a r,. vers trois heures de l’après-midi; nous aperçûmes
une bande de Bédouins qui venaient à'nous du côté de Médine.
Comme ils étaient encore éloignés; et cachés en partie par les
buissons ou les acacias rabougris: de la plaine, nous ne pouvions
préciser exactement leur nom b re; mais ils : étaient évidemment
d’une force supérieure à celle de notre petite caravane,
qui n ’avait à leu r opposer qu’une douzaine de fusils, quelques
lances et quelques sa b re s. Les Bédouins nous avaient aperçus,
ils ^ ’avançaient de la façon capricieuse e t indécise qui leur est
habituelle quand ils ne sont pas bien sûrs de l ’infériorité de
leurs adversaires; toujours est-il qu’ils se rapprochaient d ü n e
manière peu rassurante.
Douze voyageurs armés sont en état de tenir têtë à un nombre
double de Bédouins : cette réflexion' consolante ranima
notre courage, et,.dans tous les cas, nous n’avions pas de meille
u r p a rti à prendre que de faire bonne contenance. Le chef
Foleyh, deux de ses compatriotes e t le Bédouin Ghashi s élancèrent
à la rencontre de l ’ennemi, en brandissant leurs armes d u n air
de menace- Cette manoeuvre permit au reste de la caravane de
p rép a re r ses moyens de défense. J e fus alors témoin d’une scène
amusante : l’un avait perdu sa mèche,, et la<cherchait en vain
dans ses chausses; un au tre , qui avait logé sa balle au milieu du
canon, ne parvenait ni à l’enfoncer ni à . la, re tire r; u n troisième
s’efforcait inutilement de faire jo u e r sa batterie rouillée; les
femmes, gémissaient d’une façon lamentable; les deux p réten dus
habitants de la,Mecque, qui, par esprit d’économie, monta
ien t le même chameau, auraient voulu s’éloigner de la seene
du comhat, .et laisser leu rs compagnons à la merci des brigands ,
mais la vaillante bête, méprisant cette lâche, conduite, s’npimâ-
tra it’à re s te r avec la caravane, dont elle semblait résolue à
partager le sort. Tout cela était bien dans le caractère arabe :
beaucoup de b ru it, p e n de besogne. Si l’attitude ma rtiale de nos
q u atre défenseurs, n’avait pas suffi pour'effrayer les Bédouins,
nous nous serions trouvés dans une mauvaise passe; mais la
Providence veillait su r nous, les bandits intimidés battirent en
re tra ite , non sans échanger avec Foleyh et ses compagnons
quelques balles inoffensives, dans le seul but de sauver l’honneur
des armes.
Nos vaillants champions revinrent fort enorgueillis de leurs
succès, et nous continuâmes ensemble notre voyage, en lo n geant
la pointe rocheuse du Solma, près de l’endroit où se
trouve, dit-on, la tombe d’Hatim-Taï, ce personnage moitié
légendaire, moitié historique, modèle d’hospitalité et d’abnégation.
Nos, lecteurs connaissent peut-être la plupart des légendes
liées- au nom de oe chef célèbre; je n ’en rapporterai donc ici
qu’une seule, peu répandue et assez curieuse. Hatim florissait
un siècle environ,avant l’hégire, et les vers qui lui sont a ttribués
montrent que cette n atu re exceptionnelle, entre autres
dons admirables, avait reçu du ciel le talent poétique. On n’est
pas sûr qu’il ait appartenu à la b ranche chrétienne de la grande
tribu dont il tira it son nom patronymique, bien que ses rapports
intimes avee, les gouverneurs grecs de Syrie semblent dénoter
entre eux une communauté de religion. Les chroniqueurs ma-
hométans qui nous ont transmis l’histoire d’Hatim, appliquent
souvent le terme de Djohhal (ignorants) à tous les habitants de
la Péninsule antérieurs à la.prédication de Mahomet, quelle que
fût le u r croyance; si parfois ils établissent une distinction entre
les chrétiens et les païens, c’est à raison de circonstances toutes
spéciales. En outre, à cette époque le christianisme de l’Arabie
avait probablement des formes extérieures beaucoup moins
caractérisées que celui de la Grèce ou de Rome. La tendance des
Arabes à.simplifier les rites-ou les cérémonies n’est pas moins
accusée que le besoin opposé qui porte les races occidentales à
m ultiplie r les- détails de p u re forme, à, en exagérer l’importan
ce . Ainsi les W ahabites, malgré leur ferveur religieuse, sont,
de to u s les m ahométans, ceux qui se soucient le moins des p ra tiques
prescrites p a r Mahomet. J ’ai moi-même observé u n p en chant
analogue parmi les chrétiens d’origine arabe qui habitent
à l ’orient de Damas et du Jourdain ; mais ces derniers, de même
que toutes les sectes persécutées du Levant, ansariens, ism aélites,,
sont peut-être détournés du culte extérieur p a r la- crainte
d’a ttirer su r eux une dangereuse1 attention ; ils -s ’efforcent de
rendre au tan t que possible leur, vie semblable à cellë des m usul